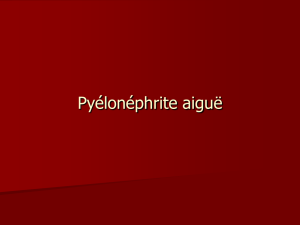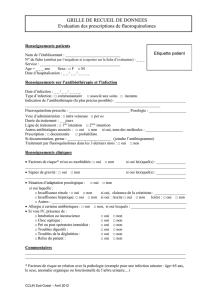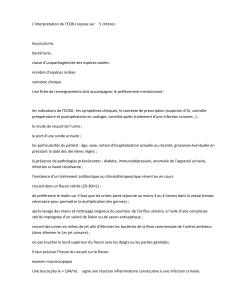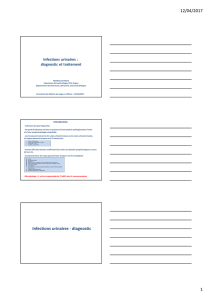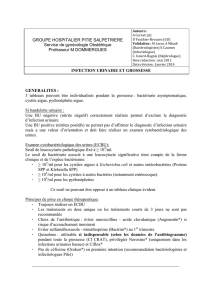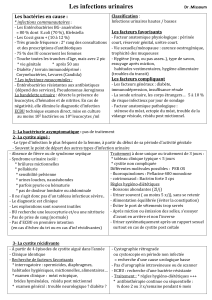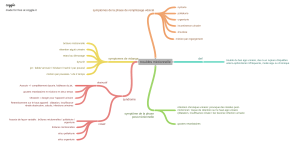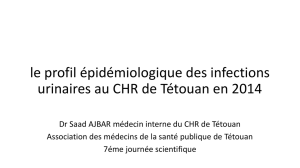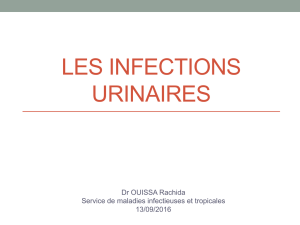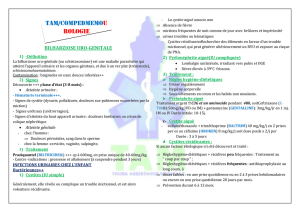La lettre d` Prise en charge des infections urinaires - Oriade

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017
L’information biomédicale des laboratoires Oriade Noviale Mars 2017
La lettre d’
Prise en charge des infections urinaires chez le sujet âgé
L’infection urinaire est
l’une des pathologies la
plus souvent rencontrée en
gériatrie…
la suite en page 2 >

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017
A l’occasion de la récente actualisation du rapport du SPILF(1) de décembre
2015, les biologistes du groupe Oriade Noviale ont interrogé le Docteur Pierre
BATAILLER Praticien hygiéniste RIPIN - CHU Grenoble - Alpes, pour repréciser
les particularités du diagnostic et de la prise en charge de l’infection urinaire
(IU) chez le sujet âgé.
Il faut savoir que la prévalence locale sur une journée en 2016 des IU chez le sujet âgé
en institution est de 1.1% (résultat obtenu sur les 42 EHPAD participant au sein de
l’EMH* de Grenoble - RIPIN). * Equipe Mobile d’Hygiène à destination des EHPAD.
De plus, la difficulté de la prise en charge de ces IU est liée à une double
problématique :
L'infection urinaire est très fréquente mais les symptômes à cet âge sont
souvent frustres et atypiques, donc peu discriminants (syndrome
confusionnel, perte d’autonomie, chutes, décompensation d’une
comorbidité...).
D’autre part, le patient exprime peu ses symptômes et l’on observera
uniquement des signes indirects comme une incontinence d'apparition
récente, une agitation, une asthénie, une anorexie...
La présence de bactéries dans les urines recouvre des entités cliniques très
diverses qui relèvent d’une prise en charge radicalement différente selon
qu’il s’agit soit d’une simple colonisation urinaire elle-aussi très fréquente
(plus de 50% des femmes de plus de 80 ans en EHPAD et 30% en
communauté), soit d’une cystite aiguë non compliquée, soit de situations à
risque comme la pyélonéphrite, la prostatite, voire une infection compliquant
une uropathie.
Il convient donc d’adapter sa stratégie avec précision afin d’éviter 2 écueils :
Le premier serait de traiter des colonisations, ce qui contribue à augmenter
l’émergence de souches multi-résistantes et à induire des coûts de
traitements inutiles et provoquer parfois des effets indésirables pour les
patients.
Le deuxième serait de prendre en charge tardivement de réelles infections
qui justifient une adaptation thérapeutique précise grâce à l’antibiogramme.
Physiologiquement l’appareil urinaire est pauvre en cellules immunocompétentes et
l’augmentation de l’incidence de l'IU avec l'âge s’explique par des troubles de la
motricité vésicale avec comme corollaire la stase vésicale. L’existence de comorbidité
(comme le diabète, l’insuffisance rénale ou la baisse des défenses immunitaires), la
diminution de l’autonomie fonctionnelle , la déshydratation, le défaut d'hygiène
favorisent également les IU.
De plus chez la femme ménopausée la carence en œstrogène modifie la flore vaginale
provoquant la disparition des lactobacilles et une alcalisation du pH favorisant ainsi la
colonisation des urines par des souches uropathogènes.
D’autre part l’infection sur sonde à demeure est souvent asymptomatique et fréquente
(quasiment 100 % des patients après 30 jours de sondage).
Dr P. Batailler,
quelles sont les
particularités
justifiant une
prise en charge
spécifique de
l’infection
urinaire chez le
sujet âgé ?
?

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017
Il convient de repérer les patients présentant un ou plusieurs facteurs de risque de
complication car l’IU peut alors justifier le recours à une gestion thérapeutique plus
complexe. Par définition ce sont les patients présentant une anomalie organique ou
fonctionnelle de l’arbre urinaire, les patients de plus de 65 ans avec plus 3 critères de
fragilité (critères de Fried), les patients de plus de 75 ans, les immunodéprimés graves,
les insuffisants rénaux chroniques sévères (DFG estimé < 30 ml/min/1.73m2).Le sexe
masculin constitue un facteur de risque de complication.
Les symptômes qui doivent faire rechercher une IU chez un patient à risque peuvent
être fonctionnels (troubles mictionnels, douleur fosse lombaire, apparition d’une
incontinence urinaire, d’un globe vésical), généraux (fièvre, frissons) mais ils sont
souvent aspécifiques (modification du comportement, confusion, perte d’autonomie,
chutes…).
En présence d’une bactériurie, le diagnostic différentiel d’IU avec une autre pathologie
est avant tout clinique. En effet, il faut réunir les arguments en faveur :
soit d’une colonisation urinaire (bactériurie avec ou sans leucocyturie) par un
micro-organisme mais sans manifestations cliniques associées. Cette
colonisation ne doit pas être traitée, sauf en cas de procédure urologique invasive
programmée.
soit d’infection urinaire. Il conviendra alors de procéder avec discernement en
sachant attendre l’antibiogramme en l’absence de signe de gravité et en
instituant une antibiothérapie probabiliste en cas de signe de gravité ou en
présence de facteurs de risques :
Pour vous,
quels sont les
patients âgés
les plus exposés
aux
complications ?
?
Comment
posez-vous le
diagnostic d’IU
chez le sujet
âgé et quels
sont les
éléments
cliniques
discriminants ?
Critères de FRIED = critères de fragilité
?

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017
La conduite à tenir est la suivante (recommandations SPILF)
Remarque: Chez des patients âgés en long séjour, la présence d’une fièvre > 38°C et d’une
bactériurie ≥ 105 UFC/mL n’est associée que chez 10% des patients à une infection de
l’appareil urinaire, les autres sujets ayant une infection d’un autre organe associée à une
simple colonisation de l’appareil urinaire.

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017
Pour rappel, les seuils de diagnostic d’IU :
Le seuil de leucocyturie est inchangé ≥ 104 /ml.
Chez un patient symptomatique avec leucocyturie ≥ 104 UFC/ml, les seuils de
bactériurie significative dépendent de l’espèce bactérienne en cause et du sexe
du patient :
Remarque : E. coli est responsable de 90 % des IU communautaires
P. aeruginosa, S. aureus sont rarement responsables d'IU
communautaires.
En cas de cystite aiguë simple : effectuer une Bandelette urinaire (BU)
Prescrire un traitement probabiliste si la bandelette est positive.
En cas de BU négative chez la femme symptomatique (sauf
immunodépression, pouvant entraîner de faux négatifs), cela permet
d’éliminer le diagnostic d’IU et de ne pas réaliser d’ECBU. Un
diagnostic différentiel doit être évoqué.
Chez l’homme symptomatique, la BU est une aide au diagnostic (forte
valeur prédictive positive) mais ne dispense pas de l’ECBU (faux négatif
de la BU).
En cas de cystite aiguë à risque de complication (cf. liste des facteurs de risques
de complication vue plus haut)
Une bandelette urinaire est recommandée et un ECBU doit être
systématiquement réalisé. Le principe fondamental est de différer
chaque fois que possible l’antibiothérapie pour prescrire un traitement
d’emblée adapté à l’antibiogramme et choisir l’antibiotique avec la
pression de sélection la plus faible possible. En effet, c'est dans cette
population que le risque de résistance est le plus élevé.
qu’E.coli, Entérocoque
Quelle est la
place de la
bandelette
urinaire (BU) et
de l’ECBU, et
quelle conduite
tenir suite aux
résultats ?
?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%