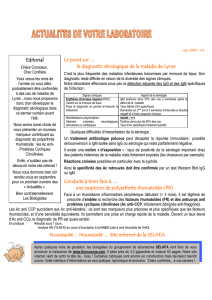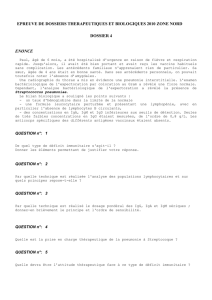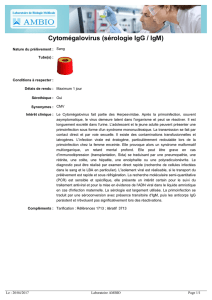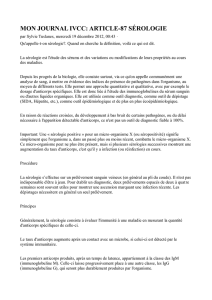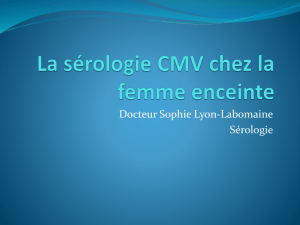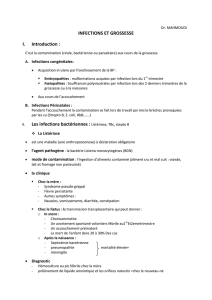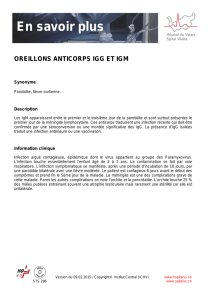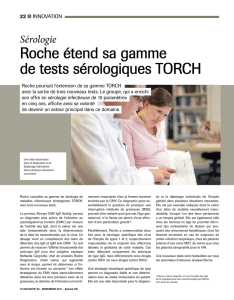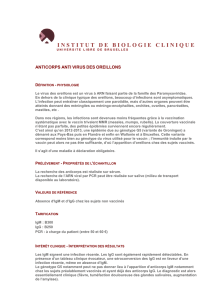Les examens sérologiques microbiologiques dans le

La Lettre du Rhumatologue - n° 249 - février 1999
14
écouvrir l’étiologie microbienne des rhumatismes
inflammatoires est un vieux mythe qui a donné lieu,
ces dernières années, à un intense regain d’intérêt.
Ainsi, le rhumatologue fait souvent appel à des examens micro-
biologiques. Pourtant, ces examens permettent rarement d’iden-
tifier directement le germe arthritogène ; c’est pourquoi des
méthodes diagnostiques indirectes sérologiques ont été dévelop-
pées. En pratique, l’intérêt réel de ces sérologies est souvent mal
connu. L’objectif de cette mise au point est donc de répondre à
différentes questions pratiques.
QU’EST-CE QU’UNE SÉROLOGIE MICROBIENNE ?
Une sérologie microbienne est la recherche d’anticorps (Ac) spé-
cifiques traduisant l’immunisation contre un micro-organisme
pathogène ou parfois simplement saprophyte. La découverte de
ces Ac n’apporte donc qu’un argument diagnostique indirect en
faveur d’une infection. Elle n’est en aucun cas la preuve bacté-
riologique formelle d’une infection active.
QUELLES SONT LES TECHNIQUES SÉROLOGIQUES UTILISÉES
EN PRATIQUE QUOTIDIENNE ?
Différentes techniques immunologiques permettent la recherche
d’Ac antimicrobiens. Ce sont d’ailleurs les mêmes techniques qui
sont utilisées pour la recherche d’autres Ac comme les autoanticorps.
Les méthodes quantitatives
Les méthodes les plus utilisées sont l’agglutination, l’immuno-
fluorescence (IF) et les techniques immunoenzymatiques appe-
lées ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Quelle que
soit la technique, le principe est toujours le même (figure 1). Un
support (globule rouge, bille de latex, polystyrène) permet de pré-
senter un ou des antigènes (Ag) bactériens spécifiques judicieu-
sement choisis. Le sérum des patients présumé contenir des Ac
antimicrobiens est déposé sur le support. Si une réaction Ag-Ac
s’effectue, elle est révélée, selon les méthodes, soit par une réac-
tion d’agglutination, soit par une fluorescence, soit par une réac-
tion colorimétrique enzymatique. Dans les tests radio-immuno-
logiques (RIA), la révélation se fait par un marqueur radioactif,
ce qui explique que ces tests soient beaucoup moins utilisés, car
ils ne peuvent s’effectuer que dans des laboratoires agréés. Toutes
ces méthodes sont semi-quantitatives (agglutination, IF) ou quan-
titatives (ELISA et RIA).
Comment s’expriment les résultats ? Les résultats des tests
quantitatifs s’expriment en unités (U/ml) ou en unités interna-
tionales (UI/ml). La valeur est déterminée par rapport à un témoin
positif standard. Si ce témoin est validé internationalement (par
M
ISE AU POINT
Les examens sérologiques microbiologiques
dans le diagnostic des arthropathies inflammatoires :
quelles sérologies ? Comment les interpréter ?
●
J. Sibilia*
* Service de rhumatologie, CHU de Strasbourg.
■Les sérologies microbiologiques sont des méthodes dia-
gnostiques indirectes qui ne remplacent pas la recherche
directe du germe, quand cela est possible.
■La stratégie sérologique idéale utilise une méthode de
dépistage sensible (immunofluorescence, ELISA),
complétée éventuellement par une méthode de confirma-
tion plus spécifique (Western-Blot).
■
La découverte d’Ac spécifiques ne démontre pas l’exis-
tence d’une infection active mais peut être la marque d’un
simple contact, parfois ancien, avec un germe (“cicatrice
sérologique”), en particulier quand l’infection a une forte
séroprévalence dans la population générale.
■Pour certaines infections digestives (Yersinia, Salmo-
nella)et génito-urinaires (Chlamydia trachomatis), la pré-
sence persistante d’IgA spécifiques est un argument en
faveur d’une infection active.
■Aucune sérologie ne devrait être réalisée systématique-
ment. Cet examen doit s’inscrire dans une démarche dia-
gnostique rationnelle. Les seules sérologies véritablement
utiles pour le rhumatologue sont celles qui modifient le
diagnostic et/ou la prise en charge thérapeutique d’ar-
thropathies inflammatoires.
Points forts
D

La Lettre du Rhumatologue - n° 249 - février 1999
15
M
ISE AU POINT
l’OMS, les Centers for Diseases Control [CDC] d’Atlanta ou un
autre organisme), les résultats exprimés en UI/ml sont théori-
quement tous comparables, car ils sont étalonnés par rapport au
même témoin. En fait, la pratique montre qu’il existe, pour le
même sérum, d’importantes variations interlaboratoires qui s’ex-
pliquent par différents phénomènes (variation des méthodes de
dosage, conservation des prélèvements et des témoins interna-
tionaux, rigueur dans la standardisation des tests...).
Les méthodes qualitatives
La principale méthode qualitative est l’immunoempreinte appe-
lée “Western-Blot”. Le principe de cette méthode est de faire
migrer, sous l’effet d’un champ électrique, les différents consti-
tuants antigéniques d’un micro-organisme dans un gel d’agarose,
puis de transférer, après migration, l’ensemble des bandes anti-
géniques sur une feuille de nitrocellulose (d’où le terme d’im-
munoempreinte ou immunotransfert). La migration électropho-
rétique, qui s’effectue selon la taille et la charge électrique des
Ag (les plus petites et les plus chargées migrent le plus loin), per-
met d’obtenir une sorte de spectre de bandes antigéniques faisant
apparaître une par une la plupart des protéines microbiennes. Lors
de la dernière phase du test, le sérum du patient supposé conte-
nir des Ac antimicrobiens est déposé sur les bandes de nitrocel-
lulose. Si une réaction Ag-Ac s’effectue, elle est révélée par une
réaction enzymatique colorimétrique.
Comment s’expriment les résultats ?
S’il existe une véritable réaction antimicrobienne, il est habituel
de détecter des Ac polyclonaux dirigés contre de nombreuses pro-
téines bactériennes différentes. Les résultats sont donc exprimés
en énumérant les bandes antigéniques reconnues définies par leur
poids moléculaire (kilodalton : kDa). L’intérêt majeur de cette
technique est donc de vérifier la spécificité de la réaction Ag-Ac
et d’éliminer les faux positifs liés à des phénomènes de réactivité
croisée, comme l’illustre l’exemple de la sérologie de la borré-
liose de Lyme (figure 2).
1. Les réactions d’agglutination
2. Les réactions immunoenzymatiques, radio-immunolo-
giques et d’immunofluorescence
E : réactions enzymatiques
F : réactions immunofluorescentes
R : réactions radioactives
❏La réaction Ag-Ac est révélée par un Ac marqué par une enzy-
me E, une marque radioactive R ou la fluorescéine F.
❏La lecture de la réaction se fait :
➝ par l’adjonction d’un substrat colorimétrique de l’enzyme
E, puis une lecture automatisée quantitative de la densité
optique (DO).
➝ par la mesure automatisée quantitative de la radioactivité
pour les marques radioactives R.
➝ par la lecture qualitative et semi-quantitative de la fluo-
rescence F avec un microscope à fluorescence. Cette métho-
de a l’avantage de permettre une description morphologique
de la fluorescence si elle s’effectue sur des cellules ou des
coupes de tissus. Mais elle a aussi l’inconvénient d’être
dépendante de “l’œil du lecteur”.
Sérum du patient
Latex
ou
GR
Antigènes
microbiens
IgG
IgM
Sérum du patient
Ac
Antigène(s)
Ag
ERF
Figure 1. Différentes techniques de dosages immunologiques des anti-
corps microbiens.
Première étape. Analyse quantitative de la réaction IgG
anti-Bb en ELISA
Deuxième étape. Vérification qualitative de la réaction IgG
anti-Bb en Western-Blot
Seul le sérum du patient 1 contient suffisamment d’Ac spéci-
fiques de Bb. En fait, le sérum du patient 2 ne reconnaît que des
antigènes de 41 et 80 kDa. Ces deux antigènes ne sont pas spéci-
fiques de Bb, mais sont présents dans de nombreux autres micro-
organismes. Il s’agit donc d’un résultat faux positif lié à des phé-
nomènes de réactivité croisée. Actuellement, il est admis qu’une
réaction IgG anti-Bb n’est positive que si les IgG reconnaissent
au moins 5 des 10 bandes suivantes : 18, 21, 28, 30, 39, 41, 45,
58, 66 et 93 kDa et/ou que les IgM reconnaissent au moins 2 des
3 bandes suivantes : 24, 39 et 41 kDa (critères de Dressler). Ces
critères de positivité ont été définis sur le territoire américain ; il
n’est pas certain qu’ils s’appliquent en Europe.
Sérum
du patient
1 ou 2 Ac
Ag de Bb Ag
EE
+ substrat
calorimétrique
Patient 1 : présence d'IgG anti-Bb : 50 UI/ml
Patient 2 : présence d'IgG anti-Bb : 50 UI/ml
Patient
Patient
1
2
18 21 23 26 28 30 39
41 80
41 66 80 93
poids
moléculaire
(kDa)
Figure 2. Comment utiliser les sérologies immunoenzymatiques (ELISA)
et le Western-Blot : application à la sérologie de la borréliose de Lyme
(Ac anti-Borrelia burgdorferi [Bb]).

La Lettre du Rhumatologue - n° 249 - février 1999
16
M
ISE AU POINT
FAUT-IL RECHERCHER LES DIFFÉRENTS ISOTYPES (IgG, IgM,
IgA) DES ANTICORPS ANTIMICROBIENS ?
La plupart des méthodes sérologiques permettent de détecter soit
l’ensemble des Ac (Ac totaux) ou plus spécifiquement des IgG,
IgM, IgA antimicrobiens. La recherche d’isotypes particuliers est
aisée avec les méthodes ELISA, car il suffit d’utiliser un Ac mar-
qué enzyme spécifique de chaque isotype (Ac anti-IgG,Ac anti-
IgM, Ac anti-IgA). Les techniques d’agglutination sont un cas
particulier car elles ne permettent d’observer que des Ac agglu-
tinants. Seules les IgM, dont la structure permet de fixer 5 à 10 Ag,
et certaines formes d’IgG sont détectables en agglutination.
Intérêt de la recherche des Ac totaux. La recherche d’Ac totaux
est souvent suffisante, mais elle ne démontre que l’immunisation
contre le micro-organisme cible sans présumer de l’ancienneté
de l’infection.
Intérêt de la recherche des IgG spécifiques. L’intérêt de la
recherche des IgG est comparable à celle des Ac totaux car les
IgG représentent quantitativement 60 à 80 % des Ac totaux.
Intérêt de la recherche des IgM spécifiques. Des IgM sont spé-
cifiquement produites lors de la primo-infection, c’est-à-dire dans
les semaines qui suivent le premier contact avec le micro-orga-
nisme. Cette réaction IgM disparaît progressivement en quelques
mois, suivie de l’apparition d’Ac de type IgG (figure 3). L’inté-
rêt essentiel de la détection d’IgM est donc de démontrer qu’il
existe un contact récent avec le germe en cause.
Néanmoins, il existe des situations dans lesquelles il faut inter-
préter la présence d’IgM avec prudence :
– dans certaines infections comme la borréliose de Lyme, des
IgM peuvent persister plus d’un an après la primo-infection ;
– la spécificité des réactions IgM peut être faible, car il existe de
nombreux faux positifs liés à d’autres IgM et surtout à la pré-
sence d’autoanticorps d’isotype IgM, en particulier des facteurs
rhumatoïdes (IgM anti-IgG).
Intérêt de la recherche des IgA spécifiques. Dans un certain
nombre de cas, la présence d’IgA peut traduire l’origine
muqueuse de l’infection (digestive, génito-urinaire, broncho-
pulmonaire). Ce point est particulièrement intéressant au cours
des arthrites réactionnelles liées à des germes digestifs et génito-
urinaires. Ainsi, dans les infections à Chlamydia trachomatis, la
réponse IgA semble plus spécifique d’une infection active, en
particulier quand il existe des Ac dirigés contre une protéine du
choc thermique (HSP 57 kDa). Les IgA anti-HSP 57 sont retrou-
vées chez 75 % des patients présentant une arthrite à Chlamydia
trachomatis alors qu’elles sont rarement détectées dans les uré-
trites non compliquées. Des observations identiques ont été faites
pour les IgA anti-Yersinia enterocolitica et anti-Salmonella typhi-
murium et enteridis. En effet, les patients souffrant d’arthrite à
Yersinia enterocolitica 0.3 développent une réaction humorale
d’isotypes IgG et IgA dans respectivement 72 et 85 % des cas,
contre 50 et 32 % chez les patients présentant une yersiniose sans
arthrite.
Intérêt de la recherche d’autres isotypes (IgD, IgE). À ce jour,
la recherche de ces isotypes n’a aucun intérêt pratique.
COMMENT ÉVALUER LA VALEUR D’UN TEST SÉROLOGIQUE ?
Un test sérologique doit avoir deux qualités différentes :
Une bonne valeur technique
Un test sérologique doit avoir une bonne qualité technique, uti-
lisant des composés (support,Ag,Ac marqués) d’excellente qua-
lité. Un des éléments les plus importants est le choix du ou des
Ag représentatif(s) du micro-organisme recherché. Cette qualité
technique est définie par le fabricant qui doit fixer une valeur seuil
de positivité en étudiant des sérums témoins de sujets sains (le
plus souvent des donneurs de sang). Cette valeur seuil est donc
calculée en tenant compte des valeurs obtenues chez les donneurs.
Habituellement, elle est définie par la valeur moyenne + 3 dévia-
tions standards. Il est important de préciser que cette valeur seuil
n’est pas forcément une valeur diagnostique. La valeur diagnos-
tique n’est peut-être définie que par l’évaluation clinique du test.
Une bonne valeur clinique
L’objectif de cette étape est de définir une valeur “diagnostique”.
La valeur diagnostique d’un test peut se définir par différentes
caractéristiques, dont, notamment, la sensibilité et la spécificité.
❏
La sensibilité est définie par la probabilité qu’un test soit posi-
tif quand il y a une infection microbienne documentée. En d’autres
termes, une bonne sensibilité signifie qu’il y a peu de faux néga-
tifs. Elle s’exprime en pourcentage.
❏
La spécificité est définie par la probabilité qu’un test soit néga-
tif, quand il n’y a pas d’infection recherchée documentée. En
d’autres termes, une bonne spécificité signifie qu’il y a peu de
faux positifs. Cette qualité s’exprime également en pourcentage.
Comme nous l’avons vu, l’utilisation de plusieurs Ag différents
grâce notamment au Western-Blot, permet d’améliorer très sen-
siblement la spécificité.
❏
Les valeurs prédictives positive et négative permettent aussi
d’exprimer la valeur d’un test. Elles dépendent de la sensibilité
et la spécificité du test, ainsi que de la prévalence de l’infection
dans la population étudiée.
Titre
d'Ac
Primo-infectionIgM IgG Réinfection
Mois
1236
Figure 3. Schéma de séroconversion et de réinfection.

La Lettre du Rhumatologue - n° 249 - février 1999
17
M
ISE AU POINT
Analyse critique de la valeur diagnostique d’un test. Sensibi-
lité et spécificité sont dépendantes des qualités techniques du test,
en particulier du ou des Ag utilisé(s). Ces Ag doivent être suffi-
samment représentatifs du micro-organisme, c’est-à-dire être
reconnus par la plus grande majorité des patients infectés par ce
germe sans l’être par les Ac de patients atteints d’affections appa-
rentées. Quoi qu’il en soit, un test n’a jamais une spécificité et
une sensibilité absolues (100 %). Dans la plupart des cas, les tests
très “sensibles” sont souvent moins “spécifiques” et, inversement,
les tests très “spécifiques” sont souvent assez peu “sensibles”.
En pratique, l’étude de la valeur clinique d’un test sérologique
est une étape très importante, totalement liée à la qualité des dia-
gnostics retenus pour les sérums qui servent de témoins. Si cette
analyse n’est pas faite avec beaucoup de rigueur, il n’est pas pos-
sible de savoir quelle est la valeur réelle d’un test en pratique quo-
tidienne.
COMMENT INTERPRÉTER UNE SÉROLOGIE ?
Il s’agit d’un point particulièrement important car un certain
nombre de sérologies sont mal interprétées. La présence d’Ac
ne signifie pas l’existence d’une infection active mais peut être
la marque d’un simple contact, parfois ancien, avec un germe.
Ces Ac sont alors le reflet d’une “cicatrice sérologique” souvent
protectrice. Cela est particulièrement vrai quand l’infection a une
forte séroprévalence dans la population générale... ou si les sujets
ont été vaccinés. À titre d’exemple, tout sujet vacciné contre le
tétanos et la polio a, pendant de nombreuses années, des Ac cir-
culants sans avoir d’infection active. En pratique, la sérologie ne
permet de suggérer une infection récente et/ou active que dans
trois situations :
1. Si la primo-infection est démontrée grâce à deux dosages suc-
cessifs (à au moins un mois d’intervalle). La première analyse
doit montrer la présence d’IgM isolée ou parfois associée à des
titres faibles d’IgG. Le deuxième contrôle doit confirmer la dis-
parition des IgM et l’ascension significative des titres IgG spéci-
fiques. Comme nous l’avons vu précédemment, la présence d’IgM
doit toujours être interprétée avec prudence (figure 3).
2. Si une réinfection est démontrée grâce à deux dosages suc-
cessifs confirmant une réascension significative des titres IgG.
Cette différence significative est d’au moins deux dilutions (par
exemple de 1/32 à 1/128) pour les sérologies semi-quantitatives
et d’un taux qui dépend de la méthode pour les dosages quanti-
tatifs (figure 3).
3. Si une infection active est caractérisée par la présence d’un titre
élevé d’isotype IgA, comme nous l’avons vu précédemment pour
les infections à Chlamydia trachomatis, Yersinia et Salmonella.
QUELLES SONT LES SÉROLOGIES MICROBIENNES UTILES
POUR LE RHUMATOLOGUE ?
QUAND FAUT-IL DEMANDER UNE SÉROLOGIE MICRO-
BIENNE ?
Aucune sérologie ne devrait être réalisée systématiquement. Cet
examen doit être programmé dans une démarche diagnostique
rationnelle, en particulier s’il n’existe pas d’autre moyen dia-
gnostique direct. Cela est particulièrement vrai pour les virus
arthritogènes et pour certaines bactéries très difficiles ou impos-
sibles à mettre en évidence (exemple : Borrelia burgdorferi). Quoi
qu’il en soit, une sérologie n’est légitime que si cela modifie la
prise en charge du patient. Cela peut se produire dans certaines
circonstances :
❏
Si le germe en cause est éventuellement transmissible, comme
c’est le cas pour les virus des hépatites et le VIH. La découverte
d’une infection virale chronique permet alors non seulement
d’adapter le traitement, mais également d’informer le malade du
risque qu’il fait courir à son entourage.
❏
Si le germe en cause peut être éradiqué, comme cela est le cas
pour certaines bactéries arthritogènes dont le portage chronique
extra-articulaire est possible (Chlamydia trachomatis, Borrelia
burgdorferi). Néanmoins, il faut préciser que, dans cette cir-
constance, la sérologie ne remplace pas la recherche directe du
germe (si elle est possible). En d’autres termes, la preuve bacté-
riologique d’une infection chronique n’est formelle que si la bac-
térie est identifiée directement.
❏
Si l’identification d’un agent infectieux modifie la prise en
charge thérapeutique de la maladie articulaire. Ainsi, à titre
d’exemple, si la sérologie confirme qu’une polyarthrite est liée à
une infection à parvovirus B19, la mise en route d’un traitement
de fond par méthotrexate ou un immunomodulateur pourrait être
différée. Un autre exemple pourrait être l’utilité de rechercher
une infection virale hépatique (VHB,VHC) avant la mise en route
d’un traitement hépatotoxique (méthotrexate).
Quelles sérologies faut-il demander ?
Il n’y a pas de “recette” pour la prescription des sérologies micro-
biennes, qui doivent être discutées au cas par cas en fonction des
données de l’interrogatoire et de l’examen clinique (tableau I).
Schématiquement, cette discussion s’effectue en fonction des
signes articulaires et des signes associés (tableau II), mais il n’y
a pas de sérologie “générique”. En d’autres termes, il ne faut pas
demander une “sérologie arthrite réactionnelle” ou une “sérolo-
gie polyarthrite” : la prescription doit être précise.
Les sérologies virales. Elles sont dans l’ensemble sensibles et
spécifiques. Même la sérologie de l’hépatite C est actuellement
performante grâce au développement de tests de nouvelle géné-
ration.
❏
Les sérologies des virus des hépatites sont particulièrement
importantes car ces virus ont la particularité de se manifester par
des signes rhumatologiques ou systémiques très polymorphes.
(Coût 1998 : hépatite C : ELISA B70 et RIBA B100, hépatite B :
Ag Hbs ELISA B70, Ac anti-Hbs ELISA B70, Ac anti-Hbc
ELISA B70).
❏
L’indication de la sérologie VIH mérite d’être discutée car les
manifestations rhumatologiques révélatrices d’une infection par
le VIH sont exceptionnelles. Ce diagnostic doit néanmoins être
évoqué, en particulier quand il existe un tableau d’oligoarthrite
ou de spondylarthropathie, parfois associée à un psoriasis, ou des
antécédents récents d’infections extra-articulaires.
Cette sérologie doit être effectuée avec le consentement du patient,
mais cette règle n’a rien de spécifique car elle s’applique à l’en-
semble des examens complémentaires.

La Lettre du Rhumatologue - n° 249 - février 1999
18
M
ISE AU POINT
(Coût 1998 : VIH : ELISA B70, Western-Blot B100).
❏
La sérologie du parvovirus B19 (PB19) est indiquée en cas de
polyarthrite récente, en particulier chez les sujets en contact avec
de jeunes enfants. Ce virus est responsable de signes cutanés mais
aussi d’érythroblastopénie chez l’adulte. Cependant, son rôle
direct dans le déclenchement des arthropathies est encore dis-
cuté. La sérologie PB19 est spécifique, mais 70 à 80 % des sujets
adultes ont été en contact avec ce virus et ont développé des IgG
spécifiques qui peuvent persister quelques années. Un contact
viral récent ne peut donc être démontré que par la découverte
d’une primo-infection (IgM).
(Coût 1998 : PB19 : ELISA IgG B70, ELISA IgG et IgM B120).
❏
Les autres sérologies virales ne sont pas discutées dans cette
mise au point.
Les sérologies bactériennes. La valeur de ces sérologies est
variable, en particulier celles destinées aux germes digestifs. Ces
dernières ont souvent moins d’intérêt car elles sont assez peu spé-
cifiques.
❏
Pour Chlamydia trachomatis (Ct) : des méthodes immunoen-
zymatiques permettent un titrage des IgG et IgA mais ne sont pas
adaptées au dosage des IgM. Il faut rappeler que la séropréva-
lence des IgG anti-Ct est de 15 à 20 % dans certaines populations
à risque. Globalement, la sensibilité et la spécificité de ces séro-
logies sont acceptables, même si elles varient beaucoup selon l’Ag
utilisé. Cette sérologie est indiquée quand on évoque une spon-
dylarthropathie ou parfois un rhumatisme inexpliqué, notamment
quand il se manifeste par une oligoarthrite des membres inférieurs.
(Coût 1998 : ELISA B60).
❏
Pour Chlamydia pneumoniae (Cp) : différentes méthodes
immunoenzymatiques permettent de détecter différents isotypes.
Virus
●Virus des hépatites B et C ➝ tableaux cliniques polymorphes
●Virus de l’hépatite A ➝ gastroentérite
●Parvovirus B19 ➝ érythème, érythroblastopénie
●Paramyxovirus ➝ rougeole et oreillons
●Virus de la rubéole ➝ rubéole
●HIV ➝ manifestations diverses
●HTLV-1 ➝ paraparésie spasmodique, leucémie T
●Herpès virus (virus zona-varicelle, virus d’Epstein-Barr,
cytomégalovirus, herpès simplex virus) ➝ manifestations
diverses et syndrome mononucléosique
●Arbovirus ➝ dengue
●Entérovirus (Coxsackie, échovirus) ➝ gastroentérite
●Adénovirus ➝ infections respiratoires
Bactéries
●Chlamydia trachomatis (IgG-IgA) ➝ infections génito-urinaires
●Borrelia burgdorferi ➝ borréliose de Lyme (zone d’endémie)
●Chlamydia pneumoniae ➝ bronchopneumopathies
●Streptococcus (ASLO-ASDO) ➝ infections respiratoires,
cutanées
●Brucella melitensis et abortus ➝ brucellose
●Yersinia enterocolitica 0.3, Salmonella enteridis et typhymu-
rium et Campylobacter jejuni ➝ gastroentérite
●Leptospira ictero-hemorragiae ➝ leptospirose
●Treponema pallidum ➝ syphilis
Tableau I. Principales sérologies microbiologiques utilisées dans le
bilan d’arthropathies inflammatoires.
En cas de polyarthrite débutante
●Virus hépatotropes : justifiée en cas d’arthrite précédant ou
accompagnant une hépatite virale ou dans un contexte parti-
culier (ex. : cryoglobulinémie liée au VHC).
●Parvovirus B19 : justifiée en cas d’arthrite chez un adolescent
ou un adulte jeune.
●Borrelia burgdorferi : justifiée en cas d’exposition à la borré-
liose de Lyme.
Les autres sérologies virales ou bactériennes ne se discutent que
dans des contextes épidémiologiques ou cliniques particuliers.
En cas d’oligoarthrite et d’autres tableaux
pouvant évoquer une spondylarthropathie
●Chlamydia trachomatis : justifiée quasi systématiquement chez
l’adulte jeune en cas de suspicion d’arthrite réactionnelle ou de
tableaux cliniques apparents (oligoarthrite inexpliquée).
●Yersinia enterocolitica 0.3, Salmonella, Campylobacter : jus-
tifiée en cas d’arthrite dans un contexte endémique ou épidé-
mique de gastroentérite.
●Chlamydia pneumoniae : justifiée exceptionnellement dans
un contexte d’arthropathie post-broncho-pneumopathie.
●Borrelia burgdorferi : justifiée en cas d’exposition à la borré-
liose de Lyme.
●Streptococcus : justifiée en cas de suspicion de syndrome
post-streptococcique.
●Virus hépatotropes (VHA, VHB, VHC) : justifiée en cas d’ar-
thrite précédant ou accompagnant une hépatite virale, ou de
certains contextes particuliers (cryoglobulinémie).
●Virus de la rubéole : justifiée en cas d’arthrite post-vaccinale
chez la femme jeune ou en cas de rubéole.
●VIH : justifiée en cas d’arthropathie aiguë dans un contexte
de facteur de risque (contage VIH).
En cas de monoarthrite
Aucune sérologie n’est justifiée systématiquement, mais cette
situation peut s’apparenter à celle d’une oligoarthrite.
Tableau II. Indications et discussions des sérologies microbiennes en
fonction du tableau articulaire.
 6
6
1
/
6
100%