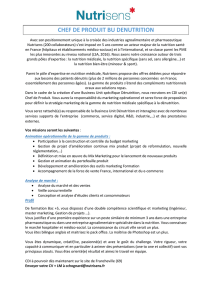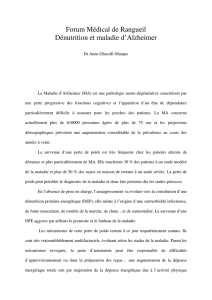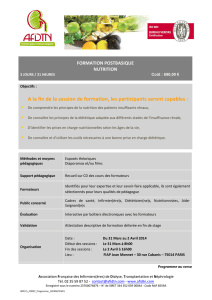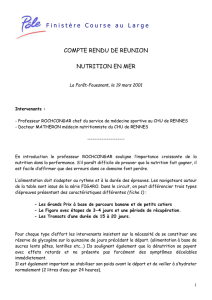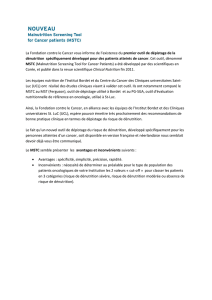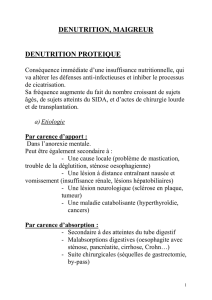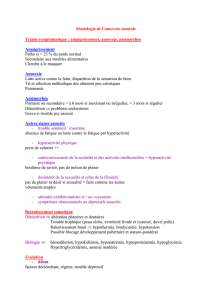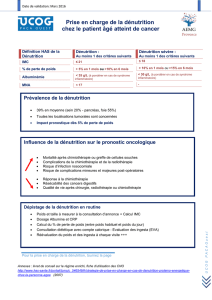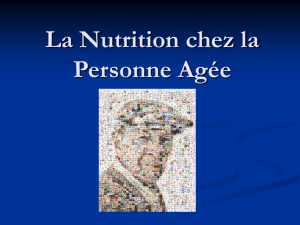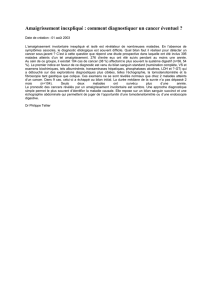Stratégie diagnostique et thérapeutique devant un amaigrissement

Stratégie diagnostique
Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume IV, n°1, février 2000
20
Épidémiologie et physiopathologie
La dénutrition a été reconnue aux États-
Unis comme la deuxième complication de
la maladie. Elle est au premier plan chez
20 % des malades au moment du diagnos-
tic du sida (4). Sa fréquence augmente au
cours de l’évolution de l’immunodépres-
sion, pour toucher 70 à 80 % des malades à
un stade plus avancé. Il a été démontré
depuis peu qu’une perte de poids récente de
plus de 5 % est le plus souvent annoncia-
trice d’une infection opportuniste ou d’un
autre événement morbide secondaire. Cela
amène à analyser les mécanismes de la
perte de poids. L’amaigrissement au cours
de l’infection par le VIH est sous-tendue
par un certain nombre d’anomalies métabo-
liques : augmentation chronique mais
modérée de la dépense énergétique de
repos (6), augmentation du turn-over pro-
téique (7), augmentation de la synthèse
hépatique de novo et de l’oxydation des
lipides (8), alors qu’une augmentation de la
sensibilité à l’insuline est généralement
observée (9). Au cours des infections
secondaires, les perturbations métaboliques
sont plus classiques : augmentation plus
marquée de la dépense énergétique de
repos, hypercatabolisme protéique prédo-
minant et insulinorésistance (10). À ces
perturbations métaboliques peuvent s’asso-
cier d’autres mécanismes qui contribuent à
l’amaigrissement : malabsorption digesti-
ve, parfois flagrante, mais qui peut être
sournoise et peu parlante, anorexie de
mécanisme variable, qui constitue en fait la
principale étiologie de l’amaigrissement au
cours du sida.
Stratégie diagnostique
devant un amaigrissement
La stratégie diagnostique devant un amai-
grissement doit tenir compte du stade de la
maladie et des traitements. Devant un amai-
grissement progressif à un stade peu avan-
cé de l’immunodépression, on pourra pen-
ser à un wasting syndrome. À l’opposé, un
amaigrissement rapide doit faire penser à
une infection secondaire débutante (11).
L’interrogatoire et l’examen clinique doi-
vent rechercher une diarrhée, analyser la
courbe thermique, rechercher un syndrome
inflammatoire et faire pratiquer quelques
examens complémentaires orientés par la
clinique. Une diarrhée isolée peut être, en
première intention, explorée par un examen
parasitologique des selles, ainsi que par une
coproculture. Si la diarrhée est associée à
un amaigrissement et à une immunodépres-
sion (CD4 < 200/mm3), la recherche d’une
malabsorption s’impose (stéatorrhée, test
au ∆xylose, calorimétrie fécale).
L’insuffisance de la prise alimentaire étant
le premier facteur de l’amaigrissement des
patients sidéens (12), l’anorexie doit être
systématiquement recherchée, non seule-
ment par l’interrogatoire, mais aussi et sur-
tout devant un amaigrissement installé par
un interrogatoire alimentaire quantifié réa-
lisé par une diététicienne entraînée. En
effet, bien souvent, une évaluation appro-
Stratégie diagnostique
et thérapeutique
devant un amaigrissement
chez le sidéen
J.C. Melchior*
L
a dénutrition a été, depuis une
dizaine d’années, reconnue
comme une des complications
majeures du sida (1). Le wasting syn-
drome est défini par une perte de
poids involontaire, supérieure à 10 %
par rapport au poids de référence,
associée à asthénie et/ou fièvre, et
ce en l’absence de cause identifiée
autre que le VIH (1). La prise en
considération de cette dénutrition est
d’une grande importance. L’amé-
lioration des traitements antirétrovi-
raux et de la prophylaxie des infec-
tions opportunistes allonge la survie
des patients et fait passer à l’état
chronique les séquelles de l’infection
virale de l’immunodépression.
La dénutrition retentit lourdement sur
la qualité de vie et sur les capacités
fonctionnelles des malades, mais
aussi sur leur survie. En effet, indé-
pendamment de l’immunodépression,
la dénutrition est corrélée à un rac-
courcissement de la survie (2). Il a
été clairement démontré que, sous
certaines conditions, le traitement de
la dénutrition permet un allongement
significatif de la survie des patients
sidéens, et ce en l’absence de traite-
ment efficace de la réplication virale
(3). Dans ces conditions, il paraît
légitime qu’une stratégie diagnos-
tique et thérapeutique bien structurée
fasse partie intégrante de la bonne
prise en charge médicale d’un
patient sidéen qui présente un amai-
grissement.
Stratégie diagnostique 01/08/02 15:17 Page 20

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume IV, n°1, février 2000 21
ximative conclut trop rapidement à tort.
L’évaluation des ingestas est fondamentale.
Elle fait partie de l’évaluation de l’état
nutritionnel qui permettra de poser les indi-
cations thérapeutiques. Celle-ci peut et
devrait être complétée par une mesure de la
composition corporelle (impédancemétrie
au lit du malade), qui aide à préciser le type
de dénutrition dont souffre le malade et qui
permettra de suivre sa correction sous l’ef-
fet du traitement. Dans certains cas un peu
particuliers, la mesure de la dépense éner-
gétique de repos permet non seulement de
préciser les besoins des malades, mais
peut, en outre, aider à trancher sur l’exis-
tence d’une infection opportuniste à diffu-
sion systémique (13).
Au total, la stratégie diagnostique devant
un amaigrissement chez un patient sidéen
est simple et, après évaluation de la dénu-
trition elle-même, peut se résumer à la
recherche de trois points :
–recherche et quantification d’une ano-
rexie ;
–recherche d’une malabsorption digestive ;
–recherche directe ou indirecte d’une
infection secondaire associée à un hyper-
métabolisme.
Stratégie thérapeutique
La première des thérapeutiques nutrition-
nelles au cours de l’infection par le VIH
repose sur la prise en charge diététique et
les conseils nutritionnels, auxquels peut
être adjointe une prescription de supplé-
ments diététiques oraux (14). Cette
approche thérapeutique exige du temps et
de la patience, car elle doit en permanence
remotiver le malade dont les efforts n’ar-
rivent pas toujours à venir à bout de son
anorexie, même débutante. Ce n’est qu’à
un stade précoce que cette thérapeutique
peut espérer donner des résultats. Les sti-
mulants de l’appétit sont, en France,
réduits à l’utilisation de progestatifs à forte
dose (400 mg à 1 g par jour de médroxy-
progestérone) (15). Il peut leur être adjoint
un traitement par androgènes à visée ana-
bolisante, qui permettra de s’opposer à la
castration pharmacologique de la prescrip-
tion de progestatifs chez l’homme. Les
androgènes peuvent également compenser
une diminution de la sécrétion naturelle de
testostérone chez le malade dénutri dont la
perte de masse maigre est prédominante.
Le plus puissant et le plus efficace des trai-
tements anabolisants est, sans doute, l’hor-
mone de croissance recombinante, mainte-
nant largement utilisée aux États-Unis,
avec des résultats sur la reprise de masse
maigre et sur les capacités physiques tout à
fait significatifs (16). Ce traitement n’est
pas encore utilisable en Europe, en raison
de son prix qui en constitue un facteur limi-
tant. Les anticytokines, pentoxyfilline, tha-
lidomide, anticorps anti-IL6 pourraient
avoir une place à la frontière des traite-
ments immunomodulateurs et modulateurs
de l’inflammation. La nutrition artificielle
a une place dans les situations où la dénu-
trition est réelle. Elle sera entérale chaque
fois que l’état du tube digestif le permettra
(17). En revanche, l’existence d’une diar-
rhée chronique et/ou d’une malabsorption
justifieront le recours à la nutrition parenté-
rale (18). Ces deux dernières thérapeu-
tiques peuvent être mises en route à l’hôpi-
tal, mais il sera souvent utile de les pour-
suivre au domicile pour obtenir une véri-
table réhabitlitation nutritionnelle, qui
prend souvent plusieurs semaines. Des
structures véritablement entraînées à ce
type de traitement et à ce type de malades
sont alors indispensables en termes de
sécurité et de qualité de traitement. La prise
en charge de la dénutrition au cours des
infections secondaires pose quelques pro-
blèmes particuliers. Il s’agit tout d’abord
de situtations où la dénutrition est non seu-
lement fréquente, mais où l’amaigrisse-
ment est rapide et difficile à limiter. Dans
ces situations, les premiers traitements de
la dénutrition consiste en un traitement
rapide et efficace de l’infection causale,
encore faut-il l’avoir dignostiquée (19). Le
malade est souvent hospitalisé durant les
épisodes infectieux secondaires, aussi est-il
tentant d’en profiter pour le faire bénéficier
d’une nutrition artificielle. En raison des
perturbations métaboliques propres aux
infections aiguës secondaires, l’efficacité
de la nutrition artificielle est souvent limi-
tée dans ces situations. Au contraire,
lorsque l’infection sera contrôlée, la nutri-
tion artificielle est souvent d’une efficacité
spectaculaire (20).
Conclusion
Le chemin est long, de la prévention de
l’amaigrissement chez le sujet séropositif
asymptomatique à la nutrition artificielle
en fin de vie. Dans tous les cas, savoir
accompagner le malade dans sa longue
route, et surtout savoir l’aider à se remoti-
Suppléments Traitements Nutrition Nutrition
diététiques orexigènes entérale parentérale
Ingesta 80 < 80 < 80 < 80
(% besoins)
Poids (% idéal) 90-100 90-100 < 90 < 90
Diarrhée 000 à ++ +++
Traitements si perte de masse si perte de masse ± ? ± ?
anabolisants cellulaire cellulaire
Tableau. Choix thérapeutique de la dénutrition au cours de l’infection par le VIH.
Stratégie diagnostique 01/08/02 15:17 Page 21

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume IV, n°1, février 2000
Stratégie diagnostique
22
ver pour qu’il reste un partenaire actif de sa
prise en charge est une des difficicultés et
un enjeu pour chaque thérapeute (21). Il
faut aussi, au fur et à mesure que la mala-
die avance, savoir garder la confiance du
malade pour lui imposer des traitements de
plus en plus lourds qui doivent toujours
être au bénéfice d’une qualité de vie que
seul le malade est en droit de juger accep-
table ou non. ■
Références
1. Centers for disease control. Classification
system for human T-lymphotropic virus type 1
lymphodenopathy-associated virus infections.
MMWR 1985 ; 35 : 334-9.
2. Kotler D.P., Tierney A.R., Wang J., Pierson
R.E. Magnitude of body cell mass depletion and
the timing of death from wasting in AIDS. Am J
Clin Nutr 1989 ; 50 : 444-7.
3. Melchior J.C., Gelas P., Carbonnel F. et coll.
Improved survival by home total parenteral
nutrition in AIDS patients : follow-up of a
controlled randomized prospective trial. AIDS
1998 ; 12 (3) : 336-7.
4. Nahlen B.L., Chu S.Y., Nwanyanwu R.L.,
Berkelman R.L., Martinez S.A., Rullan J.V. HIV
wasting syndrome in the United States. AIDS
1993 ; 17 : 183-8.
5. Palenicek J.P., Graham N.M.H., He Y.D. et
coll. Weight loss prior to clinical AIDS as a pre-
dictor of survival. J Acquir Immune Defic Syndr
Hum Retrovirol 1995 ; 10 : 366-73.
6.
Melchior J.C., Salmon D., Rigaud D., Leport
C., Bouvet E., Detruchis P., Vilde J.L., Vachon F.,
Coulaud J.P. Apfelbaum M. Resting energy
expenditure is increased in stable, malnourished
HIV-infected patients. Am J Clin Nutr 1991 ;
53 : 437-41.
7. Macallan D.C., McNurlan M.A., Milne E. et
coll. Whole body protein turnover from leucine
kinetics and the response to nutrition in human
immunodeficiency virus infection. Am J Clin
Nutr 1995 ; 61 : 818-26.
8. Hellerstein M.C., Grunfeld C., Wu K. et coll.
Increased de novo lipogenesis in human immu-
nodeficiency virus infection. J Clin Endocrinol
Metab 1993 ; 76 : 559-65.
9. Hommes M.J.T., Romijn J.A., Endert E. et
coll. Insulin sensitivity and insulin clearance in
human immunodeficiency virus infected men.
Metabolism 1991 ; 40 : 651-6.
10. Beisel W.R. Metabolic response to infection.
Annu Rev Med 1975 ; 26 : 9-20.
11. Grunfeld C., Pang M., Shimizu L.,
Shigenada J.K., Jensen P., Feingold K.R.
Resting energy expenditure, caloric intake and
weight change in human immunodeficiency
virus infection and the acquired immunodefi-
ciency syndrome. Am J Clin Nutr 1992 ; 55 :
455-60.
12. Macallan D.C., Noble C., Baldwin C. et coll.
Energy expenditure and human immunodeficiency
virus infection. N Engl J Med 1995 ; 333 : 83-8.
13. Melchior J.C., Raguin G., Boulier A. et coll.
Resting energy expenditure in HIV infected
patients. Comparison between patients with and
without secondary infections. Am J Clin Nutr
1993 ; 57 : 614-20.
14. Pichard C., Kyle U. Conseils alimentaires
lors d’infection par le virus d’immunodeficien-
ce humaine (VIH). Médecine et Hygiène 1992 ;
50 : 589-93.
15. Von Roenn J.H., Murphy R.L., Weber K.M.,
Williams L.M., Weitzman S.A. Megestrol acetate
for treatment of cachexia associated with
human immunodeficiency virus (HIV) infection.
Ann Intern Med 1988 ; 109 : 840-1.
16. Schambelan M., Mulligan K., Grunfeld C.,
Daar E.S. et coll. Recombinant human growth
hormone in patients with HIV-associated was-
ting. A randomized, placebo-controlled trial.
Serostim study group. Annals of Internal Med
1996 ; 125 (11) : 873-82.
17. Ockenga J., Sûttmann U., Selberg O. et coll.
Percutaneous endoscopic gastrostomy in AIDS
and control patients : risk and outcome. Am J
Gastroenterol 1996 ; 9 : 1817-22.
18. Cosnes J., Beaugerie L., Lamy P.,
Garakhanian S., Bellanger J., Gendre J.P., Le
Quintrec Y. Nutrition entérale dans le sida com-
pliqué d’atteinte digestive. Nutr Clin Metabol
1991 ; 5 : 239-46.
19. Kotler D.P., Tierney A.R., Atlilio D., Wang J.,
Pierson R.N. Body mass repletion during gan-
gliovir treatment of cytomegalovirus infections in
patients with the acquired immunodeficiency syn-
drome. Arch Intern Med 1989 ; 149 : 901-5.
20. Melchior J.C., Gelas P., Carbonnel F. et
coll. Improved survival by home total parenteral
nutrition in AIDS patients : follow-up of a
controlled randomized prospective trial. AIDS
1998 ; 12 (3) : 336-7.
21. Melchior J.C., Goulet O. Nutrition et
Infection par le VIH, Masson Ed. Paris, 1996,
288 pages.
Stratégie diagnostique 01/08/02 15:17 Page 22
1
/
3
100%