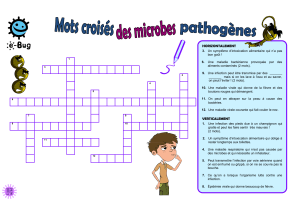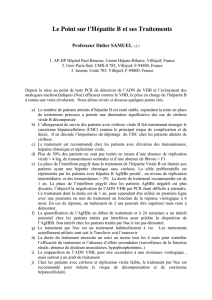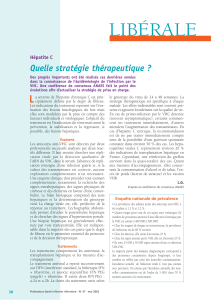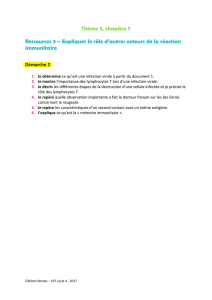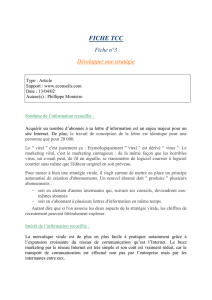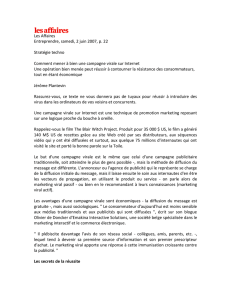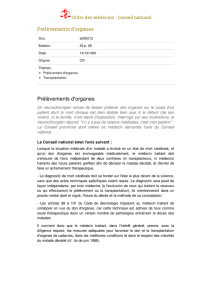Que faire chez les patients atteints de cirrhose virale C et les

Que faire chez les patients
atteints de cirrhose virale C
etlespatientstransplantés?
Management of patients with HCV
cirrhosis and liver transplant recipients
Didier Samuel, Bruno Roche
Centre Hépatobiliaire,
Unité INSERM U 785,
Université Paris-Sud,
Hôpital Paul Brousse,
14 avenue Paul Vaillant-Couturier,
94800 Villejuif, France
e-mail : <[email protected]>
Résumé
La cirrhose virale C est une des principales indications de transplantation
hépatique. Cependant, le risque de réinfection virale après la greffe, quasi
constant, est responsable d’une diminution de survie des patients et des
greffons. Le traitement antiviral C peut être envisagé avant la greffe, afin
de diminuer le risque de récidive virale. Cependant, en cas de cirrhose
décompensée, le traitement est difficile en raison du risque d’effets
secondaires. Le traitement doit être réservé aux patients ayant une bonne
fonction hépatique et des facteurs prédictifs de bonne réponse (génotype,
charge virale). Les mécanismes pathogéniques expliquant les différences
d’évolution observées lors de la récidive virale postgreffe sont mal compris.
L’intervention de facteurs multiples liés au donneur, à l’hôte et au virus
est probable. Les traitements de la récidive C post-transplantation
par interféron pégylé et ribavirine permettent d’obtenir une réponse
virologique prolongée dans environ 30 % des cas et une amélioration de
la survie des patients et des greffons. Les facteurs prédictifs de réponse
sont assez proches : le génotype viral, les cinétiques virales précoces,
l’absence de traitement antérieur, l’adhésion au traitement et la charge
virale prétraitement. Cette population est celle qui devrait bénéficier le
plus des nouveaux traitements antiviraux.
nMots clés : hépatite C, cirrhose, greffe de foie, interféron, ribavirine
Abstract
Liver disease caused by the hepatitis C virus is the main indication for liver
transplantation. However, HCV re-infection after transplantation is cons-
tant and it significantly impairs patient and graft survival. Pretransplant
antiviral therapy may reduce or eliminate the risk of recurrent infection.
However, this approach is limited because of side effects and a risk of
complications in decompensated patients. The best candidates for therapy
are Child-Pugh class A patients and patients with good predictive factors of
response (non-1 genotype and low viral load). Multiple host, donor and
viral factors are associated with fibrosis progression after transplantation.
Treatment of established graft lesions with pegylated interferon and
ribavirin combination therapy gave promising results, with sustained
virological response in around 30% of patients. Sustained virologic respon-
ders had a long-term benefic effect on fibrosis progression and graft and
patient survival. Variables associated with SVR are non-1 genotype,
absence of prior antiviral therapy, early virologic response, adherence to
therapy and low pre-treatment viral load. HCV-infected pre-and post-
HEPATO
n
GASTRO
et Oncologie digestive
Tirés à part : D. Samuel
43
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 supplément 5, novembre 2010
mini-revue
doi: 10.1684/hpg.2010.0470
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

transplant patients are the population which will benefit the most of new
classes of direct antiviral agents.
nKey words: hepatitis C, cirrhosis, liver transplantation, interferon, ribavirin
La cirrhose virale C, associée ou non à un carcinome
hépatocellulaire, est une des principales indications
de transplantation hépatique (TH). Elle représente environ
25 % des indications de greffe en Europe. Cependant, le
risque de réinfection virale après la greffe, quasi constant,
est responsable d’hépatites aiguës ou chroniques pouvant
évoluer vers une cirrhose ou une insuffisance hépatique et
nécessiter une retransplantation [1]. L’infection virale C
diminue la survie des patients et des greffons par rapport
à celle des transplantés non infectés [2]. Les traitements
antiviraux actuels de la cirrhose virale C décompensée
sont difficiles, en raison de leur mauvaise tolérance et de
leur efficacité plus faible. Les traitements de la récidive C
post-transplantation permettent une réponse virologique
prolongée (RVP) dans environ 30 % des cas [3]. Nous allons
décrire dans cette mini-revue les possibilités de traitement
avant et après TH, ainsi que l’histoire naturelle de la
récidive virale C.
Traitement antiviral
en cas de cirrhose décompensée
L’intérêt du traitement antiviral en cas de cirrhose virale C
(tableau 1 ;figure 1) décompensée est de diminuer ou de
stopper la réplication virale, afin, d’une part, d’améliorer la
fonction hépatique et, d’autre part, de réduire ou d’éviter le
risque de récidive postgreffe. Le traitement est d’autant
mieux toléré que la fonction hépatique est meilleure.
Le traitement avec la bithérapie actuelle est difficile chez
le patient cirrhotique en raison de la thrombopénie, de la
leucopénie ; il est globalement moins efficace et peut
exposer à des complications plus sévères. Les résultats du
traitement de la cirrhose Child A, sans hypertension por-
tale, sont peu différents de ceux du traitement des patients
au stade 3 de fibrose. En revanche, en cas d’hypersplénisme
ou de cirrhose décompensée, les choses sont différentes.
Everson et al. [4] ont traité 124 patients ayant une cirrhose C
en attente de TH, avec un score de Child-Pugh moyen de
7,1, par une association d’interféron (IFN) standard et riba-
virine (RBV) à doses croissantes. Une réponse virologique en
fin de traitement a été obtenue pour 46 % des patients et
une RVP pour 22 %. Les facteurs associés à une RVP étaient
un génotype non 1 (50 % versus 13 % pour les génotypes
1), un score de Child A et un traitement à dose et durée
optimales. Une diminution de la dose ou de la durée du
traitement a été nécessaire pour 71 % des patients et un
arrêt du traitement pour 13 %. Vingt-deux complications
sévères sont survenues, conduisant au décès dans 4 cas.
Parmi les 15 patients ARN-VHC-négatif transplantés,
12 sont restés négatifs plus de six mois après la TH. Forns
et al. ont évalué l’efficacité et la tolérance d’un traitement
par IFN et RBV débuté dans les quatre mois précédents la
greffe chez 30 cirrhotiques [5]. Une réponse virologique est
survenue chez 9 patients (30 %). Trois de ces 9 patients,
transplantés avec un ARN-VHC négatif, ont récidivé après
la TH. Plus récemment, l’équipe de Forns a comparé les
résultats du traitement par interféron pégylé (IFN-Peg) et
RBV chez des patients ayant une cirrhose décompenséee
par rapport à un groupe apparié de cirrhotiques non traités.
Dans le groupe traité, le taux de négativation de l’ARN-VHC
sous traitement est de 30 %, cependant le taux de compli-
cations septiques est significativement plus élevé chez les
patients traités [6]. Ce taux de complications septiques est
diminué en cas de prophylaxie par norfloxacine en cours de
traitement. Il apparaît que, si un patient cirrhotique est
transplanté alors qu’il est en RVP, le risque de récidive virale
post-transplantation est nul. Si le patient est transplanté
avec un ARN-VHC négatif dans le sérum, sous traitement,
le risque de récidive est diminué à 30 % après la TH au lieu
de 90 % si l’ARN-VHC est positif. Il y a donc un intérêt à
amener les patients ARN-VHC-négatif au moment de la
transplantation. En résumé, ces différentes études [3-8]
montrent des taux de RVP de 30 %, mais dépendant du
génotype (50 % si génotype 3 ; 10-15 % si génotype 1).
Le traitement est indiqué en cas de cirrhose Child A et s’il
existe des facteurs de bonne réponse virologique (génotype
non 1, faible charge virale…). Le traitement est contre-
indiqué lorsque le score de Child est supérieur à 11 ou le
score de MELD (Mayo End Stage Liver Disease) supérieur
à 18. En cas de cirrhose décompensée, le traitement doit
être discuté au cas par cas. L’utilisation de facteurs de
croissance pourrait améliorer la tolérance du traitement et
une prophylaxie antibiotique pourrait être nécessaire.
Le traitement doit être pris en charge en collaboration
avec une équipe de transplantation hépatique pour deux
raisons : a) le risque de décompensation sous traitement ;
b) l’importance de la réalisation de la TH au moment de la
négativation de l’ARN-VHC.
“
Le traitement antiviral prégreffe
est difficile en cas de cirrhose
décompensée. Il doit être réservé aux patients
ayant les meilleurs facteurs prédictifs
de réponse (score de Child A ; génotype non 1 ;
charge virale faible)
”
Pour bien évaluer l’importance du traitement après TH, il faut
connaître l’histoire naturelle de la récidive virale C post-TH.
44 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 supplément 5, novembre 2010
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Tableau 1. Traitement de l’infection VHC chez les patients avec cirrhose décompensée.
Auteur,
année Patients
Génotype Child-Pugh,
moyen Traitement
Durée
du traitement
(mois)
Réponse virologique
Transplantés
RVP
après TH
n (%) Tolérance
Fin
de traitement
n (%) RVP
n (%)
Crippin,
2002
[7]
15
G1 : 73 % 11,9
+/–1,2 IFN 1 MU/jour
ou 3 MU trois fois
par semaine,
IFN 1 MU/jour + RBV
400 mg/jour
jusqu’àTH
2 5 (33) / 2
(ARN VHC
positif)
0 20 effets secondaires,
2 sepsis (1 décès)
Étude stoppée
Thomas,
2003
[8]
20
G1 : 67 % 10 IFN 5 MU/jour 14 12 (60) / 20 4 (20) GCSF chez les patients
Arrêt 15 %
Everson,
2005
[4]
124
G1 : 70 % 7,4
+/–2,3 Augmentation
progressive de dose
IFN + RBV
6-12 57 (46) 30 (24)
G1 : 13 %
G non 1 : 50 %
47
(15 ARN VHC
négatifs)
12 (26) Réduction dose 71 %,
Arrêt 13 %
5 sepsis
11 décompensations
hépatiques, 2 décès
Forns,
2003
[5]
30
G1: 70 % A : 50 %
B : 43 %
C:7%
IFN 3 MU/jour + RBV
800 mg/jour
Jusqu’àTH
3 9 (30) / 30 6 (20) Réduction dose 60 %,
Arrêt 20 %
2 sepsis
4 décompensations
hépatiques
Carrion,
2009
[6]
51
G1 : 80 % A : 45 %
B : 43 %
C : 12 %
Peg IFN 180 μg/
semaine + RBV :
0,8-1,2 g/jour
jusqu’àTH
3 15 (29) / 51 10 (20) Réduction dose 49 %,
Arrêt 43 %
Décompensation
et décès idem
(15 i 9 et 4 vs 1)
Sepsis plus fréquent
dans groupe traité vs
contrôles (19 vs 3)
51
G1: 82 % A : 43 %
B : 43 %
C : 14 %
Groupe contrôle / 0 0 51 0
RVP : réponse virologique prolongée ; TH : transplantation hépatique ; IFN : interféron ; RBV : ribavirine.
45
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 supplément 5, novembre 2010
Que faire chez les patients atteints de cirrhose virale C et les patients transplantés
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Histoire naturelle de la récidive virale C
La réinfection virale C est quasiment constante (90 %)
pour les patients ayant une réplication virale avant la TH.
L’ARN-VHC peut-être détecté dans le sérum dès les
premières heures post-TH, la charge virale C augmentant
significativement au cours des premiers mois. Une hépatite
aiguë survient entre le premier et le quatrième mois post-
greffe, et évolue vers une hépatite chronique chez 70 à
90 % des patients [9]. Des cas d’hépatite cholestatique,
survenant en général dans les deux premières années
post-TH, sont rapportés avec une fréquence de 2 à 8 %.
Le rôle d’une forte réplication virale C et d’une cytotoxicité
du virus a été suspecté dans ces formes de pronostic sévère.
L’évolution de l’infection virale C sur le greffon est accélé-
rée par rapport aux patients immunocompétents, avec,
notamment, une vitesse accrue de progression de la
fibrose. Il existe une mauvaise corrélation entre les per-
turbations biologiques et les lésions histologiques, ce qui
souligne l’importance d’un suivi histologique systématique.
La fréquence de survenue de cirrhose varie selon les séries
de 10 à 28 % à 5 ans. En cas de cirrhose sur le greffon, le
risque de décompensation est de 40 % par an, avec un
risque de décès de 60 % dans l’année suivant le premier
épisode de décompensation. Cette évolution conduit
àl’indication d’une retransplantation pour environ
10 % des patients.
Les mécanismes pathogéniques expliquant les différences
d’évolution observées selon les patients sont mal compris.
L’intervention de facteurs multiples liés au donneur, à
l’hôte et au virus est probable.
Facteurs déterminant l’évolution
de la récidive virale C
Les facteurs associés à la sévérité de la récidive C sont : une
charge virale prétransplantation élevée (> 10
6
UI/mL) ;
une charge virale à 4 mois post-TH élevée (> 10
7
UI/mL) ;
une récidive sévère déterminée par la biopsie hépatique
à 4 mois ou un an ; un gradient de pression hépatique ou
des marqueurs non invasifs de fibrose élevés à 1 an post-
TH ; des épisodes de rejet aigus traités ; une coïnfection par
le VIH ; un arrêt précoce des corticoïdes ; l’utilisation
d’immunosuppresseurs puissants ; et un âge élevé du
donneur (plus de 40 ans). Les études évaluant le rôle
du génotype du VHC et de la TH à donneur familial sont
contradictoires. Le traitement immunosuppresseur doit
être suffisamment puissant pour prévenir le rejet, mais
non excessif. Il n’a pas été possible de déterminer un impact
éventuel de la cyclosporine ou du tacrolimus sur la récidive
virale C. Les bolus de corticoïdes ainsi que l’arrêt brutal des
corticoïdes dans les premiers mois post-TH sont délétères.
Cependant, les régimes d’immunosuppression sans
corticoïdes n’ont pas montré de bénéfice sur l’évolution
de la fibrose [1].
Traitements antiviraux
de la récidive virale C
En raison du risque évolutif de la récidive virale C, un traitement
doit être discuté. Le traitement est le plus souvent proposé au
stade d’hépatite chronique sur le greffon. D’autres stratégies
24-48 Sem
12–16 Sem
TH
Suivi
Traitement antiviral
Traitement
Suivi
Suivi
TH
ARN VHC négatif à la TH : pas de récidive
ARN VHC négatif à la TH : 30 % de récidive
Réponse virologique
sous traitement
Traitement antiviral selon les modalités habituelles
Traitement antiviral prégreffe immédiat
A
B
Figure 1. Modalités du traitement antiviral C avant transplantation hépatique.
TH : transplantation hépatique ; RVP : réponse virologique prolongée ; Sem : semaines.
46 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 supplément 5, novembre 2010
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

peuvent être envisagées : traitement prophylactique,
traitement post-TH précoce (préemptif). D’une manière
générale, le traitement antiviral a une efficacité et une tolé-
rance plus limitées dans le cadre de la greffe.
Traitement prophylactique
La prophylaxie de la récidive virale C par immunoglobulines
anti-VHC n’a pas donné de résultats positifs.
Traitement antiviral postgreffe précoce
L’intérêt du traitement préemptif (tableau 2), débuté dans
les huit semaines suivant la TH, est d’être débuté lors d’une
phase où la charge virale C est plus faible et la fibrose
absente. Cependant, à cette période, le traitement est
limité par une mauvaise tolérance, un risque accru de rejet
et une forte immunosuppression augmentant le risque
infectieux. Les traitements par IFN standard ou pégylé
avec ou sans RBV ont une efficacité limitée, avec des taux
de RVP autour de 10-20 %. Le traitement préemptif est
limité par une tolérance hématologique médiocre, notam-
ment pour la RBV, et les taux de RVP ne sont pas supérieurs
à ceux qui sont obtenus par un traitement effectué à une
période plus tardive après la TH [10-13].
Traitement antiviral
au stade d’hépatite chronique
Le traitement antiviral est le plus souvent débuté au stade
d’hépatite chronique sur le greffon à un moment ou l’état
général est amélioré (tableau 3). Les traitements par IFN ou
RBV en monothérapie sont peu efficaces avec des taux de
RVP inférieurs à 10 %. Samuel et al. ont rapporté une étude
randomisée comparant 28 patients transplantés traités par
IFN –trois millions d’unités trois fois par semaine –et RBV –
1-1,2 grammes par jour pendant 48 semaines –,et
24 patients contrôles. Une RVP a été obtenue pour 21 %
des patients traités. Un arrêt de l’étude a été nécessaire
pour 43 % des patients traités et 17 % des contrôles. Un
rejet chronique est survenu chez un patient traité [14].
Les traitements associant IFN-Peg et RBV sont supérieurs à
ceux utilisant l’IFN non pégylé. Le traitement associant la
bithérapie IFN-Peg et RBV est donc le standard du traite-
ment chez les transplantés hépatiques. Une précaution
importante est d’adapter la dose de RBV à la clairance de
la créatinine des patients. Il est donc rare de pouvoir dépas-
ser la dose de 1 000 mg/jour, les doses de RBV oscillant
souvent entre 600 et 1 000 mg/jour. En revanche, les doses
d’IFN-Peg sont les mêmes que chez le patient non trans-
planté. Les revues systématiques du traitement IFN-Peg
plus RBV montrent des RVP autour de 30-35 % : 30 %
pour les patients génotypes 1 ; 50-70 % pour les patients
génotype 3. Les facteurs expliquant une réponse viro-
logique plus faible chez les patients transplantés sont : la
non-réponse précédente à un traitement IFN-RBV avant la
TH ; la forte prévalence du génotype 1 ; l’immunosuppres-
sion ; la mauvaise tolérance du traitement et ses effets
secondaires. Les variables associées à la RVP sont : le géno-
type non 1 ; l’absence de traitement antiviral antérieur ; la
réponse virologique précoce et la réponse virologique
rapide ; l’adhésion au traitement ; une charge virale prétrai-
tement faible. L’influence de l’immunosuppression sur la
réponse au traitement n’est pas établie, même si certaines
études suggèrent que la RVP est plus élevée sous traitement
par cyclosporine [3, 15, 16]. Un point important souligné
Tableau 2. Traitement antiviral précoce (préemptif) après transplantation hépatique.
Auteur Nombre
de patients Début de traitement Traitement RVP (%) Arrêt
traitement (%) Rejet (%)
Mazzafero
[10] 36 3 semaines après TH IFN 3 MU x 3/semaine plus
RBV 10 mg/kg/jour, 12 mois 33 %
(G1/4 : 20 % ;
G3/3 : 100 %)
0 (effets
secondaires :
47 %)
0
Chasalani
[11] 26
28 3 semaines après TH PegIFN alfa-2a 180 μg/semaine,
12 mois
versus contrôles
8%
(G1/4 : 5 % ;
G2/3 : 14 %)
0
31 %
32 % 12 %
21 %
Shergill
[12] 44 2-6 semaines après TH IFN 3 MU x 3/semaine, ou pegIFN
+/–RBV 600-1 200 mg/jour,
12 mois
9 % 37 % 40,9 %
Sugawara
[13] 21 4 semaines après TH IFN 3-6 MU x 3/semaine + RBV
400-600 mg/jour, 12 mois
ou plus
39 %
(G1/4 : 33 % ;
G2/3 : 100 %)
29 % 30%
RVP : Réponse virologique prolongée ; TH : transplantation hépatique ; IFN : interféron ; RBV : ribavirine ; G : génotype ; TH : transplantation
hépatique.
47
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 17 supplément 5, novembre 2010
Que faire chez les patients atteints de cirrhose virale C et les patients transplantés
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%