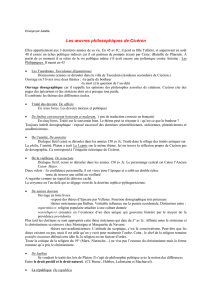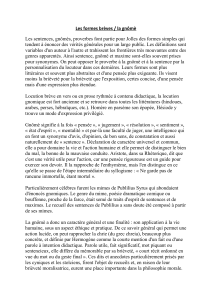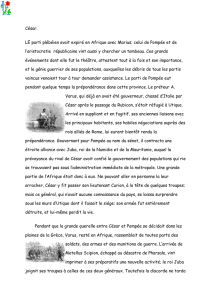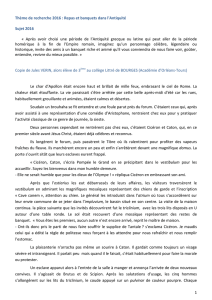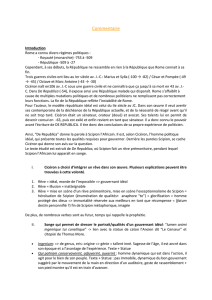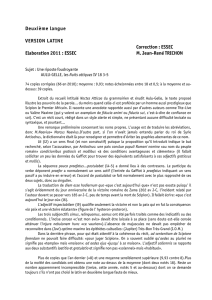Caton l`Ancien - L`Histoire antique des pays et des hommes de la

CATON L’ANCIEN, ÉTUDE BIOGRAPHIQUE
PAR GODEFROID KURTH.
LIÈGE — 1872.
Dissertation inaugurale soutenue devant la Faculté de Philosophie et Lettres en
sa séance solennelle du 7 Juin 1872, à 3 heures de l’après-midi, en présence de
M. LOOMANS, recteur et professeur ordinaire à la Faculté de Philosophie et
Lettres, et sous la présidence de M. SCHWARTZ, doyen et professeur ordinaire à
la même Faculté, pour obtenir le diplôme spécial de docteur en sciences
historiques.

CHAPITRE I. — La jeunesse de Caton.
CHAPITRE II. — L’Édilité, la Préture et le Consulat.
CHAPITRE III. — Caton aux Thermopyles.
CHAPITRE IV. — Luttes politiques.
CHAPITRE V. — La chute des Scipions.
CHAPITRE VI. — La censure.
CHAPITRE VII. — Vie privée de Caton.
CHAPITRE VIII. — Caton au Sénat.
CHAPITRE IX. — Caton écrivain.
CHAPITRE X. — Dernières années de Caton.

CHAPITRE I. — LA JEUNESSE DE CATON.
Manus Porcius Cato naquit dans le municipe de Tusculum
1
, d’une famille
plébéienne tout à fait inconnue avant lui
2
. La maison à laquelle il appartenait
tirait son nom, à ce qu’il semble, de l’élevage des porcs
3
. Elle se divisait en
plusieurs branches, dont les plus anciennes, après celle de notre héros, sont
4
:
1° celle des Licinus, qui fournit plusieurs magistrats à la république ; 2° celle des
Læca, dont un des membres fut l’auteur de la fameuse loi de provocatione
5
. Le
surnom des Catons parait se rattacher, par catus et catulus, à canis, et ferait
allusion au flair, à la sagacité du chien
6
; on le retrouve dans la maison Hostilia
7
,
de même que dans celle des Ælius il y avait des Catus
8
. Plutarque prétend que le
surnom primitif du personnage était Priscus, et qu’il l’échangea plus tard contre
celui de Caton, que lui auraient valu ses qualités personnelles. Mais il est seul à
affirmer ce fait, que Cicéron n’aurait pas manqué de relever à la gloire de son
Romain favori, s’il avait été vrai ; d’ailleurs Plutarque se contredit lui-même, car
il parle d’un autre Caton, bisaïeul du censeur, qui se distingua par sa bravoure
9
.
Il est facile de voir que c’est au contraire le surnom de Priscus qui est d’origine
plus récente, et qu’on l’a donné à notre Caton uniquement pour le distinguer de
son descendant, le fameux adversaire de César
10
. Priscus n’est donc qu’une
simple épithète ; aussi voit-on ce nom placé tantôt avant, tantôt après le nom
gentilice, ce qui ne serait pas le cas si c’était un véritable surnom
11
. Autant
vaudrait dire que le surnom de Caton était Superior, comme l’appelle Valère
1
Plutarque, Caton, 1 et Comp. Ar. cum Caton, 1 ; Corn. Nepos, Caton, 1 ; Cicéron, de
Legg. 2, 2, 5 ; p. Planc., 8, 20 ; p. Sull., 7, 23 et schol. bobb. ad l. ; de Rep., 1, 1, 1 ;
Velleius Paterculus, 2, 128, 2 ; Valère Maxime, 3, 4, 6 ; Aulu-Gelle, 13, 24 (23) ;
Aurelius Victor, V, I, 1, 47 ; Ammien Marcellin, 16, 5.
2
Plutarque, 1 ; Cicéron, Rep., 1, 1 ; Verr., 5, 70, 180 ; Valère Maxime, 3, 2, 16 et 3, 4,
6 ; Velleius Paterculus, 2, 35, 2 ; Ælien, 12, 6 et 14, 36.
3
Un grand nombre de noms gentilices sont dérivés de circonstances analogues ; ainsi il
y avait des Ovilius, des Caprilius, des Taurus. Voir Drumann, in init.
4
On connaît encore des Porcius Latro et des Porcius Septiminus. Il sera parlé plus bas
des Porcius Priscus.
5
Drumann, l. l.
6
Plutarque, 1. Caton, dit Ampère, est la forme sabine de Catus (IV, p. 266.)
7
Pour éviter la répétition des mots latins, je traduirai par maison le mot gens, et par
famille celui de familia.
8
Drumann fait observer que le mot n’a rien de commun avec cautus, qui vient de
cavere.
9
Drumann se donne la peine de combattre Plutarque, sans remarquer cette
contradiction, qui n’a pas échappé à Van Bolhuys. Il est d’ailleurs incontestable que le
cognomen n’était pas obligatoire, et que plus d’une fois on a vu des personnages en
prendre un autre. (Mommsen, Römische Forschungen, 1, p. 50). De plus, le cognomen
n’était héréditaire que dans la noblesse de Rome et des municipes ; il suit de là que
Caton, si réellement il a hérité son nom de son bisaïeul, appartenait à une famille noble
de Tusculum. Id., ibid., p. 56 ; Bekker und Marquardt, I, p. 17.
10
V. Acro ad Horace, Odes, 3, 21,11 : Prisci, antiquioris, non Uticensis.
11
Du moins peut-on dire que les surnoms qui se placent indifféremment avant ou après
le nom gentilice sont l’infime minorité. — V. Horace, Odes, 3, 21, 11 : Prisci Catonis.
Epist. 2, 2, 117 : Priscis Catonibus atque Cethegis. Sulpicia, sat. v. 48.

Maxime
1
évidemment dans le but de le distinguer de Caton d’Utique, ou Major,
qui se trouve dans le titre du De Senectute de Cicéron, ou encore Senex, comme
il est fréquemment nommé, de même qu’Ennius et d’autres de ses
contemporains, par les écrivains postérieurs
2
.
Ce qui a pu contribuer à l’erreur de Plutarque, ou de l’historien latin auquel il a
probablement emprunté ce détail, c’est que Priscus était un véritable surnom
3
, et
qu’il appartenait même à une famille de la maison Porcia, comme le prouvent
deux inscriptions de Gruter
4
. Mais cette famille ne semble pas avoir joué de rôle
dans l’histoire, et il n’est jamais question d’elle chez aucun écrivain. Faudrait-il
s’étonner qu’un historien, connaissant l’existence des Porcius Prisons, et
rencontrant le mémo surnom accolé au nom de notre héros, eût cru que ce
dernier appartenait à la même famille
Un second cognomen de Caton, c’est celui de Censorius
5
ou plus rarement
Censor
6
, qui lui vient de l’éclat avec lequel il avait géré la censure
7
. Au lieu de
Censorius, on lit aussi Orator
8
, en souvenir des nombreux discours qu’il a écrits
ou prononcés, ou Sapiens
9
, à cause de son expérience des affaires.
Malgré les contradictions des anciens, on peut fixer avec assez de certitude la
date de la naissance de Caton. On sait par des témoignages positifs qu’en 149, il
accusa devant le peuple Servius Galba
10
; ce fut aussi, d’après Cicéron qui sur
ce point n’a jamais été démenti, la date de sa mort. Il avait alors, selon l’orateur,
85 ans ; par con, séquent il serait né en 234. Mais ici commence le désaccord.
Tite-Live, et avec lui Plutarque, disent formellement qu’il avait 90 ans quand il
accusa Galba, ce qui reporterait sa naissance à l’année 239, et Valère Maxime,
sans être aussi explicite, semble cependant être du même avis
11
. Il n’y a pas à
1
Valère Maxime, 3, 2, 16 ; 3, 7, 7 ; 4, 3, 11 ; 8, 15, 2. Cf. 3, 4, 6, où Caton d’Utique est
appelé posterior Cato.
2
Cicéron, p. Sull., 7, 23 ; de off., 2, 25 ; de Rep., 2, 1 ; Charis. p. 202 K ; id., pp. 206,
215, 219 ; Cæcil. Balb. de nug. phil., éd. Wöllflin, p. 13.
3
Suétone, Tibère, 42, et Pline le Jeune, dont plusieurs correspondants portent le nom de
Priscus. Prisci, dit Niebuhr, était le nom propre des conquérants aborigènes, qui devint
plus tard adjectif, de même que Casci. (Hist. Rom., introd.)
4
Thesaurus Inscriptionum, p. 458, 6, et surtout 121, 1. Cette dernière inscription est
reproduite et commentée par Gesner dans son édition du Re Rustica de Caton.
5
Pline, H. N., præf. 26 ; 7, 12 et 31 ; 19, 6 ; 36, 53 ; Aulu-Gelle, 13, 9, 6 et 13, 23 ;
Tacite, Ann., 3, 66 ; Sénèque, ep. 87 ; Florus, 2, 17, 19 ; Quintilien, 1, 17, 23 ; 3, 1, 19
; 9, 4, 39 ; 12, 1, 35 ; 12, 11, 23. Dans Aurelius Victor on lit Censorinus, mais peut-être
la leçon est-elle fautive, de même que dans Gruter p. 458, 4.
6
Pline, H. N., 8, 78.
7
C’est l’opinion générale. Ammien Marcellin, 16, 5, est d’un autre avis : Tusculanus
Cato, cui Censorii cognomen castior vitæ indidit cultus.
8
Justin, 33, 21.
9
Cicéron, de amic., 2 : Cato quia multarum rerum usum habebat, multa ejus et in
senatu et in fore vel acta constanter vel responsa prudenter ; propterea quasi cognomen
jam habebat in senatu sapientis. L’idée de sagesse philosophique n’était nullement
contenue dans ce mot, pas plus que dans celui de Cato. — V. encore Cicéron, Verr., 2, 2,
et 5, 70 ; Legg. Agr., 2, 24 ; de Legg., 2, 2 ; de off., 3, 4 ; Aulu-Gelle, 14, 2, 21 ;
Quintilien, 12, 7, 4 ; Tertullien, Apologétique, 11.
10
Tite-Live, 39, 40 ; Plutarque, 15 ; Cicéron, Brut., 15, 61, et 20, 80 et 90 ; Valère
Maxime, 8, 7, 1 ; Aurelius Victor, 47 ; Pline, 14, 44 et 29, 12 ; Velleius Paterculus, 1, 13.
11
Valère Maxime, 8, 7, 1 : Cato sextuor et octogesimum annum agens.... ab inimicis
capitali crimine accusatus suam causam egit.... Quin etiam in ipso diutissime actæ vitæ
fini disertissimi oratoris Galbæ accusation defensionem suam pro Hispania opposuit. Au

balancer ; la date donnée par Cicéron est la seule exacte. D’abord elle s’accorde
parfaitement avec les autres renseignements qu’il fournit ailleurs ; ainsi, il fait
naître Caton un an avant le premier consulat de Fabius en 233
1
, et il lui donne
65 ans à l’époque où il parla pour la loi Voconia
2
, que l’on est convenu de placer
en 169. Elle est de plus confirmée par Pline, qui fait également mourir Caton en
149, à 85 ans
3
, et, ce qui est bien plus concluant, par Caton lui-même. En effet,
dans un passage conservé par Plutarque
4
, il raconte qu’il porta les armes pour la
première fois à 17 ans, alors qu’Annibal pillait et désolait l’Italie. D’après Tite-
Live et Plutarque, lequel, ici encore, se contredit lui-même, ce serait en 222 ;
d’après Cicéron et Pline, en 217. Voilà qui tranche la difficulté, car Annibal
n’entreprit sa campagne contre Rome qu’en 218. On voit que Tite-Live a suivi
des annales autres que celles où a puisé Cicéron : il serait oiseux de vouloir
corriger son texte, qui ne présente pas la moindre variante à ce sujet
5
.
La famille de Caton appartenait à cette forte race de paysans sabins qui, après
avoir fertilisé le Latium, colonisa une bonne partie de l’Italie, et y a laissé
d’impérissables souvenirs de son activité et de sa vigueur. Obscurs et ignorés,
ses aïeux n’avaient jamais tiré l’épée que pour courir aux frontières ; la guerre
terminée, ils revenaient labourer leurs champs, sans prétendre aux dignités de la
république. Aussi Caton était-il un homme nouveau dans la pleine acception du
mot, un auctor generis ou princeps familiæ, comme on appelait chez les Romains
ceux qui, les premiers dans leurs familles, s’étaient élevés aux magistratures
curules. Mais, quoique aux yeux de l’orgueilleuse noblesse du temps une
extraction si basse fût un sujet de mépris, Caton était loin d’en rougir : avec cet
âpre orgueil du plébéien parvenu, qui ne le cède en rien à celui du noble, il disait
qu’a la vérité il était un homme nouveau dans les magistratures et dans les
honneurs, mais que par les exploits et les vertus de ses ancêtres, sa famille était
au contraire fort ancienne. Et il citait à ce propos son aïeul, dont la valeur
guerrière avait été honorée de plusieurs récompenses
6
, et qui, ayant eu cinq
chevaux de bataille tués sous lui, en avait été indemnisé aux frais de l’État. Il
parlait aussi de son père Marcus comme d’un homme de courage et d’un
excellent soldat
7
.
reste quel fonds y a-t-il à faire sur un écrivain qui dénature à ce point les faits les mieux
connus ? Quant à Aurelius Victor, il garde une réserve prudente : Galbam octogenarius
accusavit. Cela peut s’interpréter de plus d’une manière.
1
De Senect., 4, 10.
2
De Senect., 5, 14.
3
H. N., 29, 12.
4
Plutarque, Caton, 1.
5
Drakenborch ad Tite-Live, 39, 40.
6
Ce serait bien dans la seconde guerre contre les Samnites, s’il est permis de hasarder
une conjecture. Au reste, je ferai remarquer que Sintenis, dans son édition du Caton de
Plutarque, a commis une singulière inadvertance. Il écrit avec tout le monde άριστείων,
ce qui ne peut être autre chose que le gén. plur. de άριστεΐον = récompense accordée au
courage, et dans sa note il le prend pour le gén. plur. de άριστεία, qui signifie exploit, et
qu’il devrait tout au moins écrire άριστειών, s’il voulait absolument se permettre un
changement de texte d’ailleurs injustifiable.
7
C’était sans doute dans son discours contre un certain Cornelius, dont il est question
dans la harangue de Sumptu suo. Majorum benefacta perlecta, dein de quæ ego pro
republica fecissem perleguntur. Cf. Tite-Live, 3, 56, où Appius rappelle aussi les hauts
faits de sa famille dans son discours.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
1
/
129
100%