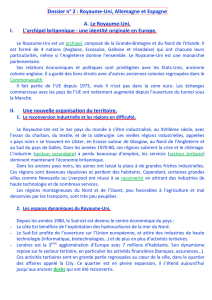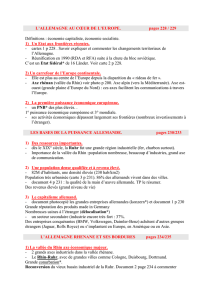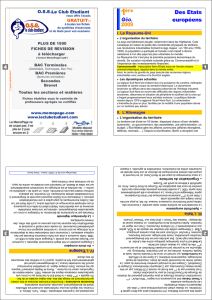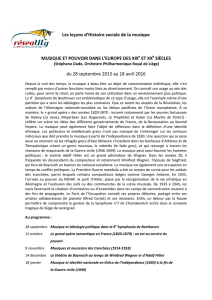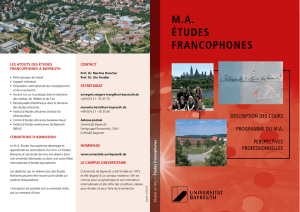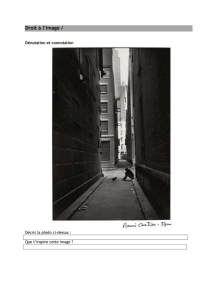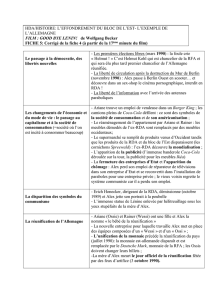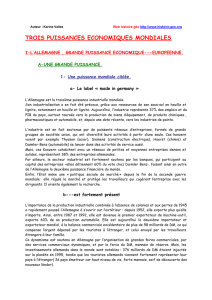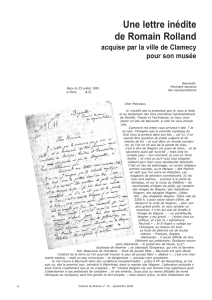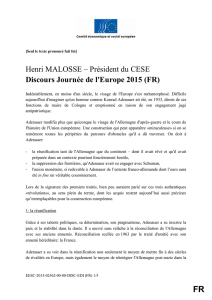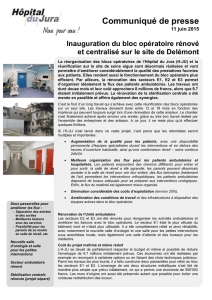Bayreuth après la réunification

Prix Peter Färber
2013
Mathis Degroote
Lycée Berthollet
03/08/2013 – 30/08/2013
Bayreuth après la réunification :
aubaine ou paupérisation ?

« Ce sont les hommes qui font l’histoire, mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils
font » Raymond Aron
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » Isaac Newton

Bayreuth après la réunification : aubaine ou paupérisation ?
Qui suis-je ?
Je m’appelle Mathis Degroote. Je suis en deuxième année de classe préparatoire HEC au lycée Berthollet.
Etudiant l’Allemand depuis la classe de quatrième, je ne suis pourtant jamais resté plus d’une semaine outre-
Rhin.
Le prix Peter Färber m’a fourni l’opportunité de partir en Allemagne (en Bavière) pendant quatre semaines et
de découvrir ce pays et ses habitants.
Je suis très intéressé par l’économie et l’histoire, et ce projet de recherches m'a permis en quelque sorte de
joindre l’utile à l’agréable.
3

Bayreuth après la réunification : aubaine ou paupérisation ?
Introduction :
ela fera bientôt vingt-cinq ans qu’il est possible de parler d’Allemagne au singulier. Ce changement a
marqué l’histoire économique récente outre-Rhin.
C
Mais si un mur est tombé à Berlin, il existe encore un mur dans la tête des Allemands. Ainsi les Allemands
sont mutuellement persuadés que c’est de l’autre côté du mur qu’on a le plus profité de la réunification.
Cette question d’incompréhension et de relation avec ce qui a été un adversaire idéologique n’est pas
inintéressante lorsqu’on s’intéresse aux relations franco-allemandes.
L’histoire de la réunification allemande est d’abord l’histoire d’une frontière. Une frontière tracée par les
Alliés durant l’été 1945, lors de la conférence de Potsdam. Celle-ci, à l’origine ne devant être que temporaire,
est une simple ligne de démarcation entre des zones d’occupation.
Les premières années d’après-guerre sont marquées en Allemagne par de nombreuses pénuries. Très vite,
les Occidentaux prennent conscience de la nécessité d’un développement industriel allemand (le
communisme selon eux se développant « seulement sur des tissus malades »). Pour y parvenir, ils estiment
nécessaire, en 1947 d’unir les zones d’occupation américaine et britannique pour former la « Bizone » ; puis
l’année suivante la « Trizone », avec le rattachement de la zone française. Mais dans le même temps, les
Soviétiques refusent d’adopter la même politique économique que les Occidentaux. Staline, souhaitant
étendre sa domination vers l’Ouest, met en place le blocus de Berlin. Toutes les voies de communication en
direction de Berlin-Ouest sont coupées. Si cette opération se révèle un échec pour les Soviétiques, du fait du
formidable pont aérien mis en place par les Alliés, le blocus consomme le divorce entre les deux Allemagnes.
Le 23 mai 1949 la République Fédérale d’Allemagne est déclarée, et le 7 octobre 1949 la République
démocratique allemande est proclamée.
L’Allemagne est donc divisée entre une « économie sociale de marché » capitaliste à l’Ouest et une économie
collectivisée et communiste à l’Est. Les premières années de ces deux régimes furent marquées par le
développement d’un antagonisme de plus en plus profond entre les deux Allemagnes. A l’Est le SED, à grand
renfort de propagande, présentait la RFA comme un pays
fasciste. A l’Ouest, une économie sociale de marché se
développe et la CDU, alors au pouvoir, refuse toute relation
avec le communisme. Le miracle économique allemand (de
l’Ouest) contraste alors avec les difficultés que rencontre la
RDA, engendrant un déplacement massif de population d’Est
en Ouest, via Berlin, seul point de passage encore ouvert sur le
rideau de fer. Pour arrêter cette hémorragie de travailleurs, le
plus souvent qualifiés, l’Allemagne de l’Est décide en 1961,
sous l’impulsion de son président Walter Ulbricht, de
construire un « mur antifasciste » autour de Berlin-Ouest.
4

Bayreuth après la réunification : aubaine ou paupérisation ?
Ce n’est qu’en 1969, avec l’arrivée au pouvoir de Willy Brandt (SPD),
que débutèrent les relations inter-allemandes. L’ancien maire de
Berlin met ainsi en place une politique de main-tendue vers l'Est
(l’Ostpolitik) qui, entre autres, facilitera les franchissements de la
frontière par les Allemands de l’Ouest.
L’économie Est-allemande, déjà en équilibre précaire, s’enfonce petit
à petit dans une crise structurelle. A la crise économique se joint très
vite une crise politique, qui se manifeste par de grands
rassemblements populaires, comme par exemple les «
Montagsdemonstrationen » à Leipzig.
C’est dans un grand désordre politique au sommet de la RDA que, le
soir du 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. De nombreux
Allemands de l’Est passent alors la frontière, pour découvrir un
monde qu’ils n’avaient pu qu’entrevoir clandestinement via la
télévision Ouest-allemande.
Dans les jours qui suivent, le SED se délite et nomme à sa tête Hans
Modrow qui organise en mars 1990 les premières élections libres et
multipartites en RDA. Elles furent remportées par une alliance
conservatrice (« Allianz für Deutschland ») qui se prononça pour une réunification rapide fixée au mois
d’Octobre.
Le 3 Octobre 1990, l’Allemagne est réunifiée. L’ancienne RFA se voit donc adjoindre cinq nouveaux Länder, au
niveau économique bien inférieur. Passé l’euphorie de la réunification, cet évènement majeur de l’histoire
allemande soulève des questions. Les « paysages fleurissants » promis par le chancelier de l’époque Helmut
Kohl peinent à se dessiner. A l’Ouest aussi des voix s’élèvent, critiquant le coût, le chômage, la concurrence
engendrée par la réunification.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%