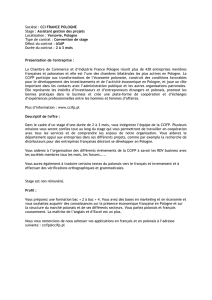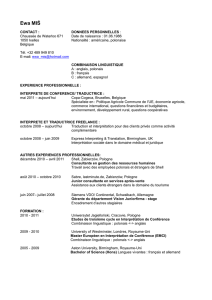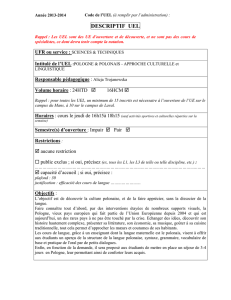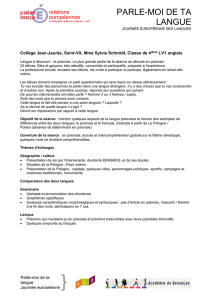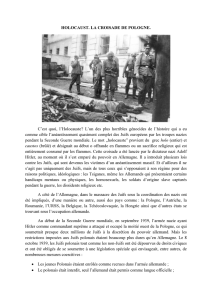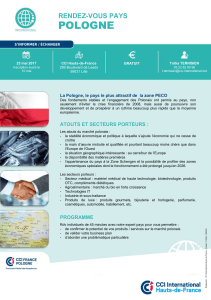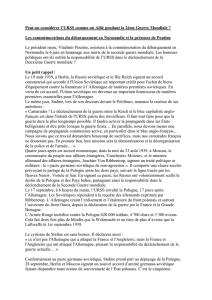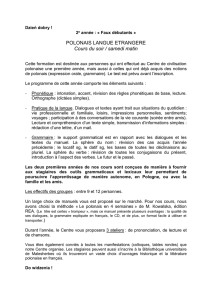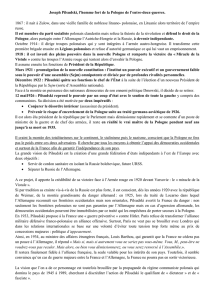Présentation

Histoire de la
Pologne, des
origines à nos jours
Sixième cours :
D’une dictature à l’autre
(1935-1954)

Sixième cours :
1 —Le régime des colonels (1935-1939)
2 —La Pologne en guerre (1939-1945)
3 —De la « libération » à la stalinisation (1945-
1956)

1 —Le régime des colonels
(1935-1939)
•Àsa mort, Piłsudki fut élevé au rang d’objet de culte national,
alors que le régime connut une radicalisation allant dans le
sens d’un accroissement de l’aspect corporatiste du régime.
•Il ne s’agit pas d’une rupture, car au fil du règne de Piłsudki,
cette dérive autoritaire s’était graduellement manifestée.
•Mais 1935 voit un tournant significatif, car les modifications
alors apportées à la loi électorale, réduisant le nombre de
députés e d’électeurs pavent la voie à l’élection d’un
parlement peu représentatif et contrôlé par le pouvoir.
•Le caractère fictif du parlementarisme, déjà manifeste lors
des élections de 1930, devint évident lors du scrutin de
septembre 1935.

•45 %des électeurs prirent part au processus, boycotté par la
gauche et le BBWR, qui deviendra l’OZN (Camp de l’unité
nationale), encore plus inféodé au pouvoir, remporta 153 des
208 sièges de la Diète et 60 des 64 sièges du Sénat...
•Même si, par la constitution d’avril, le président Mościcki,
proche de Piłsudki, disposait de plus de pouvoirs, ses
capacités à influer sur l’évolution politique du pays étaient
limitées par la personnalisation croissante du régime autour
des chefs de l’armée, dont Edward Rydz-Śmigły, mais aussi
du colonel Joseph Beck, maître de la politique étrangère.
•Expulsé du jeu politique, les autres forces sociales
accroissent alors leur activisme par le biais de grèves et de
manifestations (plus de 4 millions de travailleurs participeront
aux grèves en 1936) auxquelles répond la répression
•La gauche parvient à canaliser la colère populaire car la
situation économique demeure alors difficile s, malgré les
efforts du gouvernement et l’amélioration de la conjoncture
internationale.

•Car le capitalisme polonais de l’époque constitue la
prolongation de l’économie féodale : la répartition des
richesses demeure très inégalitaire et très concentrée.
•Les descendants de la szlachta continuent de dominer et
60 000 personnes se trouvent à la tête de plus du quart des
terres arables du pays, en plus de contrôler la majeure partie
du secteur agroalimentaire.
• L’Église aussi participait de façon importante à l’économie
agraire, contrôlant près de 5 % des terres et forêts du pays.
•La politique industrielle favorise les grandes fortunes déjà
établies, particulièrement grâce à une politique de
réarmement très active et très avantageuse aux intérêts des
grands industriels de la métallurgie
•Lorsque le président, en 1938, inquiet de la dérive militariste,
tentera de se rapprocher de forces politiques centristes, il
constatera que la répression politique ne lui laissait guère
d’allié potentiel.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
1
/
63
100%