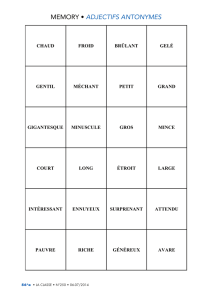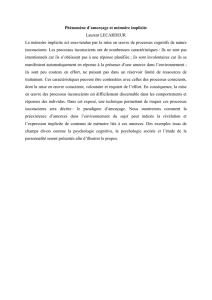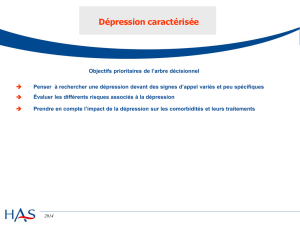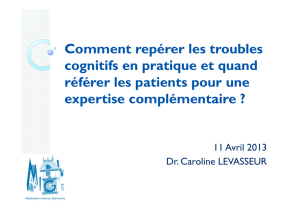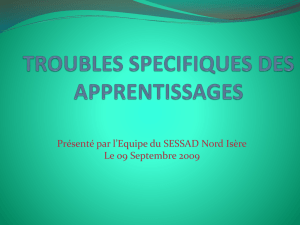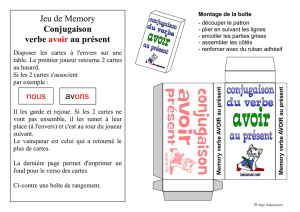Biais mnésique associé à l`humeur dépressive : quelques réflexions

242
L’Encéphale,
33 :
2007, Mai-Juin, cahier 1
MÉMOIRE ORIGINAL
Biais mnésique associé à l’humeur dépressive :
quelques réflexions critiques
F. COLOMBEL
(1)
(1) Université Paris-Sud XI, CRESS, équipe « Psychologie des Pratiques Physiques », bâtiment 335, 91405 Orsay cedex.
Travail reçu le 1
er
décembre 2005 et accepté le 18 janvier 2006.
Tirés à part :
F. Colombel (à l’adresse ci-dessus).
Memory bias and depression : a critical commentary
Summary.
The purpose of this paper is to describe experiments or theoretical studies which are interested in the depres-
sive mood effect on the emotional information processing. More precisely, our goal is to determine which factors govern
the emergence of a memory bias in depression.
Literature findings –
Numerous authors revealed a phenomenon called
« mood congruence memory » by which congruent information is better memorized than non-congruent information.
Hence, this phenomenon means that memory efficiency is biased by the congruence of the material to memorize and
the emotional state. The corpus of research in this area is considerable and our purpose is not to describe it exhaustively
but to indicate the different methodological approaches. The first part of this paper deals with the presentation of the
studies written by the late 1980s. Mood-congruent bias seems to be a reliable phenomenon in depressed subjects espe-
cially in explicit memory tasks (
ie
tasks where subjects are consciously trying to retrieve information in carrying out the
tasks) such as free recall or recognition
(11, 20, 39).
By the 1990s, several authors developed an alternative cognitive
view of depression, using Graf and Mandler’s distinction between integration (
ie
activation or priming) and elaboration
(23).
According to these authors, integration is demonstrated when a past experience facilitates performance on a task
which does not require deliberate recollection of that experience. In contrast, elaboration is a strategic process, comprising
the linking of a word to other material in memory to form new relationships. Elaboration can be assessed by an explicit
memory task such as free or cued recall. Taken together, a part of the results
(19, 20, 24, 26, 39)
confirmed the presence
of an explicit but not an implicit memory bias in depression. However, as Roediger and McDermott
(33)
pointed out, the
interpretation of non-significant findings in implicit memory tends to be uncertain. Watkins et al.
(39)
themselves advocated
a hint of a mood-congruity effect in the implicit task. Obviously, their implicit memory results required corroboration of
other implicit memory measures. Recently, several others recent studies, using the same kind of tasks, have found evi-
dence of an implicit memory bias in depression
(16, 34, 35, 40).
So, it is apparent that the above studies have yielded
variable findings. Thus, there is evidence indicating that several different memory processes may contribute to implicit
memory tasks performance. Given this discrepant evidence of implicit memory bias, few authors
(10, 13, 14, 17)
decided
to investigate the issue further and used a primed lexical decision task with both sub- and suprathreshold priming as a
measure of implicit memory. Indeed, unlike the word completion task (see 9, 31, 36 for reviews), it permits the separate
the contributions of automatic and strategic processes. If priming occurs due to subthreshold presentation, when subject’s
awareness of the primes is restricted, then this would indicate that the priming effect is automatic and independent of
conscious, strategic processes. On the other hand, if priming occurs with suprathreshold presentation (
ie
when primes
are within awareness), then the priming effect may involve both automatic and strategic processes. In this view, Bradley
et al.
(10, 13, 14)
are the first who used a primed lexical decision task with both sub and suprathreshold priming to inves-
tigate the memory bias in depression. Results from these three studies indicate that non-clinical depressed individuals
showed a depression-congruent implicit memory bias in the subthreshold but not in the suprathreshold priming condition,

L’Encéphale, 2007 ;
33 :
242-8, cahier 1 Biais mnésique associé à l’humeur dépressive : quelques réflexions critiques
243
Résumé.
Cet article a pour objectif de rendre compte des
recherches empiriques s’intéressant aux influences de
l’humeur dépressive sur le traitement de l’information émo-
tionnelle. Plus précisément, il cherche à déterminer, à travers
les recherches disponibles, quels sont les facteurs qui pré-
sident à l’émergence d’un effet de congruence avec l’humeur
dépressive. Le corpus de recherches dans ce domaine est
très important et l’objectif n’est pas ici d’en rendre compte de
manière exhaustive mais plutôt d’indiquer les différentes
approches méthodologiques utilisées. Ainsi, il s’avère que de
nombreuses recherches observent l’émergence d’un biais
mnésique associé à la dépression en situation de mémori-
sation explicite. Cependant, les résultats concernant la
mémoire implicite sont relativement nouveaux et l’interpréta-
tion de la nature des processus associés à cette situation est
beaucoup plus controversée
(15).
Aussi, le biais mnésique
observé dans certaines expériences n’a-t-il pu être interprété
comme étant la preuve de la mise en jeu de processus exclu-
sivement automatiques. Finalement, quelques recherches
récentes
(10, 13, 14, 17)
ont révélé l’apparition de l’effet de
congruence avec l’humeur dépressive dans la condition
d’amorçage subliminal, et permet donc de proposer que la
mise en jeu de processus automatiques soit responsable de
son apparition. Ainsi semble-t-il possible, à l’issue de cette
revue de questions, de soutenir l’idée que le biais mnésique
associé à la dépression apparaît de manière automatique,
ou à tout le moins dans des conditions où les processus cogni-
tifs impliqués sont à forte composante automatique.
Mots clés :
Biais mnésique ; Cognition ; Dépression ; Émotion ;
Mémoire explicite ; Mémoire implicite.
INTRODUCTION
De par sa réussite incontestable dans l’étude des acti-
vités centrales, la psychologie cognitive a posé les bases
d’un renouveau de la recherche sur les émotions. D’une
manière très générale, trois types de biais cognitifs dus à
des émotions sont généralement décrits : les biais d’inter-
prétation, les biais attentionnels et les biais mnésiques.
Dans la littérature, les deux premiers sont le plus souvent
associés à l’anxiété. En revanche, les troisièmes, aux-
quels nous allons nous intéresser, sont particulièrement
bien observés chez les sujets dépressifs. Une attention
particulière sera également portée à l’anxiété, cette der-
nière étant très fréquemment associée à l’humeur dépres-
sive. Ainsi, il sera possible de dissocier ses effets éven-
tuels de ceux liés spécifiquement à la dépression.
Avant d’aller plus avant, il paraît indispensable de défi-
nir les concepts d’émotion, d’humeur et de dépression,
puis d’établir clairement leurs distinctions. Ainsi, selon
Kirouac (25), il est usuel de désigner par « processus
affectifs » tous les états qui font appel à des sensations
de plaisir et déplaisir liées à la tonalité agréable/désagréa-
ble. Émotions, humeurs et sentiments pourraient alors se
regrouper sous le simple vocable d’états affectifs. Cepen-
dant, le terme « d’émotion » est plus souvent utilisé en
référence à un état affectif bref et intense, alors que les
termes « d’humeur » ou « d’état » sont utilisés pour
décrire un état affectif moins intense mais plus prolongé.
Par ailleurs, le terme de dépression est répertorié par
l’association américaine de psychiatrie [DSM IV (1)] dans
la catégorie des troubles de l’humeur. De ce fait, en réfé-
rence à ces définitions, nous utiliserons indifféremment les
termes de dépression, d’humeur dépressive ou même
d’état émotionnel.
Selon l’effet de congruence avec l’humeur, on observe
une meilleure mémorisation de l’information congruente,
c’est-à-dire voisine ou identique à l’état d’humeur ponctuel
du sujet. Cet effet implique que l’efficacité de la mémori-
sation est biaisée par la congruence entre l’état émotion-
nel du sujet et la valence émotionnelle du matériel étudié.
Il s’avère que l’émergence d’un effet de congruence asso-
cié à l’humeur dépressive a été mise en évidence dans
des conditions parfois confuses. En effet, le corpus de
recherches dans ce domaine est très important et si notre
objectif n’est pas d’en rendre compte ici de manière
exhaustive, il est plutôt d’indiquer les différentes appro-
ches théoriques et méthodologiques utilisées.
RECHERCHES EN MÉMOIRE EXPLICITE
DES ANNÉES 1980
D’une manière générale, ces recherches consistent à
présenter aux sujets une série de mots ou de phrases qui
varient du point de vue de leur valence émotionnelle et à
en demander un rappel un peu plus tard. Les indices de
mémoire incluent généralement l’exactitude du rappel,
l’exactitude de la reconnaissance ou la vitesse de rappel
et opposent toujours les données correspondant au maté-
riel positif à celles correspondant au matériel négatif. Cer-
taines recherches utilisent des sujets non cliniques, le plus
souvent des étudiants, dont le niveau de dépression a été
auto-évalué à l’aide d’un questionnaire du type du
Beck
Depression Inventory
[BDI (7, 22, 30)]. On parle alors de
sujets dépressifs non cliniques ou encore de dysphori-
ques. D’autres s’intéressent à des individus pour lesquels
while clinically depressed individuals showed such a bias in both priming conditions. The study of Colombel et al.
(17),
using a non-clinical sample, confirmed these results suggesting that the lack of depression-congruent effect in suprathres-
hold priming for non-clinical subjects might be due to the use of strategic processes which counteract the negative bias
in automatic priming found in the subthreshold condition.
Key words :
Cognition ; Depression ; Emotion ; Explicit memory ; Implicit memory ; Memory bias.

F. Colombel L’Encéphale, 2007 ;
33 :
242-8, cahier 1
244
un diagnostic psychiatrique de dépression a été porté (11,
12). Toutes ces recherches, excepté celles de Gotlib et
Mc Cann (22) et de Pietromonaco et Markus (30), mettent
en évidence un plus faible rappel des informations positi-
ves et/ou un meilleur rappel des informations négatives.
Sur la base de ces résultats, différents auteurs (8, 18, 21)
englobent les recherches impliquant des sujets cliniques
et non cliniques et concluent en faveur de la mise en évi-
dence d’un effet de congruence avec l’humeur, associé à
la dépression. Néanmoins, la méta-analyse conduite par
Matt
et al.
(28) sur l’effet de congruence avec l’humeur éta-
blit des conclusions quelque peu différentes. En effet, si
elle met également en évidence une moins bonne mémo-
risation des items positifs pour les sujets dysphoriques par
rapport au groupe contrôle, elle ne montre globalement
pas de différence de rappel pour le matériel négatif entre
ces mêmes sujets. Les sujets dysphoriques, selon Matt
et al.
, mémorisent aussi bien l’information positive que
négative. Par ailleurs, les sujets cliniques impliqués dans
les différentes études incluses dans la méta-analyse de
Matt
et al.
rappellent significativement moins d’items posi-
tifs et plus d’items négatifs que les sujets contrôles. Selon
Matt
et al.
(28), les sujets dysphoriques comme les sujets
cliniques ne se comportent pas de la même manière que
les sujets contrôles. La valence émotionnelle agit donc de
manière différentielle. Cependant, si un effet de con-
gruence est clairement mis en évidence chez les sujets
dépressifs cliniques, ce n’est pas le cas des sujets dys-
phoriques. En effet, si ces derniers se différencient du
groupe contrôle du point de vue du matériel positif, ce n’est
pas le cas pour le matériel négatif qui n’est pas mieux
mémorisé par les sujets dysphoriques que par les sujets
contrôles. On parle alors d’un effet d’asymétrie du traite-
ment de l’information émotionnelle chez les sujets dys-
phoriques. Matt
et al.
(28) concluent qu’un effet de con-
gruence n’a été mis en lumière que chez les sujets
dépressifs cliniques.
Dans leur revue de la question, Singer et Salovey (38)
font une analyse critique de la littérature proche des con-
clusions de Matt
et al.
(28). En effet, ils ne relèvent qu’un
petit nombre d’éléments en faveur d’un biais mnésique
chez les sujets dysphoriques. Ils expliquent ces résultats
par le fait que les sujets non cliniques utilisés sont sélec-
tionnés sur la base de scores au BDI qui ne seraient pas
considérés comme indiquant une dépression lors d’une
utilisation clinique de ce questionnaire. Souvent, les
recherches s’intéressant à la dépression non clinique con-
sidèrent les participants comme « dépressifs non
cliniques » ou « dysphoriques » à partir de scores au BDI
(21 items) de 8 ou 9 alors que Beck et son équipe, con-
cepteurs du questionnaire d’auto-évaluation, évoquent
une dépression clinique à partir d’un score égal à 17 (BDI
21 items). Il est donc tout à fait possible que ce soit la sévé-
rité de la dépression qui explique les différences de résul-
tats obtenus plutôt que le diagnostic psychiatrique.
D’une manière générale, un biais mnésique associé à
la dépression a été mis en évidence dans les recherches
des années 1980, malgré l’obtention de certains effets
d’asymétrie.
DISSOCIATION DES SITUATIONS
DE MÉMORISATIONS EXPLICITE ET IMPLICITE
Dans les années 1990, plusieurs études ont pour objec-
tif de mieux comprendre les conditions d’apparition de
l’effet de congruence associé à l’humeur. C’est ainsi
qu’elles recherchent si cet effet habituellement observé
dans les tâches classiques de mémoire explicite est
retrouvé dans les tâches de mémoire implicite. Pour cela,
les auteurs s’appuient sur la distinction établie par Graf et
Mandler (23) entre les processus d’intégration et d’élabo-
ration. En effet, selon ces auteurs, les performances dans
les tests explicites dépendent principalement de l’élabo-
ration de l’information à mémoriser, c’est-à-dire de pro-
cessus de recherche conscients et contrôlés alors que les
performances dans les tests implicites dépendent plutôt
de l’activation de la représentation pré-existante de cette
information et donc de processus d’intégration. Les résul-
tats manquent de cohérence. En effet, cinq études (19,
20, 24, 26, 39) ne mettent en évidence aucune influence
de la valence émotionnelle du matériel sur les performan-
ces implicites alors que dans les mêmes conditions, un
effet de congruence avec l’humeur apparaît en mémoire
explicite. Par ailleurs, les études de Bazin
et al.
(4, 5) et
Baños
et al.
(2) ne révèlent aucun biais mnésique associé
à la dépression, que ce soit en situation de mémorisation
explicite ou implicite. Toutefois, Bazin
et al.
(5) reconnais-
sent eux-mêmes la possibilité qu’un effet du matériel
puisse avoir interféré avec les performances des sujets
lors de la tâche de mémoire explicite et ne considèrent
donc pas qu’une interprétation puisse être réalisée sur la
base des résultats relatifs au test de mémoire explicite.
Les résultats concernant les épreuves de mémoire impli-
cite ne présentent, en revanche, aucun biais dû à l’effet
du matériel et peuvent être exploités. Finalement, les
résultats des cinq premières études, et sans doute de la
sixième (5), peuvent être interprétés dans le sens d’une
dissociation entre la mémoire explicite et la mémoire impli-
cite induite par la charge affective du matériel utilisé.
Plus récemment, quelques équipes de chercheurs (13,
14, 15, 16, 34, 35, 40) ont mis en évidence un effet de
congruence associé avec la dépression en situation de
mémorisation implicite. Watkins
et al.
(40) obtiennent
effectivement un effet de congruence avec l’humeur lors
d’une tâche conceptuelle de mémoire implicite (associa-
tion libre) chez des sujets dépressifs cliniques alors qu’ils
n’obtenaient pas d’effet similaire lors de la précédente
étude (39) utilisant une épreuve de complètement de tri-
grammes. Tout comme Beato et Fernandez (6), ces
auteurs utilisent la distinction établie par Roediger et Blax-
ton (32) entre les tests de nature perceptive et les tests
de nature conceptuelle pour expliquer leurs résultats.
C’est ainsi que le biais mnésique associé à la dépression
peut être observé dans des tests de mémoire explicite, ces
derniers étant de nature conceptuelle (rappel, reconnais-
sance) et lors d’épreuves conceptuelles de mémoire impli-
cite (association libre ou catégorielle). L’interprétation de
Roediger et McDermott (33) et Watkins
et al.
(40) privilégie
donc la nature des tests utilisés plutôt que la notion d’inten-
tionnalité. Cette explication est toutefois problématique

L’Encéphale, 2007 ;
33 :
242-8, cahier 1 Biais mnésique associé à l’humeur dépressive : quelques réflexions critiques
245
puisque d’autres auteurs obtiennent un biais mnésique
associé à la dépression dans des tâches perceptives de
mémoire implicite. C’est ainsi que Ruiz-Cabellero et Gon-
zalez (34, 35) utilisent une tâche de rappel libre pour tester
la mémoire explicite et une tâche de complètement de
fragments pour tester la mémoire implicite chez des sujets
dysphoriques. Dans la première étude de 1994 (34), il est
demandé aux sujets de lire une liste de mots qui feront
plus tard l’objet d’un test de mémoire. Parce que les sujets
s’attendent à être testés sur le matériel appris, ils ont peut-
être réalisé qu’ils pouvaient utiliser le matériel et ont alors
employé des stratégies explicites pour compléter les frag-
ments. Les résultats, mettant en évidence un effet de con-
gruence avec l’humeur, ne peuvent donc pas être inter-
prétés sans ambiguïté. C’est pourquoi les auteurs
réalisent une deuxième expérience (34) incluant les deux
conditions d’encodage (intentionnel et accidentel) afin de
vérifier l’éventuelle contamination du test de mémoire
implicite par des stratégies explicites. Tout comme en
1994, Ruiz-Caballero et Gonzalez (35) établissent dans
l’étude de 1997 l’existence d’un effet de congruence asso-
cié à la dépression en mémoires explicite et implicite. Par
ailleurs, Colombel (16) compare également les perfor-
mances d’individus dysphoriques à celles d’individus con-
trôles lors de situations de mémorisation explicite et impli-
cite tout en manipulant le niveau d’élaboration du matériel
lors de l’encodage (encodage superficiel, profond ou réfé-
rentiel). Les résultats mettent en évidence un biais sélectif
spécifique chez les sujets dépressifs dans des conditions
d’encodage référentiel en situation de mémorisation expli-
cite et implicite. Ainsi, en mémoire implicite, on observe,
d’une part, une différence significative entre les sujets
dépressifs et contrôles, en faveur des sujets dépressifs,
quant au complètement des items descriptifs négatifs et,
d’autre part, un meilleur complètement des items descrip-
tifs positifs que négatifs pour le groupe contrôle.
En résumé, l’existence du biais en mémoire explicite est
souvent démontrée dans la littérature. En revanche, les
choses sont beaucoup moins claires pour le biais en
mémoire implicite : certaines études (2, 4, 5, 19, 20, 24,
26, 39) n’obtiennent pas ce biais alors que d’autres font
état de l’apparition d’un biais mnésique associé à la
dépression en situation de mémorisation implicite (13, 14,
15, 16, 34, 35, 40). Cet état des lieux, relativement nou-
veau, pose la question des conditions d’émergence pré-
cises du biais associé à la dépression en situation de
mémorisation implicite. D’une manière générale, différen-
tes dimensions semblent varier à travers les études impli-
quant la mémoire implicite et empêchent de ce fait une
bonne compréhension des conditions d’apparition du biais
mnésique associé à la dépression (3). On peut évoquer
la nature du test (complètement de trigrammes, complè-
tement de fragments, associations verbales), le statut des
dépressifs (cliniques, dysphoriques ou induits), le type de
matériel utilisé (mots émotionnels, mots neutres, mots
auto-référentiels) ou le niveau de traitement (conceptuel
ou perceptif).
Dans le but de cerner le plus précisément possible les
conditions d’émergence du biais en situation de mémori-
sation implicite, quelques auteurs se sont focalisés sur
l’étude de la nature des processus impliqués.
NATURE DES PROCESSUS ET APPARITION DU BIAIS
MNÉSIQUE ASSOCIÉ À LA DÉPRESSION
Si l’existence de dissociations entre les tâches de
mémoire implicite et celles de mémoire explicite n’est pas
remise en cause, les interprétations relatives à la nature
des processus mis en jeu lors de ces tests sont beaucoup
plus controversées. Ainsi, les études « traditionnelles »
menées sur les dissociations mnésiques reposent toutes
sur la même logique implicite selon laquelle il existerait
une correspondance exacte entre les tâches utilisées et
les processus qu’elles sont supposées révéler. Comme
on a pu le constater, on considère depuis Schacter (36)
que les tests directs de la mémoire, tels que le rappel et
la reconnaissance, reflètent le souvenir conscient, inten-
tionnel tandis que les mesures indirectes, telles que le
complètement de mots, révèlent les effets automatiques
de la mémoire et évaluent la mémoire implicite [pour une
revue de questions, voir (31)]. L’interprétation des résul-
tats repose dès lors sur l’hypothèse selon laquelle les
tâches impliquent la mise en œuvre de processus cognitifs
purs. Bien sûr, les chercheurs étaient conscients du fait
que cette assertion n’était qu’une simplification (9), même
si elle semblait fonctionner à merveille et a suscité un
grand nombre de recherches intéressantes. Les résultats
des dernières recherches citées [mise en évidence d’un
biais mnésique associé à la dépression en situation de
mémorisation implicite (13, 14, 15, 16, 34, 35, 40)] pour-
raient donc, selon cette logique, être interprétés comme
étant la preuve de la mise en jeu de processus automati-
ques lors de l’apparition du biais mnésique associé à la
dépression. Ainsi, le biais mis en évidence lors de la tâche
de complètement de fragments serait supposé refléter
précisément les influences mnésiques automatiques.
Cependant, certains auteurs ont montré qu’il était possible
que des processus stratégiques viennent influencer les
performances aux tests de mesures indirectes. Il semble
également possible que les mesures directes de la
mémoire puissent être affectées par des influences non
conscientes (27). Ces observations empiriques ont con-
duit de plus en plus à considérer que l’isomorphisme entre
tâches et processus représentait une simplification trop
grossière et par conséquent inadéquate (29, 31). Actuel-
lement, il semble qu’il soit plus approprié de baser les
recherches sur la mémoire sur l’hypothèse selon laquelle
la plupart des tâches mettent en jeu des processus cons-
cients et non conscients dans des proportions variables.
Cette dissociation entre processus stratégiques et auto-
matiques pourrait donc être une piste explicative intéres-
sante qui permettrait de clarifier les conditions d’apparition
du biais mnésique associé à la dépression. Quelle est la
nature des processus qui permettent d’obtenir un biais
mnésique associé à l’humeur ?
Dans cette perspective, Bradley
et al.
(10, 13, 14) sont
les premiers à utiliser une tâche de décision lexicale avec
amorçage de répétition (tâche implicite de nature percep-

F. Colombel L’Encéphale, 2007 ;
33 :
242-8, cahier 1
246
tive) pour tester l’apparition d’un biais mnésique en situa-
tion de mémorisation implicite. Les situations expérimen-
tales qui reposent sur la mise en évidence d’un processus
d’amorçage supposent qu’un item-amorce peut influencer
la réponse d’un sujet à un item-cible. Le phénomène
observé de facilitation ou d’inhibition est généralement
interprété en relation avec l’hypothèse d’un double pro-
cessus automatique et stratégique. Pour leur part, Bradley
et al.
utilisent deux conditions d’amorçage : une condition
d’amorçage supraliminal permettant au sujet de traiter
consciemment l’amorce et pouvant donc mettre en jeu des
processus automatiques et stratégiques, et une condition
d’amorçage subliminal ne permettant pas un traitement
conscient de l’amorce et ne mettant donc en jeu que des
processus automatiques. L’amorçage supraliminal est
défini par un SOA (
Stimulus Onset Asynchrony
, c’est-à-
dire le temps qui sépare la présentation de l’amorce et du
masque) très long (7 min) dû à la présentation par bloc
des amorces lors de la première phase de l’expérience.
L’amorçage subliminal repose, quant à lui, sur l’utilisation
d’un SOA de 28 ms, suivi d’un masque de même durée.
Ce seuil ne devrait pas permettre aux sujets d’identifier
consciemment les amorces. Toutefois, les auteurs pré-
voient, à la suite de la tâche de décision lexicale, un test
de détection puis un test de discrimination afin de s’assu-
rer que les amorces ne sont pas identifiées de manière
significativement différente du hasard. Dans leur étude de
1994, Bradley
et al.
mettent en évidence, chez des sujets
non cliniques dysphoriques, un biais en mémoire implicite
pour le matériel congruent avec la dépression lorsque
l’amorçage est subliminal mais pas lorsqu’il est supralimi-
nal. Il apparaît donc que des processus automatiques sont
mis en jeu lors de l’apparition de ce biais. Ces résultats
contrastent avec ceux de l’étude de 1995, réalisée sur une
population clinique, qui met en évidence un biais en
mémoire implicite dans les deux conditions d’amorçage
(supraliminal et subliminal). Cette étude porte à la fois sur
une population de dépressifs cliniques et sur une popula-
tion de patients anxieux cliniques. La tâche de décision
lexicale est identique à celle utilisée dans l’étude de 1994.
La tâche de mémoire explicite est une épreuve de rappel
libre. Les résultats indiquent que l’anxiété ne se trouve
associée à aucun biais mnésique. La dépression clinique,
quant à elle, est associée à un biais mnésique en situation
de mémorisation explicite et en situation de mémorisation
implicite, dans des conditions d’amorçage supraliminal et
subliminal. Pour expliquer les différents résultats obser-
vés au cours de ces deux études
(10, 14), les auteurs sug-
gèrent que l’effet dû à l’amorçage automatique pourrait
refléter une vulnérabilité caractéristique de la dépression
clinique, vulnérabilité que les sujets dysphoriques pour-
raient neutraliser par la mise en place de processus stra-
tégiques alors que les sujets cliniques seraient incapables
d’utiliser de telles stratégies. L’étude réalisée en 1996
compare une nouvelle fois les performances de sujets cli-
niques et de sujets dysphoriques à celles de sujets con-
trôles lors d’une tâche de décision lexicale impliquant un
amorçage supraliminal et un amorçage subliminal. Le
matériel est composé d’items congruents avec la dépres-
sion ainsi que d’items neutres. Les résultats de cette étude
confirment ceux obtenus lors des recherches de 1994 et
1995. En effet, un biais mnésique émerge chez le groupe
dysphorique uniquement dans la condition d’amorçage
subliminal alors qu’il apparaît chez le groupe de dépressifs
cliniques dans les conditions d’amorçage subliminal et
supraliminal.
De la même manière, Scott, Mogg et Bradley (37) uti-
lisent une tâche de décision lexicale incluant une condition
d’amorçage de répétition et une condition d’amorçage
sémantique (SOA de 56 ms ou de 2 000 ms). Ils mettent
en évidence un biais mnésique associé à l’humeur dépres-
sive chez des sujets dysphoriques en situation d’amor-
çage sémantique seulement dans la condition SOA court
(56 ms). Ces résultats sont interprétés comme mettant en
évidence le rôle des processus automatiques dans l’appa-
rition du biais mnésique associé à la dépression. Enfin,
plus récemment, Colombel
et al.
(17) ont élaboré un para-
digme d’amorçage de répétition (tâche de décision lexi-
cale) permettant d’examiner la possibilité que l’émer-
gence de l’effet de congruence avec l’humeur dépressive
soit due à la mise en jeu de processus automatiques. C’est
ainsi que cette expérience a également comporté deux
conditions d’amorçage : un amorçage supraliminal et un
amorçage subliminal. L’analyse globale des résultats indi-
que un effet de congruence avec l’humeur dépressive
dans la condition d’amorçage subliminal et non dans la
condition d’amorçage supraliminal. Tout se passe comme
si la mise en jeu exclusive de processus automatiques per-
mettait l’apparition d’un biais mnésique.
Ces résultats suggèrent que les sujets dysphoriques
sont capables, grâce à l’utilisation de stratégies, de com-
penser le biais mnésique « automatique » révélé par la
condition d’amorçage subliminal, cette dernière ne per-
mettant pas la mise en jeu de processus stratégiques. Ce
point de vue est conforme aux résultats obtenus par Bra-
dley
et al.
dans les recherches de 1994 et 1996 sur une
population de dépressifs non cliniques et permet de con-
sidérer que l’absence de biais mnésique réside dans le
fait que les dépressifs sans diagnostic clinique seraient
capables de déployer des stratégies défensives qui les
« protégeraient » des conséquences d’un effet de con-
gruence avec l’humeur dépressive. Les sujets dépressifs
cliniques seraient, pour leur part, incapables d’utiliser de
telles stratégies ou les utiliseraient de manière inefficace
(13, 14). Cependant, on ne sait pas si c’est le statut du
diagnostic psychiatrique ou la sévérité de la dépression,
ou encore une combinaison des deux qui détermine le fait
qu’apparaisse ou non un biais mnésique en condition
d’amorçage supraliminal. À notre connaissance, seules
deux études (34, 35) ont mis en évidence un biais mné-
sique en situation de mémorisation implicite « classique »
chez des sujets sans diagnostic clinique. Bradley
et al.
comparent cette situation expérimentale à celle d’amor-
çage supraliminal. En effet, toutes les deux impliquent des
processus stratégiques et automatiques. De plus, il s’agit
bien de deux tests de mémoire implicite, les consignes ne
faisant pas référence à la récupération intentionnelle
d’informations précédemment présentées. Les scores au
BDI des sujets dépressifs non cliniques des études de
 6
6
 7
7
1
/
7
100%