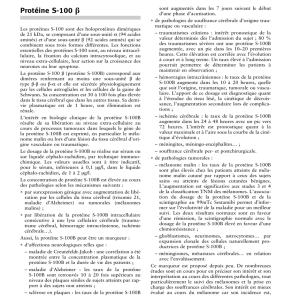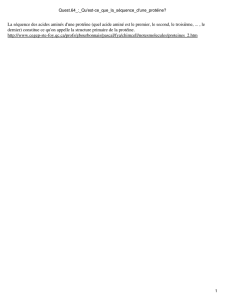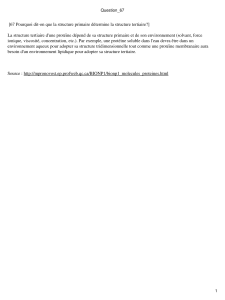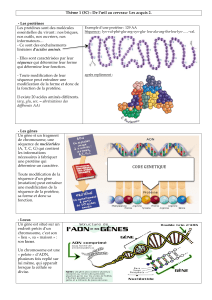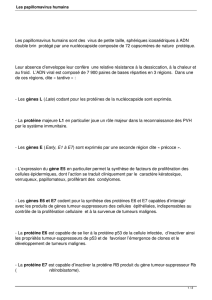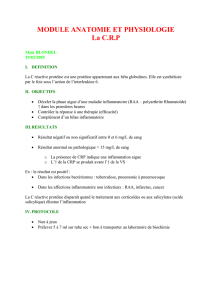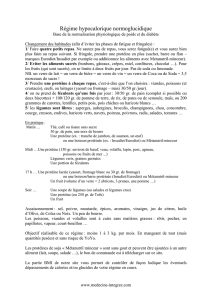Intérêt pronostique du dosage de la protéine S-100B

Intérêt pronostique du dosage de la protéine S-100B
sérique au décours d’un arrêt cardiaque en milieu
extrahospitalier : données préliminaires françaises
Prognostic value of S-100B protein plasma measurement
after cardiac arrest
S. Ziani
1,2,a
N. Bertho
3,a
G. Atlan
1
M.-L. Fievet
3
P. Ecollan
3
J.-L. Beaudeux
1,4
1
Service de biochimie métabolique,
Hôpital La Pitié-Salpêtrière,
APHP, Paris
2
Service de biologie, Hôpital national
Saint-Maurice/Esquirol, Saint-Maurice
3
Service mobile d’urgence
et de réanimation (SMUR)
et Département d’anesthésie-
réanimation, Hôpital La Pitié-Salpêtrière,
APHP, Paris
4
Service de biochimie,
Hôpital universitaire Charles Foix,
APHP, Ivry-sur-Seine
a
Contribution à part égale des deux
auteurs
Article reçu le 18 septembre 2009,
accepté le 28 octobre 2009
Résumé. La protéine S-100B est une protéine d’origine cérébrale, libérée dans
les fluides biologiques au cours de diverses atteintes neurologiques aiguës.
L’objectif de cette étude a été d’apprécier le retentissement cérébral d’un arrêt
cardiorespiratoire (ACR), récupéré par réanimation immédiate, et de rechercher
un intérêt prédictif à court terme du dosage sanguin de la protéine S-100B sur
l’atteinte neurologique consécutive à l’arrêt cardiaque. Le dosage du biomar-
queur a été réalisé chez 27 sujets ayant eu un arrêt cardiorespiratoire, au moment
de l’arrêt lors de la prise en charge médicale (H0), puis à 12, 24 et 48 heures après
la réanimation. Les valeurs initiales de la concentration sanguine de la protéine
S-100B et l’évolution cinétique de cette concentration nous ont permis de mon-
trer que : 1) 95 % des sujets ayant une concentration de protéine S-100B à H0
supérieure à 0,80 μg/L sont décédés ; 2) 62 % des sujets ayant une concentration
de protéine S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L ont survécu à l’ACR ; 3) tous les
sujets ayant une concentration de protéine S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L et
dont l’évolution cinétique de la protéine S-100B à partir de H12 a été décrois-
sante ont survécu ; 4) 100 % des sujets dont l’évolution cinétique de la protéine
S-100B à partir de H12 a été croissante sont décédés. Cette étude suggère donc
que le seuil de 0,80 μg/L pourrait être prédictif de l’issue d’un ACR, s’il est asso-
cié au suivi des concentrations plasmatiques de la protéine S-100B.
Mots clés : protéine S-100B, arrêt cardiaque, valeur pronostique, sang
Abstract. S-100B protein is selectively synthesized by glial cells, and is released
in biological fluids after acute brain damage. We analyzed initial levels and evolu-
tion of plasma S-100B protein concentrations after resuscitated cardiopulmonary
arrest (CPA). S-100B levels were determined in 27 subjects at the time of CPA
(H0) then 12, 24 and 48 h after resuscitation. Initial levels of S-100B and kinetics
revealed that: 1) 95% the of subjects with a concentration of protein S-100B greater
than 0.80 μg/L at H0 did not survive; 2) 62% of subjects with a concentration of
protein S-100B lower than 0.80 μg/L at H0 survived; 3) 100% of subjects with a
protein S-100B level lower than 0.80 μg/L at H0 and whose evolution kinetics of
S-100B levels showed a decrease survived; 4) 100% of the subjects whose S-100B
levels increased from H12 died. In summary, this study suggests that the threshold
of 0.80 μg/L for S-100B plasma levels at H0 could be predictive for the outcome of
the CPA, when associated with the kinetic study of S-100B plasma concentration.
Key words: S-100B protein, cardiopulmonary arrest, blood measurement,
prognostic value
article original abc
Ann Biol Clin 2010 ; 68 (1) : 33-8
doi: 10.1684/abc.2010.0399
Tirés à part : S. Ziani
Ann Biol Clin, vol. 68, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2010 33

L’arrêt cardiaque extrahospitalier constitue un enjeu médi-
cal majeur tant par sa fréquence que son pronostic très
sombre à court terme. Les atteintes lésionnelles cérébrales
constituent une cause majeure de morbidité et de mortalité
après un arrêt cardiaque suivi d’une réanimation cardiopul-
monaire, en particulier en milieu extrahospitalier où les
délais de prise en charge initiale (premiers secours) et
médicale (par une unité mobile d’urgence et de réanima-
tion) sont plus importants qu’en secteur hospitalier. Une
évaluation précoce du degré d’atteinte cérébrale et de son
évolution après l’arrêt cardiaque et la réanimation influen-
cent la prise en charge médicale et les stratégies thérapeu-
tiques (pour revue voir [1]). Les examens neurologiques et
électrophysiologiques précoces ne sont en général pas pré-
dictifs de l’évolution à court (quelques jours), moyen ou
long terme (quelques mois) du patient et des séquelles neu-
rologiques éventuelles [2]. Un biomarqueur dont le dosage
sanguin refléterait la sévérité des lésions cérébrales
permettrait d’améliorer l’évaluation initiale et de quantifier
l’atteinte cérébrale post-arrêt cardiaque, comme les mar-
queurs cardiaques le font pour l’infarctus du myocarde.
Dans cette perspective, le dosage de différentes molécules
a été proposé au cours des dernières décennies, mais la
plupart d’entre elles ont été progressivement abandonnées
par manque de spécificité ou de sensibilité. Des marqueurs
biochimiques de l’état hypoxique cérébral aigu (énolase
spécifique neuronale (NSE), protéine S-100B…)oud’un
état inflammatoire réactionnel (interleukine IL-8) ont été
proposés [3].
La protéine S-100B est une protéine dimérique synthétisée
principalement par les cellules astrogliales du système ner-
veux central et les cellules de la gaine de Schwann. C’est
une protéine cytosolique fixant le calcium, mais des
actions extracellulaires sur la croissance et la prolifération
cellulaires lui ont également été attribuées (pour revue voir
[4, 5]). L’intérêt du dosage de la protéine S-100B en bio-
logie clinique est lié à sa libération au niveau extracellu-
laire au cours de processus tumoraux dans lesquels le gène
de la protéine S-100B est (sur)exprimé, et lors d’une
atteinte du tissu cérébral aiguë, d’origine vasculaire, trau-
matique, ou chronique. En raison de sa neurosélectivité
[6, 7] et de sa demi-vie d’élimination brève, la protéine
S-100B peut constituer un marqueur biologique précoce
et sensible pour évaluer l’atteinte cérébrale post-arrêt car-
diaque et son évolution.
L’objectif de notre étude a été d’apprécier le retentisse-
ment sur le cerveau d’un arrêt cardiaque intervenant en
milieu extra-hospitalier, récupéré par réanimation immé-
diate, et de rechercher un intérêt prédictif à court terme
du dosage de ce marqueur sur l’évolution du patient
après l’arrêt cardiaque. Les concentrations plasmatiques
de la protéine S-100B ont été déterminées dans les pre-
mières minutes et dans les 48 premières heures suivant la
réanimation cardiorespiratoire après un arrêt cardiaque
survenu en secteur extrahospitalier. Les valeurs de la pro-
téine S-100B et son évolution sur 48 heures ont été
confrontées à l’évolution (survie, décès) du patient après
sa réanimation initiale.
Patients et méthodes
Patients et prise en charge médicale
De façon spécifique à ce travail, un protocole d’étude entre
le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et
le Service de biochimie métabolique de l’hôpital de La
Pitié-Salpêtrière (APHP, Paris) a été établi, consistant à
prélever systématiquement tous les patients présentant un
arrêt cardiorespiratoire (ACR) survenu à l’extérieur de
l’hôpital et pour lequel le SMUR est appelé en urgence.
Au total, 27 patients présentant un ACR extrahospitalier
ont été inclus et exploités.
À la suite de l’arrêt cardiorespiratoire survenu à domicile
ou sur la voie publique, tous les patients inclus ont reçu
sur place un massage cardiaque externe, un choc élec-
trique externe ou les deux par l’équipe du SMUR (si
elle était déjà présente sur les lieux) ou lors du premier
secours par les personnes présentes ou un médecin appelé
pour intervention. À l’arrivée de l’équipe du SMUR, les
patients ont reçu quasi systématiquement plusieurs bolus
d’adrénaline (1 mg/3 min) permettant ainsi de récupérer
un rythme cardiaque spontané. Les patients ont ensuite été
transférés par le SMUR dans une structure hospitalière de
proximité pour poursuite de la prise en charge. À l’arrivée
àl’hôpital, tous les patients avaient un score de Glasgow
(GCS) à 3/15, étaient en mydriase bilatérale aréactive,
avec acidose lactique le plus souvent. Tous ont été
admis dans un centre de réanimation médicale. Les carac-
téristiques des patients et de leur prise en charge sont
regroupées dans le tableau 1.
Échantillons biologiques et dosage
de la protéine S-100B
Un prélèvement sanguin a été systématiquement effectué
sur le lieu de l’ACR, après la réanimation par l’équipe
du SMUR, le délai variant de quelques minutes dans la
majorité des cas à 35 minutes au plus tard (patients systé-
matiquement intubés, ventilés). Les échantillons corres-
pondants (H0) ont été transmis au laboratoire au retour
de l’équipe du SMUR à La Pitié-Salpêtrière. Des prélève-
ments sanguins à H12, H24 et H48 de l’ACR ont par la
suite été effectués par le service de réanimation ayant
accueilli le patient, puis transmis au laboratoire + 4 °C
dans un délai n’excédant pas 6 heures.
article original
34 Ann Biol Clin, vol. 68, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2010

Les prélèvements sanguins ont été effectués sur tube sec
sans gel séparateur ; les tubes ont été centrifugés 20 minu-
tes à 1 800 g, puis le sérum a été séparé, fractionné et
conservé à - 20 °C jusqu’à la réalisation des dosages
(dans un délai maximal de deux mois).
La mesure des concentrations sériques de la protéine
S-100B a été réalisée par électrochimioluminescence uti-
lisant un anticorps spécifique de la sous-unité βsur l’ana-
lyseur Elecsys 2010
®
(Roche Diagnostics
®
). Le dosage a
été effectué à l’aide de réactifs (ainsi que les solutions de
calibrage et de contrôles) distribués par la société Roche
selon les recommandations du fournisseur. La durée du
test est de 18 minutes. Le seuil de détection est de
0,005 μg/L, avec un domaine de mesure qui s’étend
jusqu’à39μg/L et un seuil de normalité de 0,10 μg/L.
Résultats
Population étudiée et caractéristiques de l’ACR
L’âge des patients inclus variait de 19 à 88 ans (moyenne :
63,8 ans) avec une prédominance de personnes de plus de
65 ans (55 %) (tableau 1). L’effectif était constitué de 20 hom-
mes et 7 femmes. Dans leurs antécédents, la grande majorité
des patients souffraient d’une pathologie cardiaque ou pulmo-
naire sous-jacente (n = 16 - troubles du rythme ou hyper-
tension artérielle) ; d’autres, avaient un terrain immuno-
déprimé ou une pathologie métabolique acquise (n = 8).
Tous les sujets présentaient un terrain fragile certain, avec
une pathologie médicale sous-jacente avant leur ACR.
L’arrêt circulatoire est intervenu le plus souvent au domicile
du patient (20/27), parfois sur la voie publique (5/27) ou dans
un milieu médicalisé non hospitalier (1/27), souvent en pré-
sence d’un témoin direct (21/27). Les premiers soins ont été
réalisés dans la très grande majorité des cas par les pompiers
ou un médecin d’urgence (SOS médecins). L’origine de
l’ACR était variable : neurologique (hémorragie méningée),
cardiaque (fibrillation ventriculaire, cardiopathie ischémique),
pulmonaire (pendaison ou inhalation le plus souvent) ou
encore médicamenteuse (tentative de suicide).
Le délai entre le début de la réanimation réalisée par le
SMUR et le prélèvement de la protéine S-100B à H0 a
varié de 3 à 35 minutes. Le retour à l’activité cardiaque et
respiratoire spontanée a varié entre 6 et 45 minutes. Parmi
les 27 patients, six ont évolué favorablement avec une récu-
pération (partielle ou totale) en quelques jours. Les 21 autres
sont décédés. Les causes de décès étaient : neurologique
(11 cas/21), défaillance multiviscérale (7/21), cardiaque
(1/21), indéterminée (2/21).
Concentrations sériques de la protéine
S100B à H0
Les données concernant les valeurs sériques de la protéine
S-100B à H0 sont reproduites dans le tableau 1 et la figure 1.
À ce temps de l’étude, plusieurs constats peuvent être faits :
–la concentration sérique de la protéine S-100B mesurée
était supérieure à la valeur limite de normalité (0,10 μg/L)
pour tous les patients au décours de l’arrêt circulatoire
(juste après la réanimation) ;
–les sujets ayant survécu avaient une concentration
sérique de la protéine S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L
dans la majorité des cas (5/6) ; le sixième cas avait une
concentration élevée (2,36 μg/L) mais qui a diminué très
rapidement dès H12 (cf. infra);
–trois patients décédés avaient une concentration de la
protéine S-100B inférieure à 0,80 μg/L ;
–l’origine cardiaque de l’ACR a été associée à une valeur
de la protéine S-100B comprise entre 0,79 et 3,39 μg/L et
la cause pulmonaire de l’arrêt avait à une valeur comprise
entre 0,37 et 15,83 μg/L ;
–tous les résultats de protéine S-100B supérieurs à 1 μg/L
(sauf 1) ont été associés au décès du patient même si les
concentrations ont pu diminuer par la suite ;
–les patients qui avaient une concentration de protéine
S-100B très élevée (supérieure à 4 μg/L) étaient ceux
qui avaient reçu une réanimation de l’équipe du SMUR
tardive, qui pourrait expliquer le passage massif de la pro-
téine S-100B dans la circulation (tableau 1). Par contre,
Prote
´ine S-100B plasmatique et arre
ˆt cardiaque
Tableau 1. Caractéristiques démographiques, cliniques, biologi-
ques et évolutives des patients inclus dans l’étude. Les données
sont fournies, pour les valeurs chiffrées, sous la forme de
moyenne ± écart type.
Nombre de patients 27
Ratio H/F 20/7
A
ˆge (ans) 63,8 ± 18,1
Origine de l’arre
ˆt cardiorespiratoire :
Neurologique 2
Cardiaque 9
Respiratoire 7
Autre/non identifie
´e9
De
´lai entre l’ACR et les premiers secours (min) 8,5 ± 4,0
De
´lai entre l’ACR et la re
´animation (min) 10,3 ± 7,8
E
´volution favorable (survie) 6
Cause finale du de
´ce
`s:
Neurologique 11
De
´faillance multivisce
´rale 7
Cardiaque 1
Inde
´termine
´e2
S-100B se
´rique (μg/L) :
H0 0,84 ± 3,57
H12 1,37 ± 2,68
H24* 0,81 ± 3,81
H48** 0,60 ± 3,13
*20 patients ; **13 patients. ACR : arrêt cardiorespiratoire.
Ann Biol Clin, vol. 68, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2010 35

nous n’avons pas retrouvé de corrélation entre la concen-
tration de protéine S-100B à H0 et le délai entre l’ACR et
le retour à une activité cardiaque spontané ;
–pour les sujets ayant eu une évolution défavorable,
les concentrations sériques de la protéine S-100B à
H0 ne sont pas apparues significativement différentes
selon la cause finale du décès, mais on a pu toutefois
noter que tous les patients décédés pour des causes
neurologiques avaient tous des protéines S-100B très
élevées (> 3,0 μg/L).
Les mesures de la concentration sérique de la protéine
S-100B à H12, H24 et H48 ont permis de faire les obser-
vations suivantes :
–les cinétiques d’évolution des 6 patients ayant survécu
ont toutes montré une décroissance rapide de la protéine
S-100B plasmatique. Cette décroissance a été particuliè-
rement importante pour l’unique patient dont la concen-
tration initiale était à 2,36 μg/L, puisque dès H12, la
concentration n’était plus que 0,54 μg/L ;
–les 3 patients décédés qui avaient une concentration de
la protéine S-100B < 0,8 μg/L ont eu une augmentation
très rapide de la concentration sérique du biomarqueur à
partir de H12 ;
–l’évolution des concentrations plasmatiques de la pro-
téine S-100B entre H12, H24 et H48 n’est pas apparue
différente selon la cause du décès.
La figure 2 illustre les cinétiques d’évolution des concentra-
tions sériques de la protéine S-100B chez 4 patients représen-
tatifs de l’étude (2 ayant survécu, 2 étant décédés). A H12,
H24 et H48, la cinétique montre bien l’intérêt d’un suivi car
les concentrations sanguines de la protéine S-100B des
survivants ont nettement décru voire se sont normalisées,
alors que pour les patients décédés, la concentration sérique
de la protéine S-100B a continué à augmenter ou a montré
une réaugmentation secondaire, qui s’est avérée prédictive
de l’issue fatale.
article original
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
H0 H12 H24 H48
S-100B (µg/L)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
H0 H12 H24 H48
S-100B (µg/L)
Figure 2. Evolution cinétique de la protéine S-100B chez les deux
patients ayant survécu (graphe supérieur) et chez deux patients
représentatifs chez lesquels la concentration du biomarqueur
à H0 était inférieur à 0,80 μg/L, mais dont la ré-augmentation à
partir de H24 a précédé le décès (graphe inférieur).
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627
Patients
S-100B sérique (µg/L)
< 0,80 µg/L
> 0,80 µg/L
Figure 1. Valeurs de la protéine S-100B plasmatique à H0. Les concentrations sériques de la protéine S-100B pour les patients 26 et
27 étaient 8,07 et 15,80 μg/L, respectivement. Les flèches identifient les patients ayant survécu (en traits pointillés, la valeur seuil de
physiologie de la protéine S-100B sérique ; en trait plein, la valeur seuil de 0,80 μg/L).
36 Ann Biol Clin, vol. 68, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2010

La figure 3 synthétise l’évolution des patients après ACR
en fonction de la concentration sérique de la protéine
S-100B à H0 et de la cinétique d’évolution du biomar-
queur dans les jours suivant la récupération.
Discussion
L’arrêt cardiocirculatoire est défini par un arrêt de la cir-
culation ayant pour origine une défaillance de la pompe
cardiaque ou du système vasculaire. L’effondrement du
débit sanguin cérébral consécutif à cet arrêt engendre
des troubles de conscience immédiats qui mettent en jeu
très rapidement le pronostic vital. Le patient en situation
d’arrêt cardiaque est aréactif, inconscient, ne présente pas
de mouvement respiratoire spontané et il y a disparition
des pouls carotidien et fémoral. Contrairement à la syn-
cope, qui est liée à une inefficacité cardiaque spontané-
ment réversible, le phénomène d’arrêt cardiocirculatoire
est irréversible sans mise en place d’une réanimation, et
conduit dans ce cas à l’arrêt irréversible de toutes les fonc-
tions biologiques, et donc au décès.
L’arrêt respiratoire survient 20 à 60 secondes après le début
de l’arrêt circulatoire. Il est dû à l’anoxie des centres respi-
ratoires du tronc cérébral. L’action combinée de l’arrêt
circulatoire et de l’arrêt respiratoire aboutit rapidement à
une acidose métabolique et une anoxie cellulaire. Le pro-
nostic vital et le pronostic fonctionnel cérébral dépendent
uniquement de la rapidité et de l’efficacité du traitement
instauré. On considère que les lésions ischémiques devien-
nent irréversibles au niveau cérébral au bout de 4 minutes,
délai au-delà duquel il y a mort cérébrale [8].
L’arrêt cardiaque intrahospitalier a fréquemment une ori-
gine cardiovasculaire (88 %) ; il s’agit souvent de sujets
âgés présentant un arrêt cardiaque suite à une défaillance
multiviscérale, et dont les organes sont « trop mauvais
pour vivre » (too bad to live) [9]. La survie à l’issue
d’un arrêt cardiaque intrahospitalier se situe entre 9 % et
37 % avec une moyenne de 15 % [9, 10].
L’arrêt cardiaque extrahospitalier constitue un enjeu médi-
cal majeur tant par sa fréquence que son pronostic très som-
bre à court terme. Si des taux de survie proche de 30 % ont
été rapportés par certains centres pilotes, plus particulière-
ment aux États-Unis, la survie des patients ayant fait un
arrêt cardiaque extrahospitalier n’était encore que de 2 à
3 % en France, dans les années 1990 [11]. Environ 10 %
de décès annuels (soit environ 50 000) sont attribués, en
France, à une mort subite. L’incidence dans la population
générale en est de 1 à 2 pour 1 000. L’étude française
Monica a évalué la prévalence de l’origine coronarienne
de ces décès aux environs de 60/100 000 chez l’homme et
de 10/100 000 chez la femme [12].
L’objectif du travail était de voir si la protéine S-100B pouvait
être informative de la survie des patients après arrêt cardiaque
extrahospitalier. Les données actuelles sur l’intérêt de la
protéine S-100B en biologie clinique fait de cette molécule
un biomarqueur pertinent des atteintes lésionnelles aiguës du
tissu cérébral (pour revue voir [13]), primitives telles que
l’hémorragie intracrânienne [14] ou le traumatisme crânien
[4], ou secondaires, par exemple à la chirurgie cardiaque
[15]. L’étude rapportée ici était exploratoire et n’aporté
que sur un nombre limité de patients. Les conclusions sont
résumées ainsi (figure 3):
–95 % des sujets (18/19) ayant une concentration de pro-
téine S-100B à H0 supérieure à 0,80 μg/L sont décédés ;
la survie avec une concentration de protéine S-100B éle-
vée est nécessairement associée, dans notre étude, à une
évolution cinétique décroissante du biomarqueur à partir
de H12 ;
–62 % des sujets (5/8) ayant une concentration de pro-
téine S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L ont survécu à
l’ACR ;
–100 % des sujets ayant une concentration de protéine
S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L et dont l’évolution
cinétique de la protéine S-100B à partir de H12 a été
décroissante ont survécu ;
–100 % des sujets dont l’évolution cinétique de la
protéine S-100B à partir de H12 a été croissante sont
décédés.
Cette étude suggère donc que le seuil de 0,80 μg/L pour-
rait être prédictif, s’il est associé à une évolution favorable
des concentrations plasmatiques de la protéine S-100B,
d’une issue favorable de l’ACR. Ce résultat apparaît tout
à fait en accord avec l’étude de Hachimi-Idrissi et al.,
portant sur 57 patients, dont les résultats suggèrent qu’une
valeur-seuil de la concentration plasmatique de la protéine
S-100B de 0,70 μg/L pouvait être considérée comme
déterminante pour prédire la survie ou non du patient [16].
Chez les patients n’ayant pas survécu à l’arrêt cardiaque,
ni les concentrations sériques de protéine S-100B ni l’évo-
lution cinétique du biomarqueur jusqu’à H48 ne sont
apparues significativement différentes selon la nature du
Prote
´ine S-100B plasmatique et arre
ˆt cardiaque
S-100B à H0
Nombre de sujets/survivants
<0,80 µg/L
8/5
>0,80 µg/L
19/1
Evolution cinétique
de la S-100B
Nombre de sujets/survivants
décroissante
5/5
croissante
3/0
décroissante
11/1
croissante
8/0
Figure 3. Schéma de synthèse de l’évolution clinique des sujets
ayant eu un arrêt cardiorespiratoire en fonction de la concentra-
tion sérique de la protéine S-100B à H0 et de sa cinétique
d’évolution.
Ann Biol Clin, vol. 68, n
o
1, janvier-fe
´vrier 2010 37
 6
6
1
/
6
100%