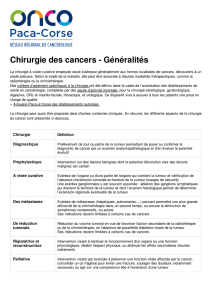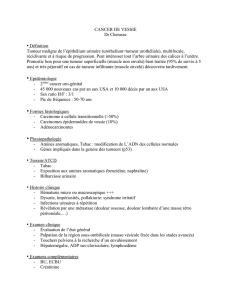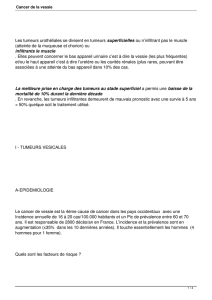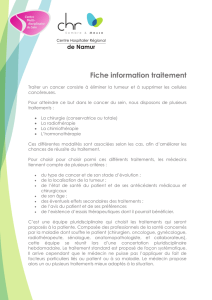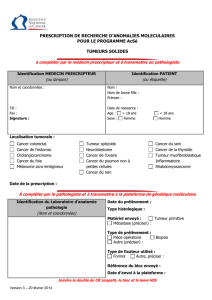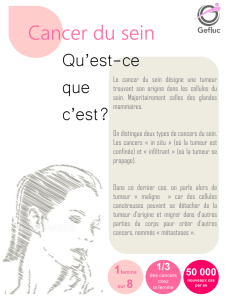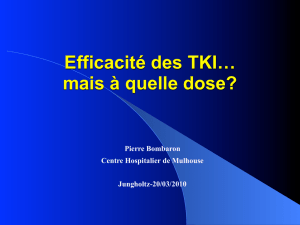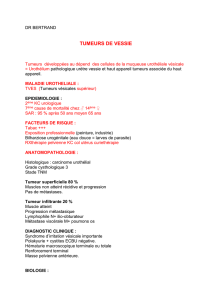Tumeurs urothéliales de vessie

TUMEURS UROTHELIALES DE VESSIE
I – DIAGNOSTIC
1 - DIAGNOSTIC PRECOCE ET DEPISTAGE DES TUMEURS DE VESSIE
La reconnaissance des symptômes précoces de tumeurs de vessie est la condition
d'une amélioration du pronostic lié à cette maladie. Tout patient présentant une
hématurie macroscopique
ou une
hématurie microscopique associée à des
troubles mictionnels
doit faire l'objet d'un examen médical et d'une consultation
auprès d'un urologue à la recherche d'une tumeur de vessie. Concernant
l'hématurie microscopique asymptomatique, seuls les patients à risque
(professions exposées, tabagisme, âge supérieur à 50 ans) avec une hématurie
microscopique permanente devront faire l'objet d'un examen systématique par
un urologue. Egalement, devront être adressés à l’urologue les patients
présentant des symptômes irritatifs sans étiologie évidente ainsi que les
patients présentant une infection urinaire récidivante. Le dépistage de masse
chez les patients asymptomatiques n'est pas recommandé. Par contre, un
dépistage individuel est souhaitable pour les populations exposées aux
carcinogènes.
2 - DIAGNOSTIC POSITIF
A - Examens indispensables :
Enquête sur les facteurs prédisposants (dérivés des amines aromatiques,
goudron de houille, hydrolyse de l'aluminium, tabac). Une suspicion d'origine
professionnelle doit entraîner une déclaration au médecin inspecteur
régional du travail, à la direction régionale du travail et de l'emploi.
Cystoscopie avec description de la tumeur : localisation, taille, aspect,
nombre, (une cartographie doit figurer dans le dossier, cf. exemple de
fiche)
B - Examens optionnels
L'échographie de l’appareil urinaire

a – Intérêt
1
er
examen à réaliser dans le bilan d'une hématurie, elle permet d'éliminer une
tumeur rénale et d'objectiver une anomalie pariétale vésicale.
b - Techniques et résultats : Plusieurs techniques peuvent être utilisées :
b.1 – L'échographie par voie sus-pubienne, réalisée vessie pleine mais non
distendue.
b.1.1 - Détection tumorale
La sensibilité de l'échographie varie de 61 à 84 % pour les tumeurs polypoïdes
de plus de 5 mm.
Typiquement, il s’agit d’une masse d'échogénéicité moyenne à intense, attachée
à la paroi qui elle, est hyperéchogène.
Les caillots peuvent poser un problème diagnostic mais sont souvent mobiles
aux changements de position.
b.1.2 - Extension locale
L’échographie sus-pubienne ne permet pas de distinguer les différentes
couches de la paroi et donc le degré précis d’infiltration.
L’envahissement de la graisse ne peut être affirmé que si la masse se prolonge
hors des parois de la vessie.
Pour la recherche d'adénopathies pelviennes et l’appréciation de l’extension aux
organes de voisinage, l’échographie est peu performante.
b.1.3 - Etude du haut appareil urinaire
Une urétéro-hydronéphrose témoigne d'une tumeur infiltrante.
b.2 - Echographie endorectale et endovaginale
Elle peut être contributive pour l’analyse du trigone et du col vésical.
L'ECBU
L'UIV a été remplacée par l'uro-scanner
La TDM avec acquisition matricielle en coupes millimétriques ou infra-
millimétriques replace actuellement l'UIV pour le diagnostic et le bilan
d'extension des tumeurs vésicales. Elle permet des reconstructions 2D, 3D et
des projections en "maximum intensité projection" avec effet urographique. Elle
permet d'explorer tout l'appareil urinaire.
Technique :

Les coupes débutent au niveau du diaphragme et s’étendent à la symphyse
pubienne. La vessie doit être en réplétion mais non distendue (ne pas uriner 1 h
avant l’examen). Il ne faut pas réaliser de préparation digestive.
Plusieurs protocoles d’exploration ont été décrits.
Les 2 principaux sont :
Protocole classique avec 3 passages : sans injection, temps
néphrographique (100 à 120 s) et temps tardif (au minimum 4 mn) pour obtenir
une opacification la plus complète possible de l’appareil urinaire. Cette acquisition
tardive est fondamentale.
100 ml à 150 ml de produit de contraste iodé non ionique (300 mg d’iode/ml)
doivent être injectés avec un débit de 2 à 4 ml/sec.
Une acquisition artérielle à la phase cortico-médullaire peut être rajoutée en
particulier dans un bilan d’hématurie.
Protocole d’injection biphasique (protocole avec «split-bolus»)
Il permet de diminuer l’irradiation en réalisant dans le même temps l’acquisition
néphrographique et tardive : injection de 80 ml de produit de contraste puis
après 5 à 6 mn injection de 60ml.
Amélioration de l’opacification avec hyperhydratation orale (1 l d’eau 20 à 60 mn
avant), intraveineuse (sérum physiologique 500 ml avant et pendant TDM) ou
injection de Furosémide 20 mg immédiatement ou dans les minutes qui précédent
l’injection (sauf CI : allergie aux sulfamides, oligoanurie, troubles
hydroélectrolytiques graves).
Résultats :
La tumeur de vessie peut se présenter comme un syndrome de masse localisé,
une zone d’épaississement pariétal, plus rarement un épaississement diffus de la
paroi vésicale. Il existe des faux négatifs surtout si la lésion est de petite taille
(inférieure à 5 mm) ou si elle siège au niveau de la base de la vessie à proximité
de la prostate et de l’urèthre. Un scanner normal ne dispense pas de cystoscopie.
La taille minimale de détection est le plus souvent de 1 cm. La tumeur se
rehausse plus vite que la paroi vésicale. Pour certains auteurs, il faut réaliser en
plus du protocole classique un temps précoce après injection (60 à 80 s). Les
faux positifs sont également possibles en particulier après traitements locaux ou
après biopsie. Il faut attendre au moins 1 semaine entre la biopsie et le scanner.

L'IRM
Du fait d'une résolution en contraste supérieure, l'IRM apparaît
actuellement supérieure au scanner pour la détection tumorale, l'appréciation de
l'infiltration musculeuse et de l'extension extra-vésicale.
Sur le plan technique
Coupes axiales T2, frontales ou sagittales T2 en fonction de la localisation
tumorale.
Coupes axiales T1 sans et après injection de chélate de Gadolinium, idéalement
en injection dynamique (toutes les 30 sec pendant 5 mn) et en saturation de
graisse.
Des séquences spécifiques d’uro-IRM peuvent être réalisées (pondérées T2 ou
T1 après injection).
Sur le plan diagnostic
A l’état normal : la paroi vésicale est hypo-intense en pondération T2. Sur les
séquences T1 dynamiques, la muqueuse et la sous-muqueuse se rehaussent
précocement alors que la musculeuse reste hypointense.
Ces caractéristiques permettent d’apprécier en IRM le degré d’infiltration.
En pondération T1, la tumeur a un signal intermédiaire identique à la paroi, elle se
rehausse précocement après injection.
En pondération T2, elle est souvent bien identifiée (signal tumoral inférieur à
l’urine et supérieur à l’hyposignal de la paroi vésicale).
Une petite lésion de moins de 1 cm peut passer inaperçue.
Cytologie urinaire
La cytologie urinaire, méthode simple, peu coûteuse, facile à répéter, a démontré
son efficacité dans le diagnostic et surtout la surveillance des tumeurs
urothéliales de haut grade. Elle permet de détecter des lésions mal visibles en
cystoscopie.
Les différents types de prélèvements sont la miction en évitant la première
miction matinale, le sondage vésical, le lavage vésical et uréthral (éventuellement
après cystectomie) et le brossage sélectif. La technique, à partir d'urines
fraîches, sans conservateur est la méthode de choix mais elle doit être faite le
plus rapidement possible. L'attente, aussi courte soit-elle, doit se faire au
réfrigérateur à 4° C (maximum 24 heures). Si le délai d'acheminement est plus
long, une pré-fixation avec de la formaline ou par addition à l'urine d'une
quantité égale de formol à 10 % ou d'alcool éthylique à 50 % est indispensable.
Pour le brossage, la brosse est immergée dans 1 ml maximum de sérum

physiologique et adressée rapidement au Laboratoire. La prescription d'une
cytologie urinaire nécessite une fiche de renseignements relativement précise
destinée au Cytologiste.
Les résultats de l'examen cytologique doivent être interprétés différemment
selon que l'on se place en termes de suspicion de tumeur, de tumeur connue ou de
surveillance d'une pathologie urothéliale connue. Dans le cas où une tumeur est
suspectée, si l'ensemble des examens est négatif (échographie, Uro-TDM,
cystoscopie et cytologie), il est possible d'éliminer de manière formelle une
pathologie tumorale urothéliale. Si les examens sont discordants (cytologie
douteuse ou suspecte et le reste des examens négatifs), la prudence impose de
répéter les cytologies au besoin en effectuant des cytologies urétérales et
vésicales séparées et le cas échéant, de multiplier les biopsies vésicales. Dans le
cas où la tumeur est connue ou s'il s'agit d'une surveillance de la pathologie
urothéliale, la négativité de la cytologie en présence d'une tumeur n'apporte que
peu d'intérêt. En revanche, une cytologie positive permet de préciser la nature
urothéliale ou non de la tumeur et s'il s'agit d'une tumeur urothéliale de haut ou
de bas grade. Elle peut inciter à pratiquer des biopsies à distance de la tumeur
visible.
3 - DIAGNOSTIC D’EXTENSION AVANT LA RESECTION
A - Examens indispensables
Examen physique avec touchers pelviens
B - Examens optionnels d’imagerie
Ces examens apportent peu avant la résection. Ils n’ont de valeur que pour
apprécier l’extension avant la résection si on suspecte une tumeur infiltrante. Ils
seront essentiellement demandés en présence d'une tumeur infiltrante ou
lorsqu'une cystectomie est envisagée.
TDM (thoraco-abdomino)-pelvien
a – Extension locale
La fiabilité du scanner dans le bilan d’extension local est limitée, évaluée de 40 à
60%.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%