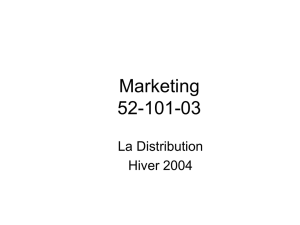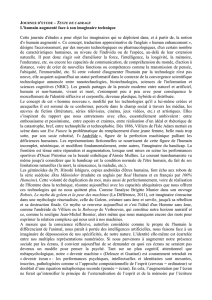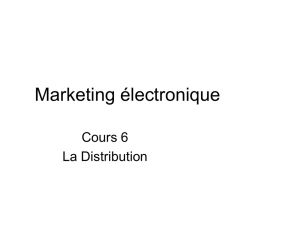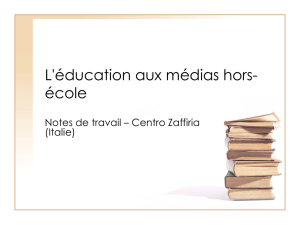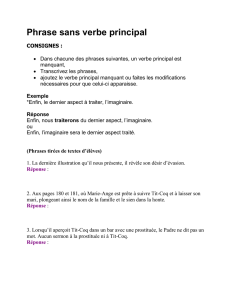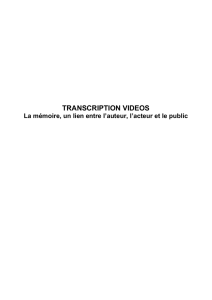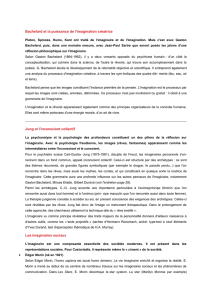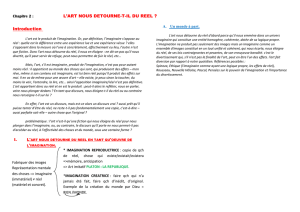Version Pdf

Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RAI&ID_NUMPUBLIE=RAI_027&ID_ARTICLE=RAI_027_0131
Retour sur la « communauté imaginée » d'Anderson. Essai de clarification
théorique d'une notion restée floue
par Christine CHIVALLON
| Presses de Sciences Po | Raisons politiques
2007/3 - n° 27
ISSN 1291-1941 | ISBN 9782724630794 | pages 131 à 172
Pour citer cet article :
— Chivallon C., Retour sur la « communauté imaginée » d'Anderson. Essai de clarification théorique d'une notion
restée floue, Raisons politiques 2007/3, n° 27, p. 131-172.
Distribution électronique Cairn pour les Presses de Sciences Po.
© Presses de Sciences Po. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur
en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

varia
CHRISTINE CHIVALLON
Retour sur la « communauté
imaginée » d’Anderson.
Essai de clarification théorique
d’une notion restée floue
«La meilleure chose à propos des Imagined Commu-
nities d’Anderson, c’est le titre 1» ! C’est en ces
termes que s’exprimait Ernst Bernard Haas, l’un
des nombreux auteurs qui ont eu à commenter au cours des deux
dernières décennies, les différentes théories sur la « nation » et le
« nationalisme », l’une (la nation) étant généralement vue comme
la forme incarnée – avec l’appui d’un État – de l’autre (le nationa-
lisme) considéré comme une idéologie 2. Publié pour la première
fois en 1983, l’ouvrage de Benedict Anderson, Imagined Commu-
nities.Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, n’a pas
été doté du même titre dans sa traduction française intervenue tar-
divement, en 1996, malgré le succès indéniable du livre dès sa sortie.
Cette traduction, L’imaginaire national.Réflexions sur l’origine et
l’essor du nationalisme, correspond par ailleurs à la deuxième édition
1. Ernst Bernard Haas, « What is Nationalism and Why Should We Study it ? », Inter-
national Organization, vol. 40, no3, 1986, p. 717.
2. Selon les définitions proposées dans l’article critique sur les théories du nationalisme
de Christophe Jaffrelot, « For a Theory of Nationalism », Questions de Recherche,n
o10,
Paris, Centre d’études et de recherches internationales, 2003, p. 5. Parmi l’abondante
littérature destinée à présenter ou commenter les différentes théories sur le nationa-
lisme, on se limitera à signaler les références suivantes : E. B. Haas, « What is Natio-
Raisons politiques,n
o27, août 2007, p. 131-172.
©2007 Presses de Sciences Po.

de l’ouvrage datant de 1991 3, édition que Benedict Anderson a
complétée par deux très beaux chapitres qui donnent force à sa
théorie, sans pour autant que celle-ci parvienne à être clairement
formulée à un endroit ou à un autre. Car c’est une théorie sinon
balbutiante, au moins inachevée, que nous présente ce spécialiste
de renommée « en relations internationales » dont la plus grande
partie des travaux ont porté sur l’Asie du sud-est et en particulier
l’Indonésie. Le lecteur attentif à la cohérence d’un système inter-
prétatif, ici celui qui engage le couple réel-imaginaire, ne pourra
parvenir à démêler des questions restées irrésolues sur le rôle de
l’imaginaire dans l’édification sociale. Pire, il pourra refermer
l’ouvrage en pouvant être convaincu que seules les formes politiques
associées aux nations modernes sont des « communautés imagi-
nées ». Le glissement de l’expression « communautés imaginées » à
celle de l’« imaginaire national » condense cette lacune définition-
nelle. Alors que le titre anglais suppose la congruence quasi parfaite
entre nationalisme et « communautés imaginées », le titre français
laisse supposer que le « national » pourrait qualifier un imaginaire
social parmi d’autres.
Ce diagnostic rapidement énoncé sur la faiblesse théorique
d’une notion n’est certainement pas le reflet du succès remporté par
cette dernière. Près de vingt cinq ans après sa première publication,
l’ouvrage d’Anderson continue d’inspirer de nombreux écrits au
point même qu’il est aujourd’hui possible de faire le constat selon
lequel « les communautés imaginées d’Anderson sont devenues un
nalism... », art. cité, p. 707-744 ; Thomas Haymes, « What is Nationalism Really ?
Understanding the Limitations of Rigid Theories in Dealing with the Problems of
Nationalism and Ethnonationalism », Nations and Nationalism, vol. 3, no4, 1997,
p. 541-557 ; Alexander J. Motyl, « Imagined Communities, Rational Choosers,
Invented Ethnies », Comparative Politics, janvier 2002, p. 233-250 ; Vincent P. Pecora,
Nations and Identities. Classic Readings, Oxford, Blackwell Publishers, 2001 ; Anthony
D. Smith, « The Nation : Invented, Imagined, Reconstructed ? », Millennium : Journal
of International Studies, vol. 20, no3, 1991, p. 353-368 ; Yael Tamir, « The Enigma
of Nationalism », World Politics, vol. 47, 1995, p. 418-440 ; Andrew Thompson et
Ralph Fevre, « The National Question : Sociological Reflections on Nation and Natio-
nalism », Nations and Nationalism, vol. 7, no3, p. 297-315.
3. La deuxième édition en anglais porte le même titre que la première avec mention de
« revised and enlarged version » (voir Benedict Anderson, Imagined Communities –
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983, et
B. Anderson, Imagined communities – Reflections on the origin and pread of Nationalism,
Londres, Verso, 1991, édition révisée et augmentée). Pour la référence française, se
reporter à B. Anderson, L’imaginaire national – Réflexions sur l’origine et l’essor du
nationalisme, trad. de l’angl. par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, La Découverte, 1996.
132 – Christine Chivallon

slogan – presque un mantra 4». Le phénomène, loin de ne concerner
que la science politique, atteint les autres disciplines de sciences
sociales, comme la nouvelle géographie anglo-américaine qui dresse
le bilan d’une notion devenue un « cliché », sa seule invocation
finissant par se substituer à l’analyse, en géographie comme ailleurs 5.
Dans ce cas, on ne peut qu’être admiratif face à l’annonce prophé-
tique formulée par Gale Stokes dans la vague des comptes-rendus de
livres qui ont suivi la sortie de la première édition : « J’ai le sentiment
que le terme “communautés imaginées” deviendra répandu. Il est
l’une de ces expressions que vous pensez avoir toujours connue, mais
qu’en fait vous ne connaissiez pas jusqu’à la lecture de l’ouvrage
original et aphoristique d’Anderson 6.»
La notoriété acquise par les « communautés imaginées » puise
ainsi au paradoxe du flou conceptuel qui accompagne l’explicitation
d’une telle notion. Certes, la contribution d’Anderson reste d’une
qualité indéniable – et nous y reviendrons – au regard de l’érudition
qu’elle déploie et de la finesse de la démonstration qu’elle opère
pour mettre à jour les processus de création et de sédimentation du
nationalisme moderne. Mais il reste, fiché comme en plein cœur
de ce tour de force historiciste, la fragilité d’un terme pourtant
nodal, celui qui se réfère à l’imaginaire, et qui du même coup fournit
l’occasion d’une utilisation polysémique pouvant satisfaire aux exi-
gences de différents projets intellectuels des deux dernières décen-
nies, depuis les classiques études politologiques jusqu’aux approches
« textuelles » associées aux Cultural Studies.
L’objectif de cet article est double. Il compte opérer un retour
sur la notion de « communautés imaginées » pour en cerner les
carences qui finissent par déstabiliser la démarche de l’auteur, l’ame-
nant à développer différentes acceptions d’un terme dont il voudrait
pourtant asseoir le contenu. C’est au travers de ces hésitations que
la trajectoire singulière de la notion sera interprétée depuis ses usages
académiques bien typés donnant prise à la rhétorique désormais
rôdée de la puissance de l’imaginaire dans nos univers globalisés.
Nous verrons alors comment le modèle d’Anderson s’est vu trans-
figuré de deux manières, par atrophie de l’objet – la nation – et
4. Marc Redfield, « Ima-gination. The Imagined Community and the Aesthetics of Mour-
ning », Diacritics, vol. 29, no4, 1999, p. 60.
5. Euan Hague, « Benedict Anderson », in Phill Hubbard, Rob Kitchin, Gill Valentine
(dir.), Key Thinkers on Space and Place, Londres, Sage, 2004, p. 19.
6. Notre traduction : Gale Stokes, « How is Nationalism Related to Capitalism », Compa-
rative Studies in Society and History, vol. 28, no3, 1986, p. 597.
Retour sur la « communauté imaginée » d’Anderson – 133

par hypertrophie de la grille d’analyse – l’imaginaire. La perspective
restera volontairement arrimée à la littérature anglophone sur le
sujet, le phénomène restant surtout discernable dans l’espace aca-
démique anglo-américain. Notre deuxième étape quittera ce sol cri-
tique pour s’engager dans un projet de clarification théorique. Les
outils théoriques, anciens ou récents, déjà éprouvés au cours de
recherches antérieures, seront ici mobilisés. En dépit de leur éclec-
tisme, ou en vertu de ce dernier, ils paraissent offrir une cohérence
dans l’enchaînement des questions soulevées par la désignation des
nations comme « communautés imaginées », ces outils impliquant
nécessairement d’aborder l’imaginaire à partir des relations de pou-
voir. Cette approche plutôt apparentée au constructivisme bien
qu’elle n’ignore pas les apports de la sémiologie ou du structura-
lisme, conclura alors à partir des imaginaires « non nationaux » pour
éprouver la pertinence de propositions livrées à titre exploratoire.
La trajectoire des Imagined communities de Benedict Anderson
Une démonstration à l’écart d’une notion
Dès la première édition de Imagined communities, Benedict
Anderson a rejoint le camp des grands théoriciens du nationa-
lisme. En simplifiant, on peut dire que le champ des études
contemporaines sur le fait national se structure de manière quasi
bipolaire avec d’un côté ceux qui sont désignés comme « primor-
dialistes » ou encore « pérennialistes » ou même « ethnosymbo-
listes », et de l’autre « les modernistes », qualifiés aussi de
« constructivistes » 7. La figure de Anthony D. Smith domine
incontestablement le premier versant de ces approches avec une
conception destinée à entériner l’origine de la nation dans un
passé culturel pré-existant, la plus ou moins forte compacité
7. On trouvera cette bipolarité et les différentes désignations dont elle est l’objet décrites
dans Pecora (V. P. Pecora, Nations and Identities...,op. cit., p. 25) avec la distinction
opérée entre « primordialistes » et « modernistes » ; dans Thomas Hylland Eriksen,
« Place, Kinship and the case for non-ethnic nations », Nations and Nationalism,
vol. 10, no1/2, 2004, p. 49-50) où il s’agit de dépasser le clivage entre « constructi-
vistes » et « pérennialistes » ; dans A. J. Motyl, « Imagined communities... », art. cité,
p. 234, qui sépare « constructivisme » et « primordialisme » ; dans Özkirimli (2003,
p. 340 et 344) où la division concerne les « ethnosymbolistes » et les « modernistes »
ou « constructivistes ».
134 – Christine Chivallon
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%