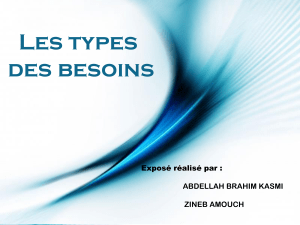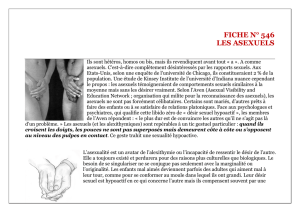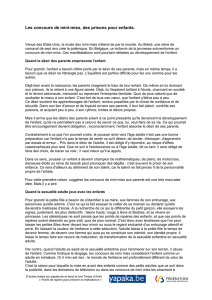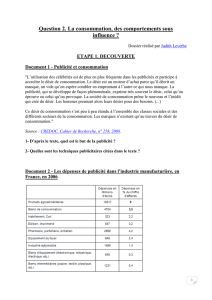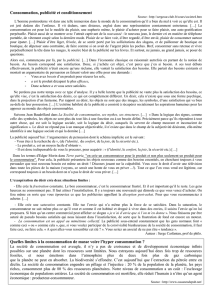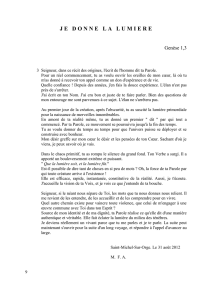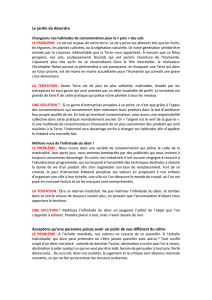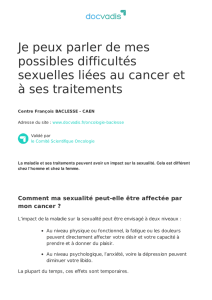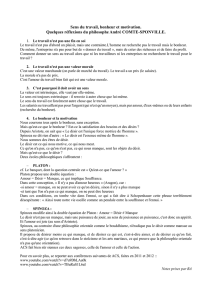Télécharger le document au format PDF

« La philosophie ne mériterait pas une heure de peine, si elle
n’aidait pas à mieux vivre. »
C’est parce qu’ils croient à la vérité de cette parole du sage
très antique qu’il est à la fois important et plaisant à certains
philosophes de ne pas philosopher seulement dans leur uni-
versité, leur cabinet, ou leur bibliothèque. Oui, la philosophie
peut aider à mieux vivre, quand elle fait son travail, qui n’est
plus tant aujourd’hui de bâtir de vastes systèmes d’explica-
tion du monde, que d’essayer d’apporter un peu de clarté
dans les concepts qui courent dans la cité : désir, besoin,
temps, amour, sexualité, qu’est-ce à dire, en vérité ? Car on
vit en vérité moins bien l’esprit confus, que clair. On rappel-
lera par exemple que qui confond l’amour et la passion court
le risque d’une vie amoureuse chaotique, le risque du passa-
ge de l’enchantement au désenchantement, de l’illusion à la
désillusion ; et que qui ne les confond pas court la chance
d’une vie amoureuse heureuse, joyeuse, et douce. La philo-
sophie peut donc aider à mieux vivre, parce qu’on vit mieux
l’esprit clair que confus. Elle est une parole fragile, désar-
mée, qui n’a d’autre force que celle d’être dite, et peut-être
écoutée. Force de cette fragilité, cependant, quand elle appro-
fondit le rapport au monde, aux autres, et à soi-même !
Je ne vous proposerai cependant pas une heure de peine, en
tous cas pas une heure pénible, mais une petite pièce de théâ-
tre, un impromptu à quatre personnages : Eros, Chronos, Via-
gra, Cialis.
SCENE 1 : Eros, Chronos
Le lien entre le désir et le temps est une chose fort connue des
philosophes, et des amants ajouterons-nous (mais on peut
être l’un et l’autre...).
Le temps de s’aimer ? En effet, il faut du temps pour s’ai-
mer... Car qu’est-ce, en vérité, que le désir (Eros) ? L’une des
trois formes de l’amour selon les Grecs, avec philia (l’ami-
tié), et Agapè (la charité, l’amour évangélique si l’on veut).
A Eros, Platon consacra comme on sait tout un dialogue, Le
Banquet. S’interrogeant sur sa généalogie, sur son ascendan-
ce, l’une des convives nous rapporte que ce petit dieu, ou ce
principe, aurait été conçu lors du banquet donné sur l’Olym-
pe en l’honneur de la naissance d’Aphrodite (indestructible
rapport entre le désir et la beauté...). Sa mère aurait été Penia,
et son père Poros. Qui était Penia ? Un être pauvre, indigent,
une va-nu-pieds, efflanquée, une mendiante, manquant d’a-
mour, en demandant à tous sans en recevoir jamais, -et penia
signifie justement en grec : disette, pauvreté. Qui était
Poros ? Un être riche, symbole de plénitude, -et poros signi-
fie justement en grec : plénitude, ressource. Or il se trouva
que notre Poros s’enivra de nectar, et s’endormit.. Passant par
là, Penia en profita pour violer plus ou moins Poros : elle s’é-
tendit contre ses flancs, et voilà qu’elle fut grosse d’un
enfant, qu’elle nomma Eros.
Quelle chose par là nous peut être enseignée ? Qu’Eros est un
mélange de pauvreté (qu’il tient de sa mère), et de richesse
(qu’il tient de son père). Que le désir est manque, mais qu’il
n’est pas que manque, et que là est tout son charme. Le désir,
c’est le manque d’un objet dont on possède cependant une
image. Que le désir soit manque, l’étymologie nous l’indique
assez : le mot vient du latin desidere (regretter l’absence de ;
souhaiter la présence de), qui vient lui même du latin deside-
rium. Or, dans ce dernier mot ; on trouve le préfixe de-, qui
désigne l’absence, et le radical sidus, sideris : l’astre. Le
désir, c’est donc le manque d’un astre ! Ou encore : la recher-
che d’un objet que l’on imagine pouvoir être source de satis-
faction, parce qu’on regarde cet objet comme un astre, une
source de lumière et de chaleur. Je regarde sans désir cette
paire de chaussures dans le vitrine ? Mon coeur reste froid,
mes yeux sont éteints. Mais que tombe sous mon regard cette
paire de chaussures désirables... Et mon coeur de s’échauffer,
mes yeux de s’illuminer. Le désir est donc manque, parce que
je ne peux désirer que ce qui se laisse désirer, et donc n’est
pas présent. Je ne désire pas être professeur de philosophie :
S’aimer sans programmer
Eric Fiat
Philosophe, Maître de Conférences à l’Université de Marne-la-Vallée
10

je le suis. Je ne désire pas porter la cravate que je porte : je la
porte. Je peux désirer continuer à être professeur, continuer à
porter cette cravate : voilà qui indique que je manque de cer-
titude, dans un cas de la certitude de le rester toujours, dans
l’autre cas de la porter toujours.
Le désir est donc manque, parce qu’Eros ressemble à Penia.
Mais il est aussi richesse, parce qu’il emprunte à son père,
Poros.
Car si je manque de l’objet lui-même, j’en possède déjà l’i-
mage. Et quels plaisirs déjà me donnent la possession de l’i-
mage de cette paire de chaussures, la possession de l’image
de ce joli corps !
Désirer, c’est donc souhaiter échanger l’image d’une chose
contre la chose dont elle est image... Il faut cependant dire, à
ce point de la démonstration, que ce qui précisément donne
au désir son charme, c’est le temps pris à cet échange :
- Que la chose se dérobe trop longtemps, qu’elle se refuse
à jamais, et tristesse, et déception de prendre sur moi leur
empire : je ne saurais me satisfaire infiniment de la pos-
session de la seule image !
-Mais que la chose se donne trop vite, qu’elle ne se laisse
pas désirer, et le désir de perdre tout son charme : je ne
saurais me satisfaire d’une chose qui me serait donnée
avant même que j’aie eu le temps de l’imaginer, c’est-à-
dire de la désirer ! Le plus beau moment du désir, n’est-
ce pas ce moment où je sens l’objet à portée de la main,
et pourtant encore un tout petit peu lointain, et secret ?
Magie du calendrier de l’avent ; magie du dîner qui, je
l’espère, c’est-à-dire que j’en doute encore !, magie du
dîner qui précède la première nuit d’amour.
On pourrait en somme définir le désir, comme l’attente de ce
qui n’attend pas. Or cette attente est déjà plaisir [1] ! Ou bien
encore : exquise souffrance, si cet oxymore nous est permis.
Les amants le savent très bien, qui jouent à prolonger les pré-
liminaires de l’amour, mais point trop tout de même !
- A les prolonger, parce que les pré-liminaires sont déjà
manière d’aimer, et parce que l’amour sans préliminaires
n’est pas amour, et peut dégoûter.
-Mais point trop cependant, parce que parce que les préli-
minaires non suivis de l’amour dont ils sont les prélimi-
naires risquent de frustrer.
En somme, entre l’amour sans préliminaires, et les prélimi-
naires sans amour, entre le dégoût, et la frustration, il est sans
doute urgent de ne pas choisir. Et l’on pourrait dire que le
désir souhaite, et ne souhaite pas être satisfait. L’objet désiré
tiendra-t-il toutes ses promesses ? Je ne saurais le dire...
Quelque menue déception, quelque infime désillusion ne se
fomentent-elles pas quelque part ? Je ne saurais le dire... Et
puisqu’il est question du désir, comment ne point donner la
parole à Dom Juan, qui en fut le maître, et l’incarnation
même, et comprit tout cela mieux que quiconque :
Les inclinations naissantes, après
tout, ont des charmes inexplicables, et
tout le plaisir de l’amour est dans le
changement. On goûte une douceur
extrême à réduire, par cent hommages,
le coeur d’une jeune beauté, à voir de
jour en jour les petits progrès qu’on y
fait, à combattre par des transports, par
des larmes et des soupirs, l’innocente
pudeur d’une âme qui a peine à rendre
les armes, à forcer pied à pied toutes les
petites résistances qu’elle nous oppose,
à vaincre les scrupules dont elle se fait
un honneur et la mener doucement là où
nous avons envie de la faire venir. Mais
lorsqu’on en est maître une fois, il n’y a
plus rien à dire ni rien à souhaiter ; tout
le beau de la passion est fini, et nous
nous endormons dans l’ennui d’un tel
amour, si quelque objet nouveau ne vient
réveiller nos désirs et nous présenter les
charmes attrayants d’une conquête à
faire. (Molière, Dom Juan, Acte I, scène
2)
On rapprochera ce texte admirable d’une formule du très pes-
simiste Schopenhauer : « La vie humaine est un pendule qui
oscille de la souffrance à l’ennui. » Quand y a-t-il souffran-
ce ? Lorsque manque l’objet du désir. Quand y a-t-il ennui ?
Lorsque l’objet a perdu de son charme, et que manque le
manque. Tout objet du désir se présente à nous, semblant
nous murmurer : c’est de moi que tu manquais ! Lorsque tu
me tiendras dans tes bras, plénitude, accomplissements lumi-
neux, douceur, et joie, seront ton lot pour toujours !
Pour toujours ? Eh non... L’objet que mon imagination avait
enchanté, recréé, idéalisé, sera-t-il durablement à la hauteur
de l’image que je m’en étais faite ? Rien n’est moins sûr. Et
Guitry de nous murmurer que « les plus belles amours com-
mencent dans le champagne... et finissent dans la tisane. »
Et c’est précisément pour quoi Dom Juan multiplie les objets
du désir, court de femmes en femmes comme une pierre en
ricochets sur l’onde, avant de sombrer dans l’abîme [2]. Car
le désir ne rend pas l’homme durablement heureux, et
puisque l’homme n’est heureux que dans ce bref moment où
il ne souffre plus et ne s’ennuie pas encore, eh bien que ce
moment se répète le plus souvent possible ! Il importe donc
que le désir se réalise, mais qu’il ne se réalise pas trop vite.
Toujours est-il que le temps est l’âme même du désir, que les
jeux du désirs sont toujours des jeux sur le temps, qu’en
l’espèce il faut laisser du temps au temps. Laisser du temps
au temps, c’est ne pas tout programmer, lui «laisser la main»
comme disent les joueurs, le laisser inventer, faire en sorte
que l’avenir soit autre chose qu’une simple répétition du
passé. On se souvient du Fragment d’Héraclite :
11

Le temps est un enfant qui joue ; il
joue au tric-trac. Royauté d’un enfant
qui joue.
Et de ce très célèbre Fragment 52, on tirera l’idée que s’en
remettre au hasard, à la Fortune, à ses caprices, sa versatilité,
est l’une des formes de l’art d’aimer.
Ce lien indestructible entre Eros et Chronos, c’est-à-dire
entre le désir et le temps (ce que le temps a d’imprévisible,
d’inventif, de créateur), se cristallise dans ce que nous pour-
rions appeler le charme de l’attente. Que l’attente soit tou-
jours signe d’une impuissance, d’une ignorance, d’une passi-
vité ne fait rien à l’affaire ! Elle est, dans les meilleurs
moments de l’amour, un plaisir sans égal. Car l’attente est
impuissance, ignorance, et passivité. Si j’attends, c’est préci-
sément parce que je n’ai pas le pouvoir de hâter le temps, et
c’est pourquoi l’attente est impuissance ; si j’attends, c’est
parce que je ne sais combien de temps j’attendrai, et c’est
pourquoi l’attente est ignorance ; si j’attends, c’est parce que
mon action ne saurait y rien changer, parce que le temps de
l’attente dépend de ce qui ne dépend pas de moi, et c’est
pourquoi l’attente est passivité. Ceci, pour le pire comme
pour le meilleur. Pour le pire, quand j’attends le train dont le
retard risque de me faire manquer ma correspondance ; pour
le meilleur, quand cette attente est attente du moment déli-
cieux où se révèlera la jolie nudité, où se donnera le baiser
qui s’est fait attendre. Louise de Vilmorin disait que la
pudeur «fait le prix des abandons, et le charme de l’amour.»
Précisément, la pudeur, hésitation de celle qui se fait attend-
re, donne seule son prix au moment du don de soi qu’est l’a-
bandon [3]. Piment du désir, tout autant que vertu de retenue,
la pudeur participe du plaisir d’amour, et il faut manquer de
sens érotique autant que Sade en manqua pour la juger «pré-
jugé ridicule, que les Philosophes ne tarderont pas à dissi-
per.» Nous est-il permis, chers Philosophes des Lumières, de
vous répondre que le désir est d’essence crépusculaire, que le
corps n’est désirable que s’il n’est, ni en pleine lumière, ni en
pleine obscurité, que rien n’est plus érotique que le clair-obs-
cur ?
C’est ainsi que nous semble se nouer le lien indestructible
entre le désir et le temps : entre un manque qui est en même
temps une possession, celle de l’image de la chose dont on
manque, et un temps par définition imprévisible, impossible
à programmer ou à prévoir, et par là source de bien des joies,
comme de bien des souffrances : le temps de l’attente [4].
Ce lien indestructible, ce colloque singulier entre Eros et
Chronos, il fallait cependant qu’un événement vint le trou-
bler. Et cet événement, c’est l’impuissance masculine...
SCENE 2 : Eros privé de ses moyens
Nous disions plus haut l’attente érotique être, pour l’homme
qui désire, à la fois une impuissance et un plaisir : une
impuissance, parce que c’est à la femme courtisée de décider
du moment de l’abandon ; un plaisir, parce que c’est l’atten-
te qui donne à l’abandon son prix. Certes, mais cela n’est vrai
que pour qui peut attendre ! Aurai-je encore les moyens tur-
gescents de satisfaire mon désir lorsqu’aura sonné l’heure de
le satisfaire ? Evidemment, le phénomène qui nous réunit
aujourd’hui, c’est le phénomène de l’impuissance masculine,
et la plainte du patient qui n’a pas les moyens de ses désirs.
Phénomène aussi vieux que l’humanité, certes, et qui suscita
bien des parades : une fois constaté avec S. Guitry que la
supériorité des femmes sur les hommes est que «elles, elles
peuvent faire semblant...», une fois constatée l’inefficacité de
toutes les poudres de perlimpinpin, que reste-t-il aux hom-
mes, sinon la bravache,la sagesse, et la demande de ten-
dresse ?
*La première parade, fort rare en vérité, fut la bravache.
Salvador Dali en fut l’incarnation même, qui passait son
temps à se vanter de son impuissance. On se souvient du
dialogue qu’on qualifiera à bon droit de «surréaliste» entre
J. Chancel et S. Dali lors de la Radioscopie d’y-celui :
J. Ch. : Est-ce que c’est dur parfois
d’être S. Dali ?
S. D. : C’est mou ! Tout d’abord
parce que je suis le peintre des montres
molles ; et puis parce que je n’ai que de
toutes petites érections, je suis quasi-
ment impuissant, et je m’en vante : c’est
une sorte de vantardise à l’envers, la
plupart des autres hommes ne vantant
que leur dureté...
** La deuxième attitude, la sagesse, consiste à faire contre
mauvaise fortune bon coeur, en pratiquant cette sagesse
du consentement au destin que fut la sagesse stoïcienne.
Il s’agit d’accueillir ce qui arrive avec calme ; ma présen-
te impuissante doit avoir un sens dans la conjoncture
générale de l’univers, il y a une saison pour tout, etc...
Bref, quand on n’a pas les moyens de ses désirs, il faut
avoir les désirs de ses moyens.
*** La troisième parade consiste à faire appel aux réserves
de tendresse et de compréhension de la belle ici présen-
te. Contre mauvaise fortune, appel à son bon coeur. Soit,
mais encore faut-il que la belle ait bon coeur, que son « ce
n’est pas grave, ne t’inquiète pas mon grand ! » ait vrai-
ment l’air de venir du coeur. Car que surgisse un infime
doute à ce sujet, la plus fugace et fugitive impression
qu’elle se moque, et le monde de s’effondrer. La puissan-
ce est partout : dans la turgescence des fleurs, dans la
corne du rhinocéros [5], dans le chant des oiseaux du
printemps, partout s’exprime ce que Spinoza appelait le
12

conatus essendi [6], et cette puissance manquerait en
moi ? Pourquoi serais-je le lieu d’une faille, d’un man-
quement à cette universelle et naturelle puissance ? Et
comment pourrai-je me consoler en me disant que cela
arrive à tous, puisque sur ce thème tous les hommes,
quelques daliniens exceptés, mentent, et jouent la comé-
die ?
On dira qu’il faut prendre en compte le fait que le point de
vue de la femme sur le couple n’est pas le même que celui de
l’homme : la femme privilégierait les attentions et les appro-
ches sensuelles, l’homme la pénétration et les coups de bou-
toir... (A la limite, c’est l’amour sans le sexe pour l’une, et le
sexe sans amour pour l’autre). On dira, comme Georges
Brassens, que «95 fois sur 100, la femme s’emmerde en bai-
sant», que celle qui suscite en nous «tant de passion brutale,
la femme est avant tout sentimentale. Main dans la main les
longues promenades, les fleurs, les billets doux, les séréna-
des...»
On dira, en effet, tout ce qu’on peut en dire, il n’empêche
que cet événement est presque toujours vécu comme une
sorte de drame. Car il semble que et cette bravache, et cette
sagesse des limites (l’acceptation sereine des limites de la
nature), et cet appel à la tendresse, ne soient plus guère d’ac-
tualité. A cela, bien des raisons, que nous pouvons essayer de
dégager.
* Tout d’abord ce culte de la performance, du «toujours
plus», de la jeunesse éternelle, de la sexualité épanouie
[7],qui plonge nécessairement dans l’angoisse tous ceux
qui ne se jugent pas à la hauteur requise.
** Ensuite une dimension du désir que nous avons pour l’ins-
tant oubliée : son caractère mimétique. Comme l’a bien
montré René Girard, le désir est d’abord imitation du
désir, et rivalité : le désirable, c’est le déjà désiré. Pour-
quoi lui y parvient-il encore à son âge, et moi pas ?
*** Enfin quelque chose comme une indifférenciation des
sexes, dont les exemples sont nombreux. Car Catherine
Millet est venue... Infatigable petite travailleuse du sexe
mécanique [8], elle symbolise à merveille l’idée moderne
selon laquelle il n’y a pas entre l’homme et la femme,
entre la sexualité masculine et la sexualité féminine, de
différence radicale. Idée résumée par J. Derrida en une
saisissante formule : « Il n’y a pas de différence des sexes,
il y a des différences de sexe. »
Indifférenciation donc, mais aussi mécanisation, déshumani-
sation de la sexualité, ce que C. Millet résume avec parfaite
clarté en son éloge de la partouze, scène où l’on ne fait plus
l’amour avec une personne, mais avec une partie d’une per-
sonne, totalement réduite à un outil. Le bon Taylor avait-il
jamais prévu que les Temps modernes pourraient être aussi
ceux d’une taylorisation de la sexualité, où le corps humain
jouerait le rôle d’un rouage sur la «chaîne de montage», si
l’on ose s’exprimer ainsi ? La logique à l’œuvre ici est bien
celle des branchements, des combinatoires, le but étant de
produire des «effets de jouissances» [9]. Mais ce corps dés-
investi, morcelé (et précisément, morcelé parce que désin-
vesti), ensemble de jouets ou d’instruments est-il encore un
corps ? La mécanisation de l’érotisme n’est-elle pas son pur,
et simple arrêt de mort ? Et C. Millet de s’interroger : «Est-
ce que je ne baisais pas pour que baiser ne soit plus un pro-
blème ?»
Evidemment, désérotiser la sexualité en la mécanisant est le
meilleur moyen de la déproblématiser : le désir est chose si
problématique... Et que dire de l’amour ? Réduisons l’amour
au désir, le désir au besoin, et satisfaisons-le ! Il était fatal
que ce désinvestissement des corps, requis pour que se vive
une sexualité mécanisée et performante, aboutît à la mort du
désir et de l’amour : ceux-ci supposent les jeux angoissants,
mais souvent délicieux, problématiques en tous cas, de l’at-
tente, de la patience, de l’imagination, de la pudeur ; il faut
du temps pour que l’esprit investisse le corps pour en faire
une chair ! Et c’est précisément de ce temps de l’attente que
nos mécaniciens ne voulurent plus... L’oeil focalisé, moins
sur un corps-objet, que sur les objets qui composent ce corps,
nommés «zones érogènes», ils en oublièrent, et très logique-
ment, qu’un corps investi par un esprit amoureux, qu’une
démarche, qu’un mouvement de pudeur, qu’un sourire (qui
n’est pas une zone, mais une adresse, et une intelligence),
qu’une voix sont éminemment capables de générer du désir.
Chez C. Millet, la nudité n’est plus que de fonction, néces-
saire au fonctionnement des corps-baisants. Tout ce qui pou-
vait lui donner du charme, comme ce jeu très subtil sur la
pudeur et l’impudeur, cette légère rougeur qui vient à l’être
d’esprit qui s’avoue être de nature, cette ombre que tente de
réinventer en serrant encore les cuisses celle qui sur le corps
ne possède plus l’ombre d’un vêtement, tout ce qui pouvait
lui donner du charme est rigoureusement éconduit. Lévinas
disait que la nudité d’un mur nu n’a rien à voir avec la nudi-
té d’un corps nu. Et certes : même nu, on était encore vêtu de
sa pudeur.
On dira que chacun est libre d’inventer les chemins de sa vie
sexuelle, du moment que jamais les moyens de la contrainte
et de la violence ne sont utilisés, et qu’il n’y a nulle raison
pour que tous suivent la mode de la mécanisation du sexe.
Mais ne vivons-nous pas une époque où il semble que le célè-
bre slogan soixante-huitard « Jouissez sans entraves ! », de
proposition, d’invitation qu’il était d’abord, soit devenu
quelque chose comme un commandement, une injonction ?
Et si ce slogan devient normatif, alors comment ne pas faire
de son non-respect une pathologie ? Et puis on n’y peut mais:
le désir est mimétique, et puisqu’une sexualité sans amour et
même sans désir semble à présent normale, et donc désirable,
je ne puis faire autrement que de la désirer. Que faire cepen-
dant quand manquent les moyens ? C’est alors que devait
venir Viagra ; qui vint en effet...
13

SCENE 3 : Entrée de Viagra
On savait déjà que le terme grec pharmakon, désignait à la
fois le remède et le poison [10]: affaire de dose, de moment,
de personne. Avec le Viagra, ne fait-on pas un pas de plus
dans l’ambivalence ? Car en vérité, on ne touche pas avec
impunité à un domaine aussi «chatouilleux» que celui de
l’impuissance masculine. Comme le dit là encore D. Fols-
cheid, un des problèmes majeurs posés par la médicalisation
de la sexualité est qu’elle implique une pathologisation pré-
alable : l’un des premiers effets de Viagra fut de remplacer
l’impuissance, peut-être naturelle au-delà d’un certain âge,
mais souvent vécue comme une terreur, une tare, une fatalité
ou un accident, par une pathologie dûment identifiée : le dys-
fonctionnement érectile.
Deux effets, au moins, de cette pathologisation de l’impuis-
sance, peuvent être ici dégagés.
Le premier est un nouvel accroissement de la puissance
médicale. Armé du Viagra, le «pouvoir médical» s’arroge le
contrôle sur la puissance, donc sur la jouissance des hom-
mes... Nous n’y insisterons guère. Notons seulement qu’au
culte de la jeunesse et de la performance que nous évoquions
plus haut, Viagra semble vouloir donner quelque chose
comme une légitimation scientifique : puisqu’il est désor-
mais possible d’être en tous lieux et à tout âge performant,
pourquoi s’interdire de l’être ? On aurait tort de s’en priver...
Triste monde cependant, qu’un monde entièrement dominé
par l’appareil technoscientifique.
Le second est plus complexe, mais pas moins important :
penser l’impuissance comme un dysfonctionnement, cela
suppose que la sexualité soit pensée comme un fonctionne-
ment. On admettra que le bon fonctionnement de l’érection
est sans doute le moyen d’un union sexuelle «réussie», et
celle-ci le moyen d’une relation amoureuse elle-même «réus-
sie». Soit. Mais que l’admettre ne nous fasse pas oublier cette
tendance éternelle du moyen à s’ériger en fin en soi... Et cela
est en vérité une fort vieille histoire ! Celle de Lucifer, le plus
beau des anges, le porteur (fero voulant dire porter en latin)
de lumière (lux, lucis), messager [11] de la lumière divine,
intermédiaire entre Dieu et les hommes, qui un jour ne sup-
porta plus que les hommes fussent plus attentifs au message
qu’il portait, qu’au beau messager qui le portait, et voulut
être considérer pour lui-même. La chute de l’ange, c’est en
vérité le moyen qui s’érige en fin en soi, oubliant qu’il n’est
que moyen.
Que le fonctionnement érectile soit nécessaire à l’amour est
probable ; que l’amour soit un fonctionnement ne l’est pas.
En d’autres termes, il nous semble que la surrection de Via-
gra dans les jeux de l’amour participe à bien des égards de ce
que D. Folscheid appelle cette mécanisation de la sexualité,
dont nous avons aujourd’hui maints exemples. Remède au
dysfonctionnement érectile, Viagra ne risque-t-il pas d’être
en même temps poison pour l’amour ? Eternelle ambiguïté
de pharmakon... Nous ne parlons ici que d’un risque, et non
d’une certitude ! Mais nous demandons : crispé sur le fonc-
tionnement de son organe, notre homme prendra-t-il le temps
d’aimer ? La relation à son propre pénis ne finira-t-elle pas
par prendre plus d’importance que la relation à l’autre ? Un
corps-machine peut-il être un corps aimant ?
Précisément, ce qui nous semble devoir faire pencher la
balance du mauvais côté, ce sont les données très posolo-
giques de Viagra : que faire de cette heure nécessaire à l’ac-
tion du produit ? Que faire si la belle se fait désirer quatre
heures ? Que faire si elle se montre tendre et caressante au
petit matin, plus de quatre heures après l’ingestion de la peti-
te pilule miracle ? Bref : le temps nous est compté, ma belle.
Ce qui signifie qu’en l’espèce, c’est Viagra qui impose sa
chronologie à l’amant, plutôt que l’amant sa chronologie à
Viagra. Et Aphrodite de se retourner dans sa tombe [12]: le
temps de l’amour ne saurait être un temps programmé,
mathématisé, quantitatif, homogène ! Il n’a rien à voir avec
ce que Bergson appelait le temps des horloges, puisqu’il en
est l’oubli délicieux... Rien de moins aphrodisiaque que Via-
gra, donc, si Aphrodite est bien, comme nous apprirent nos
maîtres, la déesse de l’amour. Et comme disait encore Bras-
sens :
Du temps que vivait le grand Pan,
la moindre amourette était bénie par
Eros, Aphrodite, et compagnie...
Ce à quoi il faudrait répondre que tant que vivra Viagra, la
moindre amourette risque d’être hantée par techne, scientia,
et compagnie. Car il semble que ce soit bien au corps-machi-
ne que s’adresse Viagra : remède à un dysfonctionnement, il
invite le corps à fonctionner.
Il fallait donc que Cialis vînt, et Cialis est venu
SCENE 4 : entrée de Cialis
Et la différence de surgir, entre nos deux personnages : Via-
gra, Cialis. Alors que, comme on sait, la «fenêtre de temps»
alloué au couple par Viagra est de moins de 4 heures, celle
qu’ouvre pour eux Cialis est de 36 heures. Quel changement,
en vérité ! Car si tout pharmakon est, en puissance, à la fois
remède et poison, il nous semble qu’à bien des égards il est
peu probable que Cialis devienne jamais poison : libéré des
contraintes liées au temps et à la performance, nos amants ne
retrouveront-ils pas le temps de s’aimer, c’est-à-dire de s’ai-
mer sans programmer l’amour, qui le désenchante assuré-
ment ? Quand le pharmakon est-il remède ? Quand le phar-
makon est-il poison ? Pour répondre à ces questions, il nous
semble nécessaire de distinguer entre deux formes de tech-
niques. L’une aidant l’homme à réaliser sa nature sera dite
renaturatrice (ex. : la prothèse aidant l’amputé à retrouver
une démarche d’homme) ; l’autre l’aidant à dépasser les limi-
tes de sa nature sera dite dénaturatrice (ex. : le dopage mas-
culinisant les nageuses de la RDA et provoquant une défini-
14
 6
6
1
/
6
100%