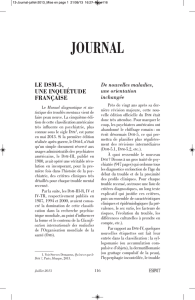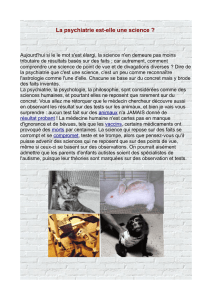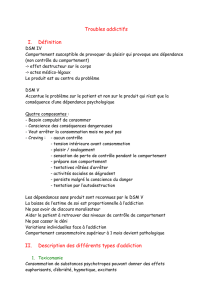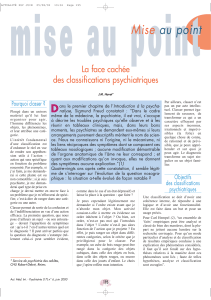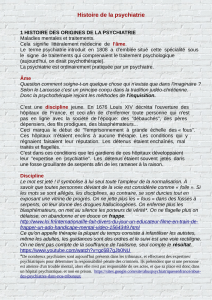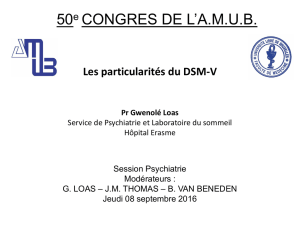Quel avenir pour les classifications des maladies mentales ? Une

Journal Identification = IPE Article Identification = 1054 Date: April 29, 2013 Time: 7:8 pm
L’Information psychiatrique 2013 ; 89 : 285–94
LES CLASSIFICATIONS
Quel avenir pour les classifications des maladies
mentales ? Une synthèse des critiques
anglo-saxonnes les plus récentes
Franc¸ois Gonon
RÉSUMÉ
Ces dernières années de hauts responsables de la psychiatrie anglo-saxonne ont vigoureusement critiqué la classification
américaine des maladies mentales, le DSM, mais ces critiques sont peu connues en France. Cet article en propose une
synthèse. Elles montrent que la fiabilité du DSM-IV est satisfaisante pour les pathologies sévères et médiocre pour les autres.
De plus, sa validité est faible puisque la plupart des patients souffrent d’une combinaison de troubles mentaux supposés
distincts et que la limite entre le normal et le pathologique se révèle très imprécise en pratique clinique. Ce manque de
scientificité reflète simplement notre ignorance concernant les troubles mentaux. Le DSM est pourtant largement utilisé par
une multitude d’acteurs. S’appuyant sur les études américaines, l’article présente ensuite quelques conséquences découlant
de l’état actuel du DSM.
Mots clés : nosologie, psychiatrie, DSM, étude critique, validité, fiabilité
ABSTRACT
What is the future for mental illness classifications? A summary of recent Anglo-American criticism. In recent years,
senior representatives of Anglo-American psychiatry have vigorously criticized the American classification of mental
illnesses, the DSM, but these criticisms are not very well known in France. This paper proposes a synthesis. They show that
the reliability of DSM-IV is satisfactory for severe pathologies whereas it is mediocre for others. In addition, its validity
is weak since most patients suffer from a combination of mental health disorders supposedly distinct and the supposed
distinct limit between normal and pathological has proven to be very inaccurate in clinical practice. This lack of scientificity
merely reflects our ignorance regarding mental disorders. The DSM is however widely used by a variety of caregivers.
Based on American studies, this article then presents some of the consequences of the current DSM.
Key words: nosology, psychiatry, DSM, critical analysis, validity, reliability
RESUMEN
¿ Que será de las clasificaciones de las enfermedades mentales ? Una síntesis de las críticas anglosajonas más
recientes. En los últimos a˜
nos altos responsables de la psiquiatría anglosajona han criticado fuertemente la clasificación
norteamericana de las enfermedades mentales, el DSM, pero estas críticas se conocen poco en Francia. Éste artículo
propone una síntesis de ellas. Se˜
nalan que la fiabilidad es satisfactoria para las patologías severas y escasa para las demás.
Además, su validez es baja ya que la mayor parte de los pacientes sufren de una combinación de trastornos mentales
supuestamente distintos y que el límite entre lo normal y lo patológico aparece muy impreciso en la práctica clínica. Esta
falta de cientificidad refleja simplemente nuestro desconocimiento en cuanto a trastornos mentales. El DSM sin embargo
está ampliamente utilizado por una multitud de protagonistas. Apoyándose en los estudios americanos el artículo presenta
luego algunas consecuencias derivadas del estado actual del DSM.
Palabras claves : nosología, psiquiátrica, DSM, estudio crítico, validez, fiabilidad
Neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS, Université Bordeaux-II, Institut des maladies neurodégénératives, CNRS UMR 5293, 146, rue
Léo-Saignat, 33076 Bordeaux, France
Tirés à part : F. Gonon
doi:10.1684/ipe.2013.1054
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦4 - AVRIL 2013 285
Pour citer cet article : Gonon F. Quel avenir pour les classifications des maladies mentales ? Une synthèse des critiques anglo-saxonnes les plus récentes. L’Information
psychiatrique 2013 ; 89 : 285-94 doi:10.1684/ipe.2013.1054

Journal Identification = IPE Article Identification = 1054 Date: April 29, 2013 Time: 7:8 pm
F. Gonon
Introduction
La psychiatrie reste un domaine singulier parmi
les sciences médicales. Contrairement à de nombreux
domaines en médecine somatique et malgré d’intenses
efforts depuis un demi-siècle, la recherche en biologie n’a
pas contribué de manière notable aux progrès de la pratique
clinique [10]. Bien souvent, ce sont des découvertes faites
par hasard qui ont permis de proposer de nouveaux traite-
ments, puis des recherches cliniques qui en ont prouvé les
bénéfices et les limites. Plus fondamentalement, la classifi-
cation des maladies mentales fait toujours débat. Le présent
article synthétise les critiques portées à l’encontre des deux
classifications actuellement dominantes : le Manuel sta-
tistique des maladies mentales dans sa quatrième version
(DSM-IV) publié par l’Association des psychiatres améri-
cains (APA) et la Classification internationale des maladies
proposée par l’OMS dans sa dixième version (CIM-10).
Le DSM-IV et la version encore en vigueur de la CIM-
10 ont été publiés à deux ans d’écart (1994 et 1992) et
leurs concepteurs les ont voulus proches. Par conséquent,
les critiques récentes visant le DSM-IV sont aussi large-
ment applicables à la CIM-10. Nous avons sélectionné ici
les critiques émanant des psychiatres anglo-saxons les plus
connus et les plus respectés. Nous avons en particulier lar-
gement cité quatre responsables du DSM-IV, Allen Frances,
Michael First, Robert Kendell et Melvin Sabshin, ainsi que
Steven Hyman qui a dirigé le National Institute of Men-
tal Health (NIMH, États-Unis) et préside actuellement le
Groupe de travail chargé de la révision de la CIM-10 pour
les maladies mentales. Cet article a pour but principal de
rendre accessible au public francophone une synthèse des
critiques anglo-saxonnes les plus récentes.
Le DSM est-il scientifiquement validé ?
Une synthèse des critiques
américaines actuelles
Bref rappel historique
Ce bref rappel s’appuie sur l’article du psychiatre améri-
cain Joseph Pierre [32]. La première version du DSM date
de 1952 et la deuxième, le DSM-II, de 1968. Le DSM-
II distinguait entre les pathologies d’origine organique et
celles d’origine psychogène, ces dernières étant divisées en
deux classes : les psychoses et les névroses. Il était donc
clairement influencé par les psychiatres qui pratiquaient la
psychanalyse et souhaitaient voir leurs traitements pris en
charge par les assurances. Dans les deux cas, les différentes
pathologies étaient définies par des descriptions de patients
types (descriptions prototypiques).
Par rapport aux précédentes, la troisième version (DSM-
III), publiée en 1980, a représenté une véritable rupture.
Les raisons politiques et sociales de ce changement ont été
analysées notamment par Stuart Kirk et H. Kutchins [17].
Deux objectifs scientifiques ont aussi guidé les rédacteurs
du DSM-III. Premièrement, le principe des descriptions
prototypiques du DSM-II a été considéré comme la cause
de sa mauvaise fiabilité inter-juge : les décisions diagnos-
tiques prises par deux médecins à propos du même patient
étaient trop souvent différentes. Il a donc été décidé de
définir chaque diagnostic par une liste de critères et des
règles d’exclusion. Deuxièmement, les hypothèses psycha-
nalytiques concernant l’étiologie des maladies mentales
ont été critiquées par l’APA pour leur manque de preuves
scientifiques. Constatant qu’aucune théorie ne permet-
tait de rendre compte de cette étiologie, l’APA a décidé
que le DSM-III serait athéorique : chaque maladie n’est
définie que par ses symptômes caractéristiques. Les pro-
moteurs du DSM-III espéraient ainsi que la recherche en
psychiatrie biologique permettrait de découvrir des mar-
queurs biologiques spécifiques à chaque pathologie et que la
recherche de nouveaux médicaments psychotropes en serait
facilitée.
Publié en 1994, le DSM-IV, et sa version révisée en
2000, ne présentent pas de changement majeur par rapport
au DSM-III. Depuis 1999, l’APA prépare une cinquième
version et sa publication sans cesse repoussée est mainte-
nant annoncée pour mai 2013. Cependant, les oppositions
aux changements entre DSM-IV et DSM-V ont été si vives
aux États-Unis que, selon son annonce du 1er décembre
2012, l’APA a finalement tranché en faveur de modifica-
tions mineures.
Le DSM et la recherche de marqueurs
biologiques des maladies mentales
Malgré d’intenses recherches depuis la publication du
DSM-III en 1980, aucun marqueur biologique (tests géné-
tiques ou biochimiques, imagerie cérébrale, etc.) n’a encore
été validé pour aider au diagnostic des troubles mentaux.
Citons par exemple Greg Miller dans un éditorial de la
prestigieuse revue Science : « Quand la première confé-
rence de préparation du DSM-V s’est tenue en 1999, les
participants étaient convaincus qu’il serait bientôt possible
d’étayer le diagnostic de nombreux troubles mentaux par
des marqueurs biologiques. Actuellement [en 2010], les
responsables reconnaissent qu’aucun indicateur biologique
n’est suffisamment fiable pour contribuer au diagnostic »
[27]. Il est maintenant certain que le DSM-V ne mention-
nera aucun biomarqueur d’aide au diagnostic. Selon Allen
Frances, la mise au point de biomarqueurs en psychiatrie
prendra plusieurs décennies et ceux-ci ne seront de toute
fac¸on applicables qu’à un petit nombre de patients souf-
frant des pathologies les plus sévères [8]. Allen Frances
explique:«silesneurosciences ont fait progresser notre
connaissance du fonctionnement cérébral, plus nous en
apprenons sur le cerveau plus celui-ci apparaît d’une iné-
luctable complexité » [8]. C’est également l’avis de Steven
286 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦4 - AVRIL 2013

Journal Identification = IPE Article Identification = 1054 Date: April 29, 2013 Time: 7:8 pm
Quel avenir pour les classifications des maladies mentales ? Une synthèse des critiques anglo-saxonnes les plus
récentes
Hyman:«Laneurobiologie a fait de réels progrès, mais n’a
pas encore atteint un niveau qui lui permettrait de contri-
buer utilement à la définition des différentes pathologies »
[12].
La fiabilité inter-juge du DSM
D’après son principal promoteur, Robert Spitzer, la fia-
bilité inter-juge1du DSM-III était supérieure à celle des
précédents DSM [41]. En réalité, selon Michael First [5],
une seule étude a comparé dans les mêmes conditions
la fiabilité du DSM-III à celle du DSM-II. Il en ressort
que les deux fiabilités sont identiques. Comme on pouvait
s’y attendre, elles sont satisfaisantes pour les pathologies
les plus sévères et médiocres pour les autres [25]. Selon
Michael First [5] et Allen Frances [7], la fiabilité inter-
juge des DSM-III et DSM-IV a été largement surestimée.
De plus, cette fiabilité est encore plus médiocre en pra-
tique clinique. Ainsi, le diagnostic posé par des chercheurs
expérimentés utilisant les protocoles standardisés recom-
mandés par le DSM diffère souvent de celui des psychiatres
en pratique clinique quotidienne pour le même patient
[33, 39]. Par exemple, pour les pathologies non psycho-
tiques, l’accord entre les spécialistes et les cliniciens était
nettement insuffisant avec un coefficient kappa de fiabilité
inter-juge variant entre 0,12 et 0,33 (ce coefficient varie
entre de0à1pour une parfaite fiabilité inter-juge. En
médecine, un kappa supérieur à 0,5 est considéré comme
satisfaisant) [39].
La validité du DSM
La validité est le critère le plus « scientifique » d’une clas-
sification. Pour que la définition d’une maladie soit valide,
elle doit permettre de la distinguer des autres maladies
et de la normalité. En médecine somatique, les mar-
queurs biologiques ont beaucoup contribué à la définition
d’entités valides. Leur absence en psychiatrie représente
donc un handicap considérable. Cependant, il est arrivé que
certaines pathologies uniquement définies par leurs symp-
tômes soient reconnues comme valides malgré l’absence
de biomarqueurs et sans qu’on en connaisse l’étiologie.
Par exemple, le syndrome de Down a été décrit et reconnu
comme une entité dès le début du xixesiècle sur la base
de critères physiques (le « mongolisme ») associés au
retard mental et n’est devenu la « trisomie 21 » qu’en
1959. En l’absence de biomarqueur et d’étiologie connue,
la validité d’une pathologie repose alors sur une description
permettant de la distinguer des autres pathologies et de la
normalité.
Pour Robert Kendell, psychiatre britannique qui a été
très impliqué dans la production des DSM-III et -IV, si l’on
1La fiabilité inter-juge est le degré d’accord entre les diagnostics posés
par différents médecins à propos d’un même patient.
s’accorde sur cette définition de la validité, le constat est
clair : les diagnostics psychiatriques définis par le DSM-IV
ne peuvent pas être considérés comme valides. D’ailleurs,
le préambule du DSM-IV reconnaît explicitement que la
validité des définitions proposées n’est nullement prouvée
[14]. Les études publiées depuis lors vont toutes dans le
sens d’une absence de validité pour quatre raisons qui ont
été soulignées aussi bien par Robert Kendell [14] que par
Steven Hyman [12]. Premièrement, la plupart des patients
souffrent d’une combinaison variable de plusieurs troubles :
la comorbidité, qui aurait du rester rare si la validité du
DSM avait été satisfaisante, est en réalité très fréquente
[19]. Deuxièmement, le DSM-IV et la CIM-10 sont organi-
sés en différentes classes de pathologies qui sont divisées en
entités très spécifiques, mais prévoient pour chaque classe
une catégorie non spécifiée (not overwise specified [NOS]).
Les enquêtes montrent que les catégories NOS sont beau-
coup plus souvent utilisées que les autres par les praticiens,
et en particulier les médecins généralistes, alors qu’elles
auraient dû rester l’exception. Steve Hyman en conclut que
les trop nombreuses catégories étroitement spécifiées ne
correspondent pas, aux yeux des cliniciens, à des entités
« naturelles » [12]. Troisièmement, la frontière entre état
pathologique et normalité est nette pour les pathologies
sévères, mais franchement imprécise pour les troubles plus
bénins comme la dépression [2, 14, 42]. Cela est cohérent
avec le fait que des enquêtes épidémiologiques réalisées à
la même période aux États-Unis puissent donner des résul-
tats très divergents [35]. Par exemple, la prévalence sur un
an de la phobie sociale était de 1,6 % dans une étude et de
7,4 % dans l’autre [35]. Quatrièmement, une même cause
peut entraîner des pathologies différentes. Par exemple,
les adultes qui ont subi des abus sexuels dans l’enfance
peuvent souffrir de dépression, de troubles anxieux, de
trouble du comportement alimentaire ou de toxicomanie
[14]. De même, une altération chromosomique rare (dite
DISC1) observée sur plusieurs générations d’une famille
écossaise a entraîné des troubles très variables : schizophré-
nie, troubles des conduites, dépression, troubles anxieux
[1]. Steven Hyman en conclut : « Les données génétiques et
familiales ne confirment pas les limites des pathologies défi-
nies par le DSM-IV » [12]. Ce manque de validité explique
que la définition même de ce qu’est un trouble mental fait
toujours débat [29].
Le DSM est-il utile ? Une synthèse
des critiques américaines actuelles
Robert Kendell soulignait la nécessité de bien distinguer
la validité de l’utilité. Il considérait que les catégories du
DSM-IV n’étaient pas valides, mais qu’elles étaient utiles.
De fait, on a du mal à voir comment la psychiatrie cli-
nique pourrait se passer de toute classification. Des troubles
mentaux sévères ont été reconnus comme tels dans toutes
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦4 - AVRIL 2013 287

Journal Identification = IPE Article Identification = 1054 Date: April 29, 2013 Time: 7:8 pm
F. Gonon
les cultures. Même si on ne sait pas bien les définir, les
patients qui en souffrent nécessitent des soins spécifiques.
Mais contrairement à la validité qui est un critère universel,
le degré d’utilité dépend de l’utilisateur. Or, le DSM est
utilisé par de multiples agents :
– les chercheurs en psychiatrie biologique, en épidémiolo-
gie et en psychopharmacologie clinique ;
– les médecins qui vont du psychiatre universitaire au géné-
raliste et les autres soignants ;
– les experts judiciaires ;
– les patients et leur famille, notamment via Internet ;
– l’industrie pharmaceutique pour ses essais cliniques mais
aussi pour son marketing ;
– les caisses d’assurances publiques et privées ;
– les enseignants en psychologie et psychiatrie.
Comme le souligne un groupe de psychiatres américains
et canadiens, le DSM ne peut pas également satisfaire des
utilisateurs aussi divers [31].
L’utilité du DSM pour la recherche
Le DSM-III a été en partie conc¸u pour faciliter la
recherche de marqueurs biologiques. Trente ans plus tard,
le bilan sur ce point est négatif. Certains chercheurs consi-
dèrent même que les incertitudes du DSM ont handicapé la
recherche de gènes impliqués dans les troubles psychia-
triques : « nous ne savons pas si les divers diagnostics
correspondent à des maladies différentes ayant des causes
biologiques distinctes » [1]. Le NIMH, qui finance aux
États-Unis l’essentiel de la recherche publique en neuros-
ciences, en a tiré les conséquences. Considérant, selon son
ancien directeur Steven Hyman, que « le DSM a été un obs-
tacle pour la recherche », le NIMH a proposé de financer
des recherches hors DSM [26]. Quant à l’épidémiologie
des troubles mentaux, il est apparu que l’usage du DSM
entraînait de larges divergences dans l’estimation de leur
prévalence [35] en raison de l’importante comorbidité [19]
et de l’imprécision des limites entre normal et pathologique
[2].
L’utilité du DSM pour la psychopharmacologie
clinique
Les recherches cliniques en psychopharmacologie ont
utilisé le DSM et la CIM associés aux méthodes de la méde-
cine par les preuves et ces travaux ont incontestablement
permis de mieux évaluer l’efficacité des médicaments psy-
chotropes. Par exemple, il a fallu de nombreuses études
rigoureuses pour aboutir à la conclusion que, sauf pour
les dépressions très sévères, les antidépresseurs SSRI,
tant promus par l’industrie pharmaceutique, ne sont pas
plus efficaces qu’un traitement placebo [6, 16, 18]. Au
total, il est indiscutable que le réel progrès des connais-
sances en psychopharmacologie clinique a été accompli
grâce aux deux classifications internationalement recon-
nues par la majorité des chercheurs. Cependant, rien ne
permet d’affirmer qu’une autre classification, plus resser-
rée et basée sur des définitions prototypiques, aurait été
moins efficace.
L’utilité du DSM pour guider
les choix thérapeutiques
Un argument souvent mis en avant pour affirmer que le
DSM-III a représenté un progrès concerne le diagnostic de
la schizophrénie [12]. Une enquête de 1972 avait montré
que cette maladie était deux fois plus souvent diagnosti-
quée aux États-Unis qu’en Grande-Bretagne. Le DSM-III
a ajouté un critère de durée des symptômes psychotiques
(au moins six mois) qui a permis de la différencier net-
tement du trouble bipolaire de type I (maniacodépression
avec épisode maniaque nécessitant une hospitalisation). La
prévalence de la schizophrénie aux États-Unis est alors
redescendue au niveau de la Grande-Bretagne et le trai-
tement par les neuroleptiques a été remplacé par du lithium
chez de nombreux patients américains diagnostiqués à tort
comme schizophrènes [12]. En effet, le lithium n’est pas
efficace dans la schizophrénie, mais il l’est pour les troubles
bipolaires et ses effets secondaires sont moindres que ceux
des neuroleptiques.
Cependant, cet incontestable progrès ne doit pas mas-
quer le fait que, pour de nombreux troubles moins sévères
et plus fréquents, le DSM-IV ne guide pas le clinicien dans
le choix du traitement. Même un diagnostic posé en stricte
conformité avec le DSM-IV ne permet pas de prédire si tel
patient anxieux et/ou dépressif sera plus amélioré avec une
psychothérapie, un anxiolytique, un antidépresseur tricy-
clique, un antidépresseur SSRI ou une combinaison de ces
différents traitements. Ce qui importe pour le thérapeute
c’est de choisir un traitement et le diagnostic qui est posé
n’est bien souvent qu’une justification a posteriori de ce
choix initial [30].
L’utilité du DSM pour la pratique clinique
Une enquête, diligentée en 2010 par l’OMS auprès de
près de 5 000 psychiatres dans 44 pays, montre que les
deux tiers utilisent la version clinique de la CIM-10 [34].
Même aux États-Unis, les utilisateurs du DSM-IV le jugent
beaucoup trop compliqué avec ces 410 pathologies dis-
tinctes définies par des listes de critères, et préféreraient
la version clinique de la CIM-10. En effet, cette dernière
ne procède pas par listes de critères, mais propose des
descriptions types. Cette approche prototypique est pré-
férée par 69 % des psychiatres interrogés par l’OMS.
Les raisons de cette préférence et leur bien-fondé ont été
mises en avant par le psychiatre américain Drew Wes-
teen [43]. De plus, 88 % des psychiatres souhaiteraient
une classification réduite à un petit nombre de pathologies
distinctes (entre dix et 100) [34]. Ce point de vue est main-
tenant défendu par Allen Frances, Michael First et Steven
Hyman [5, 7, 13] ainsi que de nombreux autres psychiatres
288 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦4 - AVRIL 2013

Journal Identification = IPE Article Identification = 1054 Date: April 29, 2013 Time: 7:8 pm
Quel avenir pour les classifications des maladies mentales ? Une synthèse des critiques anglo-saxonnes les plus
récentes
américains [29-31]. En effet, puisque aucune classifica-
tion existante ne peut prétendre à une validité scientifique,
tous ces experts estiment qu’il faut privilégier l’utilité
clinique.
La place du DSM dans l’enseignement
de la psychiatrie
Dans de nombreuses universités, le DSM-IV est pré-
senté comme un manuel de psychiatrie, ce qu’il n’a jamais
prétendu être. Puisque la validité du DSM n’est pas discu-
tée, les étudiants sont conduits à penser que les pathologies
décrites dans le DSM représentent bien des maladies dis-
tinctes. La réussite aux examens dépendant souvent de la
restitution des catégories du DSM, sa connaissance litté-
rale en vient à représenter l’essentiel des connaissances en
psychiatrie [30]. Cet apprentissage aussi fastidieux que dis-
cutable se fait au détriment de connaissances plus utiles
comme la psychopharmacologie dans ses deux versants thé-
rapeutiques et iatrogènes. En tant que directeur médical
de l’APA entre 1974 et 1997, Melvin Sabshin a large-
ment contribué aux DSM-III et DSM-IV. En 1997, il signe
une vigoureuse mise en garde : « L’un des grands dan-
gers de la présente période est l’atrophie des compétences
psychothérapeutiques parmi les psychiatres. Le danger est
de faire du DSM une approche mécaniste où le clinicien
perd son sens clinique et son humanisme. Je déteste avoir
à examiner des candidats à des postes de responsabilités
qui récitent leur DSM. Nous devons continuer à ensei-
gner la clinique pour faire en sorte que les différences
entre patients soient reconnues et que nous restions atta-
ché à l’humanisme dans tout notre travail » [38]. Plus
récemment, Scott Waterman note qu’ilyadelapart des
enseignants qui connaissent les faiblesses du DSM, un cer-
tain « cynisme»àenimposer l’apprentissage littéral [30].
Les étudiants d’aujourd’hui étant l’avenir de la psychia-
trie, il est vraiment regrettable de leur imposer un pareil
« handicap conceptuel » [30].
L’utilité du DSM pour les assurances maladies
Dans l’état actuel, les classifications existantes repré-
sentent simplement un vocabulaire provisoire permettant
les prises de décision entre les soignants, les patients, leur
entourage et les assurances [31]. Une enquête auprès de
psychiatres américains a montré que les impératifs des
diverses assurances maladies privées influencent considéra-
blement leurs décisions diagnostiques [44]. L’utilité d’une
classification dépend donc du contexte social et politique.
Dans les pays où l’assurance maladie est principalement
publique, la prise en charge n’est heureusement pas condi-
tionnée par l’attribution précoce d’un diagnostic précis.
Cette influence des différences entre les systèmes de santé
explique aussi l’intérêt pour des classifications nationales.
L’enquête de l’OMS dans 44 pays a montré que 31 % des
psychiatres franc¸ais souhaitaient une classification natio-
nale. Ils n’étaient cependant pas les plus nombreux : après
les Cubains (80 %), 32 à 40 % des psychiatres qui ont
répondu à l’enquête en Argentine, Chine, Inde, Japon et
Russie le souhaitaient aussi.
Conséquences concernant l’avenir
du diagnostic et des pratiques
en psychiatrie
Optimiser l’utilité clinique des classifications
En l’absence de marqueurs biologiques et de frontières
nettes entre pathologie et normalité, aucune classification
ne peut se réclamer d’une réelle scientificité. Allan Frances
l’affirme très clairement:«Iln’yapasuneseule manière de
diagnostiquer n’importe quel trouble mental qui puisse être
considérée comme scientifiquement prouvée et ne laissez
aucun expert vous soutenir le contraire » [8]. De ce point de
vue, la CIM-10 n’est pas supérieure au DSM-IV, dont elle
est d’ailleurs proche. Comme la recherche de marqueurs
biologiques se détourne déjà du DSM et que la recherche
épidémiologique gagnerait à s’en affranchir, de plus en plus
de voix s’élèvent en faveur d’une classification simplifiée
optimisant l’utilité clinique [7, 12, 31].
Le DSM-V apportera peu de changements par rapport
au DSM-IV. En revanche, la 11eversion de la CIM, dont
la parution est annoncée pour 2015, pourrait bien être
très différente de la CIM-10. En effet, Geoffrey Reed, qui
est à l’OMS le responsable du projet de la CIM-11 pour
les maladies mentales, a annoncé en public le 5 octobre
2012 qu’il envisage une CIM-11 au plus près des souhaits
exprimés dans l’enquête de l’OMS. Le nombre de patho-
logies distinctes serait ramené à moins d’une centaine et
elles seraient définies par des descriptions type. Interrogé
sur les divergences que cela entraînerait entre le DSM-V
et la CIM-11, il a répondu qu’il n’y voyait aucun inconvé-
nient. Steven Hyman appelle également de ses vœux une
complète refonte du DSM où le nombre de pathologies
serait considérablement réduit [12, 13].
Limiter le rôle des experts
Bien entendu, les recherches en psychiatrie biologique
et en psychopharmacologie doivent êtres poursuivies avec
vigueur, même s’il ne faut pas en attendre des miracles
pour l’ensemble des troubles psychiatriques. En effet, il
n’est nullement exclu que pour certains cas de pathologies
sévères on puisse identifier des causes biologiques quanti-
fiables et traitables. Par exemple, plusieurs études récentes
montrent qu’un déficit sévère en vitamine D chez la mère
augmente fortement le risque d’autisme chez ses enfants
[4]. Si cette piste était confirmée, elle ouvrirait une possibi-
lité de prévention de certains cas d’autisme. Évidemment,
toutes ces recherches ne peuvent êtres engagées que par des
experts spécialisés dans une pathologie particulière.
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦4 - AVRIL 2013 289
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%