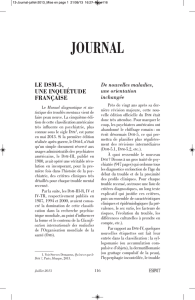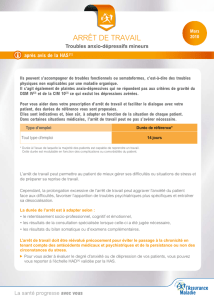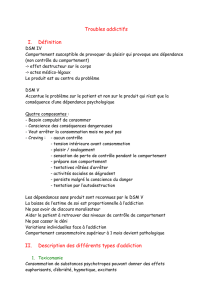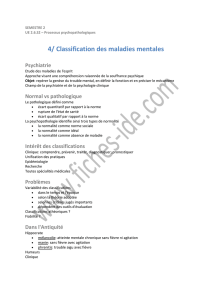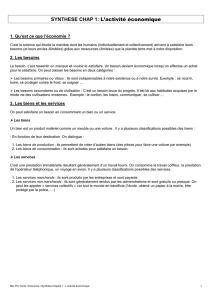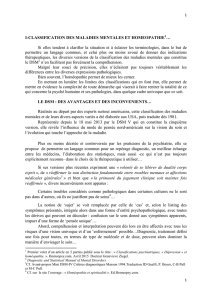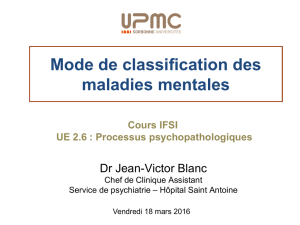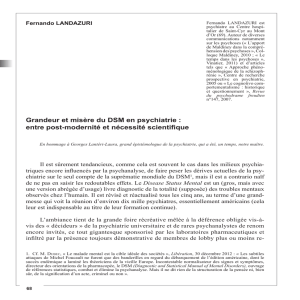mise au point

195
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) n° 6, juin 2000
mise au point
Pourquoi classer ?
Plongé dans un univers
matériel qu’il lui faut
organiser pour agir,
l’homme différencie les
objets, les phénomènes,
et leur attribue une caté-
gorie.
L’intérêt fondamental
d’une classification est
d’ordonner le réel en vue
de rendre son appréhen-
sion utile à l’action –
action qui sera spécifique
en fonction du problème
rencontré. Par exemple, si
j’ai faim, je me demande-
rai si cette plante est ou
non comestible ; si je suis
psychiatre, je me deman-
derai quel type de prise en
charge je devrai mettre en œuvre face à
un problème que je m’efforcerai de spéci-
fier, c’est-à-dire de ranger dans une caté-
gorie ou une autre.
Classer permet de sortir de la confusion et
de l’indifférenciation en vue d’une action
efficace. La première question, que nous
pose d’ailleurs un sujet – ou son entoura-
ge – devant l’apparition de symptômes
est : qu’a-t-il ? en d’autres termes quel est
le diagnostic ? Il peut arriver parfois que
la question du diagnostic s’estompe (tel-
lement celui-ci peut sembler évident,
comme dans le cas d’un état dépressif) et
laisse la place à la question : que faire ?
Je peux cependant légitimement me
demander si l’ordre existe avant que je
n’aborde mon objet. Mon activité
consiste-t-elle à mettre en évidence un
ordre inhérent à l’objet ? Ou bien, cet
ordre, n’est-ce pas moi qui l’introduis
dans l’objet ? L’ordre n’est-il pas alors
fonction de l’action que je projette ? En
effet, je puis ranger un objet dans diffé-
rentes catégories, selon le critère que je
privilégierai pour le classer. Par
exemple, un cube de bois rouge peut être
rangé dans la catégorie des objets
cubiques, dans celle des objets en bois,
dans celle des objets rouges, ou encore
dans celle des jouets d’enfant. Le choix
que j’opère reflète mon intention.
Par ailleurs, classer n’est
pas un pur acte intellec-
tuel. Classer permet éga-
lement de rassurer, de
transformer ce qui a un
caractère effrayant par
ses aspects inconnus,
irrationnels et imprévi-
sibles (la folie) en
quelque chose de connu,
de rationnel et de prévi-
sible, que je peux appré-
hender et sur quoi je
peux agir. Le diagnostic
transforme un sujet sin-
gulier en un objet fami-
lier.
Objectifs
des classifications
psychiatriques
Une classification se doit d’avoir une
cohérence interne, de répondre à une
logique et d’avoir une fonctionnalité.
Elle est faite dans un but et pour un
usage précis.
Pour Carl Hempel (2), “un ensemble de
‘faits’ empiriques peut être analysé et
classé de bien des manières, dont la plu-
part ne jettent aucune lumière sur la
recherche envisagée. Pour qu’un mode
particulier d’analyse et de classification
de résultats empiriques conduise à une
explication des phénomènes considérés,
il faut qu’il soit fondé sur des hypo-
thèses relatives à la manière dont ces
phénomènes sont liés ; faute de telles
hypothèses, analyse et classification
sont aveugles”.
Dans le premier chapitre de l’Introduction à la psycha-
nalyse, Sigmund Freud constatait : “Dans le cadre
même de la médecine, la psychiatrie, il est vrai, s’occupe
à décrire les troubles psychiques qu’elle observe et à les
réunir en tableaux cliniques, mais, dans leurs bons
moments, les psychiatres se demandent eux-mêmes si leurs
arrangements purement descriptifs méritent le nom de scien-
ce. Nous ne connaissons ni l’origine, ni le mécanisme, ni
les liens réciproques des symptômes dont se composent ces
tableaux nosologiques ; aucune modification démontrable
de l’organe anatomique de l’âme ne leur correspond ; et
quant aux modifications qu’on invoque, elles ne donnent
des symptômes aucune explication.“(1)
Quatre-vingts ans après cette constatation, il semble légiti-
me de s’interroger sur l’évolution de la question nosogra-
phique : la situation a-t-elle évolué de façon notable ?
*Service de psychiatrie des adultes,
CHU Robert-Debré, Reims.
La face cachée
des classifications psychiatriques
J.M. Havet*
Mise au point
ACTUALITÉ PSY JUIN 05/08/02 10:34 Page 195

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) n° 6, juin 2000 196
mise au point
La logique interne des classifications
psychiatriques actuelles est difficile à pré-
ciser, car elle n’est que peu – ou pas du
tout – explicitée. Mais ce qui est plus
grave, c’est que cette logique peut être
masquée par un discours (pseudo) scienti-
fique qui donne à la classification une
honorabilité que, fondamentalement, elle
ne possède pas.
Nos prédécesseurs étaient pragmatiques :
ils séparaient les malades agités des
malades tranquilles. Nos patients actuels
nous reprochent souvent le mélange des
genres dans nos institutions. Ils aimeraient
(eux qui sont, bien sûr, “moins atteints”)
être séparés des malades plus graves.
La morale a trouvé – et trouve certainement
encore – sa place dans les classifications :
jusqu’à la circulaire sur le secteur, l’inter-
diction sur la mixité conduisait à avoir, au
sein des établissements, des pavillons
d’hommes et des pavillons de femmes.
Cette séparation hommes/femmes serait
d’ailleurs encore bien vue par certains
maris, épouses ou parents de patients.
L’objectif suivant fut scientifique : la clas-
sification des données sous des rubriques
claires et distinctes était la condition sine
qua non de la méthode scientifique en
France à la fin du XVIIIesiècle, dit “des
lumières”. La nosologie devenait ainsi fon-
damentale pour donner le statut scienti-
fique auquel la psychiatrie aspirait.
En ordonnant les troubles observés, et en
les regroupant dans des grandes catégories
présentant des traits communs psycholo-
giques, comportementaux et langagiers, le
médecin pouvait envisager l’existence
d’un processus pathologique unique à
l’origine de chaque catégorie et penser
qu’il serait un jour possible d’avoir une
certaine action thérapeutique sur ce pro-
cessus.
En ces temps difficiles où les finances sont
réduites, les classifications ont également
(surtout ?) un intérêt économique. Sans
elles, aucune évaluation des pratiques et
des coûts n’est possible. On conçoit donc
aisément leur importance quand, à défaut
d’une politique de santé, on se limite à pri-
vilégie une politique de réduction des
dépenses de santé.
Critique des classifications
psychiatriques modernes
(et du DSM en particulier)
Athéorisme
Il s’agit d’une question qui s’est posée à
moi dès la publication, en 1983, de la tra-
duction française du DSM-III (3).
Je m’appuyais alors, pour démontrer l’im-
possibilité de l’athéorisme, sur des auteurs
aussi prestigieux qu’Albert Einstein qui
disait : “C’est la théorie qui détermine ce
que l’on peut observer.”
Plus récemment seulement, il m’est appa-
ru que le malaise que faisait naître en moi
cette question de l’athéorisme était lié à un
paradoxe : “J’ai pour théorie que je peux
me passer de théorie.”
La perspective descriptive
La description même des troubles et la
façon dont ils sont conçus rendent compte
de la structure du DSM et des problèmes
posés par cette classification.
Imaginons ce qui se passerait si un archi-
tecte décidait de définir les objets qui relè-
vent de sa compétence selon une méthode
descriptive. Imaginons donc un manuel
d’architecture conçu selon la méthodolo-
gie des critères diagnostiques. Au chapitre
bâtiments, nous trouverions les sections :
maison, logement, église, usine…
Les critères “diagnostiques” de la maison
pourraient être les suivants :
A - comporte obligatoirement la présen-
ce des éléments suivants :
1/ murs
2/ toit
3/ porte (s)
4/ fenêtre (s)
B - comporte obigatoirement la présence
d’au moins deux des éléments suivants :
1/ volets
2/ rideaux
3/ plafond
4/ cheminée
C - ne répond pas aux critères de :
1/ grange
2/ garage
3/ usine
4/ gymnase
5/ église
Cette façon de faire conduirait à classer
les maisons en tenant compte des diffé-
rents types, selon la région ou la forme :
à toit de chaume, en bois, en brique, etc.,
au milieu d’un jardin, avec des volets fer-
més…
Cette description ne rendrait en aucune
façon compte de ce qu’est une maison.
Elle ignorerait, en effet, qu’il s’agit d’un
lieu de vie qui porte la marque de celui
qui y habite, de celui qui y vit. Qu’y a-t-
il à l’intérieur ? En fait, cette construc-
tion a été réalisée avec un projet, dans un
but : une maison est faite pour se proté-
ger du froid, de la pluie, des intempéries,
des bêtes féroces et des intrus... En
d’autres termes, une maison a une fonction.
Ces réflexions ne sont pas pures considéra-
tions intellectuelles. Elles ont des consé-
quences pragmatiques, en particulier au
niveau de la démarche scientifique de com-
préhension des phénomènes, et spécifique-
ment de la recherche de leurs “causes”.
Des quatre grandes causes isolées par
Aristote, la science actuelle n’a retenu que
les causes :
– matérielles (les matériaux nécessaires à la
construction : les atomes, les molécules, la
sérotonine, la dopamine, la noradrénali-
ne…) ;
– efficientes (le travail du maçon : les
enzymes) ;
– et formelles (le projet architectural, le
programme de construction : le code
génétique).
Mise au point
ACTUALITÉ PSY JUIN 05/08/02 10:34 Page 196

197
Elle néglige donc les causes finales, sou-
vent considérées depuis Descartes
comme non scientifiques.
Une méthodologie descriptive des
troubles ne rend pas compte des aspects
fondamentaux de ceux-ci. Elle espère
cependant pouvoir être un point de départ
pour la recherche de ces aspects fonda-
mentaux. Nous reviendrons sur ce point
quand nous examinerons la question de
l’objectivité.
Des individus isolés
Le DSM, comme la majorité des classifi-
cations psychiatriques, décrit des indivi-
dus isolés de leur contexte familial, pro-
fessionnel, social ou culturel. Il
méconnaît l’importance des interactions
dans la constitution de l’être humain.
Les troubles qui y sont décrits deviennent
ainsi de pures abstractions déshumani-
sées, que l’on ne rencontre jamais dans la
pratique courante – à moins de penser et
de se comporter comme un robot social
sans affectivité.
Un patient quel qu’il soit ne peut exister
que dans un contexte qui l’influence et
qu’il influence, avec lequel il interfère.
Dans le DSM, autrui n’apparaît le plus
souvent que si le patient lui pose problè-
me (c’est en particulier le cas des
enfants) ou si le patient doit se cacher de
lui (c’est le cas des boulimiques qui
vomissent).
Pourtant, un trouble quel qu’il soit est
autant montré, vu et entendu qu’il est
vécu. Un trouble est également commu-
nication.
La temporalité
Malgré l’existence de critères de durée
(arbitraires) et quelques éléments
concernant l’évolution, les pathologies
sont décrites de façon intemporelle.
Le DSM décrit des états dans lesquels
l’histoire du sujet est absente. Ces états
sont théoriquement censés être les
mêmes en tout temps et à toute époque.
L’objectivité
La constatation est le point de départ de
toute classification. Les organes des
sens, indispensables à la constatation,
interviennent dans une proportion relati-
vement faible, tandis que la personnalité
de l’observateur participe tout entière à
cette activité.
En effet, en matière de psychiatrie,
l’homme utilise deux méthodes pour dif-
férencier les objets auxquels il est
confronté : il observe ce qui est à l’exté-
rieur de lui-même et analyse ce qui est à
l’intérieur de lui-même. L’homme, donc,
observe à partir de ses organes des sens,
et des éventuels outils qu’il a créés pour
prolonger ceux-ci (le microscope, le
scanner, les dosages biologiques…).
Mais l’homme ressent également, et il a
tendance à assimiler ses états internes à
ce qu’il observe : ma tristesse se caracté-
rise par telle ou telle manifestation (je
pense, je me comporte, je me présente de
telle ou telle manière) ; donc, si je
constate des manifestations identiques
chez une autre personne, je peux les rap-
porter à la tristesse, à la dépression.
Les penseurs se sont préoccupés d’élimi-
ner cette influence d’observateur afin
d’obtenir un résultat qui soit identique
pour n’importe quel individu qui consta-
te. C’est en cela que réside l’objectivité.
Il peut arriver, cependant, que par un rai-
sonnement inverse, on soit conduit à pen-
ser que si l’on a un résultat sur lequel tout
le monde s’accorde, comme la définition
d’un syndrome psychiatrique quel qu’il
soit, c’est un signe d’objectivité.
Ainsi, la méthode des critères diagnos-
tiques peut donner l’illusion d’une par-
faite objectivité, d’un repérage précis de
l’objet décrit, appréhendé. En réalité,
l’usager du DSM ne fait que préciser ce
qu’il entend (et ce que, éventuellement,
d’autres entendent de façon consensuel-
le). Il ne fait que préciser ses concepts.
Le DSM se situe dans une épistémologie
positive-réaliste. Il postule qu’il existe
une réalité extérieure à l’observateur que
ce dernier peut décrire avec objectivité de
façon précise s’il dispose des outils adé-
quats. Le DSM veut être l’un de ces
outils. Le DSM prétend éliminer la sub-
jectivité.
Comme il existe des objets dont la des-
cription ne peut rendre compte parfaite-
ment, il va modifier cette description et
évoluer au fil du temps, avec l’espoir
d’atteindre un jour à une description
complète et parfaite. En fait, c’est un
processus infini. En quoi la définition
suivante est-elle plus valide que la précé-
dente ? Cela n’est jamais explicité.
La description objective n’est peut-être
pas d’ailleurs l’élément fondamental per-
mettant d’appréhender un phénomène
dans le champ des sciences humaines.
Prenons un exemple linguistique (4) : le
locuteur français est persuadé que les
deux unités phoniques minimales, “r” et
“l”, sont distinctes en soi, dans leur
essence immuable, par leur substance
phonique même, et cela pour toutes les
langues. Il ne paraît pas possible de
confondre un son produit par une vibra-
tion de deux à cinq battements de la poin-
te de la langue contre les dents d’en haut,
le “r”, avec un son si totalement différent,
produit par l’écoulement latéral de l’air à
droite et à gauche de la pointe de la
langue touchant les dents d’en haut, le
“l”. Or, les Français ne distinguent ces
deux productions que parce qu’elles ont
des fonctions distinctives : elles permet-
tent de distinguer pale de pare, mille de
mire, bulle de bure, père de pelle, bar de
bal…
En sango, et dans de nombreuses langues
africaines, ces deux sons “objective-
ment” (physiquement) si différents ne
sont pas utilisés pour opposer des paires
de mots qui seraient autrement sem-
blables. Ils n’ont donc pas cette valeur
d’opposition distinctive dans la commu-
nication : “r” ne commute pas avec “l”
pour créer des unités significatives diffé-
rentes.
mise au point
Mise au point
ACTUALITÉ PSY JUIN 05/08/02 10:34 Page 197

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) n° 6, juin 2000 198
mise au point
Le locuteur sango utilisera indifférem-
ment, pour désigner un œuf, deux signi-
fiants que l’auditeur français entendra
tantôt comme pala tantôt comme para. En
sango “l” et “r” ne sont pas deux unités
phonologiques distinctes, mais deux
variantes libres d’une seule et même unité.
C’est une idée fondamentale que les unités
linguistiques sont définies par leur fonction
de communication dans l’énoncé avant de
l’être par leur forme ou par leur substance.
N’en va-t-il pas de même des troubles men-
taux ?
L’idéologie
Le DSM est le reflet – d’autant plus perni-
cieux qu’il est insidieux – de l’idéologie
nord-américaine.
La définition des pathologies nous permet
de voir en négatif – ou en positif selon le
point de vue d’où on se place – l’idée sous-
jacente de ce qu’est le sujet normal, qu’il
s’agisse d’un adulte ou d’un enfant.
Pour ne donner que quelques éléments,
l’Américain adulte type :
– s’adapte parfaitement (fait face) aux
stress ;
– joue de l’argent mais sans excès ;
– ne se montre pas avare avec l’argent pour
lui-même ou pour les autres ;
– jette sans regret les objets usés et sans uti-
lité ;
– est sûr de lui ;
– peut avoir une aversion extrême pour la
sexualité ou ne pas avoir d’érection – sans
en souffrir…
C’est un homme pragmatique, souriant,
efficace, que rien ne peut atteindre.
On peut se demander, par ailleurs, la raison
d’un certain nombre de précisions chiffrées
quant à la fréquence de survenue de cer-
tains symptômes. Aucune information
dans le manuel ne permet de savoir com-
ment sont établies ces notes seuil.
En fait, il s’agit de répondre aux demandes
des assureurs privés qui n’acceptent de
rembourser des soins que si les pathologies
sont bien précisées. C’est implicite. Ce qui
est explicite, c’est la présentation de cette
classification comme scientifique, établie
par des comités d’experts. L’aspect écono-
mique n’est pas clairement énoncé, ce qui
constitue une véritable escroquerie morale.
Cette classification est envahie par le “poli-
tiquement correct”. L’homosexualité a été
retirée des catégories diagnostiques à la
suite d’un vote. Imagine-t-on pareille aven-
ture survenir au cancer de l’estomac ?
Le vocabulaire s’édulcore : les perversions
sont devenues des paraphilies. Les vic-
times des pédophiles seront sans doute
intéressées de savoir que les auteurs de ces
actes souffrent de paraphilie, c’est-à-dire
qu’ils “aiment à côté” – ou, que, mieux
encore, ils présentent un trouble de la pré-
férence sexuelle (CIM-10).
Conclusions
Faut-il se passer des classifications ?
Oui et non. Oui, car elles ne sont pas abso-
lument indispensables pour les prises en
charge non médicamenteuses. Non, car il
est difficile en pratique d’agir sans faire
référence à des catégories précises, même
si celles-ci ne sont que temporaires.
Mais il faut savoir clairement dans quel
but on les utilise et ce qui est sous-tendu
par elles. Quand on range un trouble dans
une catégorie, il faut savoir précisément
ce que celle-ci recouvre, quel impact cela
a sur nous, quelle modélisation cela fait
naître en nous et quelles conséquences
nous allons en tirer.
Quelle classification choisir ?
Peu importe : il n’existe pas de classifica-
tion parfaite, fondamentalement meilleu-
re qu’une autre. Il ne faut pas être néo-
pathe, se mettre systématiquement à la
mode des États-Unis (symbole consen-
suel de progrès).
L’essentiel est de toujours s’assurer, quand
on utilise un concept, que notre interlocu-
teur en a bien la même définition, et sur-
tout la même représentation.
Conseils aux jeunes générations
Il serait présomptueux de ma part de
m’ériger en sage. Aussi, je laisserai la
parole, d’une part, à l’homme de science,
et, d’autre part, au poète.
Henri Poincaré (5) nous rappelle qu’il ne
suffit pas de penser se comporter en scien-
tifique pour l’être vraiment. Il écrivait :
“Combien de gens croient de bonne foi
faire de la science impartiale, alors qu’ils
interrogent les faits comme les présidents
d’assises d’autrefois interrogeaient les
témoins ! Ils n’avaient de cesse que quand
ils avaient obtenu ce qu’ils voulaient
qu’ils disent. Et c’était cela que nos
magistrats appelaient la justice, comme
c’est cela que nos gens appellent de la
science.”
Quant à Georges Brassens (6), il nous met
en garde contre la tentation d’atteindre à
une vérité immuable. Il chantait :
“La vérité d’ailleurs flotte au gré des
saisons.
Tout fier dans son sillage, on part, on a
raison.
Mais au cours du voyage, elle a viré de
bord,
Elle a changé de cap, on arrive : on a
tort.”
Références
1. Freud S. Introduction à la psychanalyse,
Paris : Payot.
2. Hempel C. Éléments d’épistémologie. Paris :
Armand Colin/Masson, 1996.
3. Havet JM, Pascalis JG. Peut-on construire une
clinique sans référence théorique ? Annales
médico-psychologiques, volume 146, n°5.
4. Mounin G. Clefs pour la linguistique. Paris :
Seghers, 1971.
5. Poincaré H. In : “Morale de savant”, sous la
direction de Jean Pelseneer. Bruxelles, 1946.
6. Brassens G. Le Vieux Normand.
Mise au point
ACTUALITÉ PSY JUIN 05/08/02 10:34 Page 198
1
/
4
100%