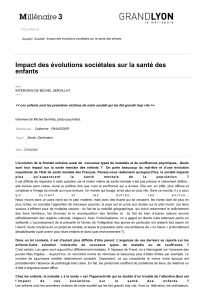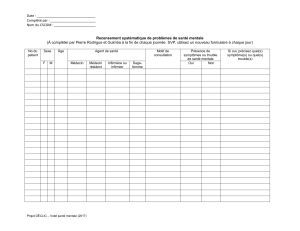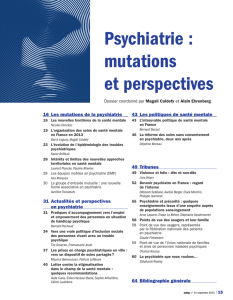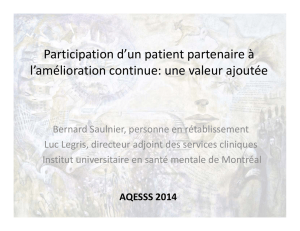Comment se disent les maladies mentales

!
!
!
1
Comment se disent les maladies mentales ?
Armelle GRENOUILLOUX1
Comment la médecine psychiatrique peut-elle se situer au travers du discours de
l’époque où la santé mentale semble englober la maladie mentale ?
Nous allons préciser dans un premier temps les contenus de cette notion extensive de
santé mentale à trois niveaux : sur le terrain de la psychiatrie (et nous parlerons
essentiellement de la psychiatrie publique), dans les textes officiels puis en vis-à-vis de
l’évolution de l’identité psychiatrique. Dans un second temps nous nous demanderons
comment un discours sur l’être-malade pourrait répondre aux interrogations que ces notions et
évolutions soulèvent et quels seraient les liens d’un tel discours avec le savoir-faire.
1. Le discours sur la santé mentale
1.1 La santé mentale sur le terrain de la psychiatrie
Tandis que la pression sécuritaire imprimée politiquement sur la psychiatrie ne cesse
de croître comme la loi sur la rétention de sureté l’a montré [6] et l’actuelle révision sur
l’hospitalisation sans consentement le questionne, aujourd’hui, paradoxalement, la
banalisation de la notion de santé mentale a pour corrélat la démultiplication des demandes de
prises en charge psychiatriques pour souffrance psychique au quotidien.
Ces demandes envers la psychiatrie publique émanent tout d’abord des services
sociaux qui depuis les années 90 notent un accroissement de la souffrance psychique ou peut-
être une expression de plus en plus psychologique du malaise social chez les demandeurs. De
là, comment faire en sorte, interroge dès 1995 le Rapport du groupe de travail « ville, santé
mentale, précarité et exclusion sociale » [16] que la souffrance des publics n’entraine pas, en
miroir, la souffrance des professionnels du champ social ? Laquelle souffrance les fait se
tourner encore plus vers la psychiatrie.
Les médecins généralistes orientent également des patients en souffrance psychique
vers des soins psychiatriques dès lors que les traitements prescrits ne font pas disparaître la
symptomatologie. Ainsi, la surconsommation française d’antidépresseurs malgré l’inefficacité
connue de ceux-ci à traiter autre chose que les dépressions sévères [1 ; 2] correspond-t-elle
sans doute à leur fréquente prescription dans ces cas de souffrance psychique.
La dépressivité (et non la dépression), les addictions, la suicidalité seraient aussi voire
d’abord des faits de société liées à des situations éprouvantes et des difficultés existentielles.
Dans son dernier livre, La Société du malaise, Alain Ehrenberg souligne que la place sociale
de l’affect a changé. La valorisation du développement intensif de l’initiative personnelle
présuppose « (…) l’autonomie en tant qu’il est question de soi-même ce qui implique une
mobilisation des dispositions individuelles, des ses affects, de sa propre subjectivité » [7]. Or
l’autonomie est et demeure problématique pour nombre d’individus. Ces personnes
empruntent donc, via les acteurs sociaux ou les médecins généralistes mais aussi d’elles-
mêmes, la voix de la souffrance psychique (autour de thèmes familiaux, conjugaux,
professionnels, éducatifs, …) pour accéder à un soutien et une reconnaissance de leur
humanité avec sa faiblesse mais aussi parfois d’un statut, le cas échéant via une indemnité. De
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Psychiatre hospitalier (chef de service Secteur 49G08 Cholet) et libéral (Nantes).
!

!
!
!
2
vécus psychiques douloureux liés à la précarité socio-professionnelle, l’on arrive à
l’expression commune d’un sentiment de précarité de l’existence, adressée aux acteurs
sociaux et sanitaires de première ligne dont le psychiatre, hospitalier particulièrement,
détiendrait la solution.
Mais, outre ces demandes des usagers et du réseau, la psychiatrie hospitalière reçoit
aussi des demandes croissantes des institutions et des associations : des établissements
médico-sociaux aux maisons de retraite en passant par les associations d’aide aux migrants ou
à d’autres minorités, partout où les personnels sont en difficulté pour accompagner une
personne exprimant une souffrance psychique. Or ces personnels, ou ces bénévoles, sans
formation psychologique, sans recul psychique ni émotionnel, exercent aussi avec la crainte
que leur responsabilité soit engagée face à des complications de santé pour la personne,
crainte qui va venir justifier à leurs yeux le recours à la psychiatrie.
Enfin, le spectre du coût de l’hôpital régnant, les services de psychiatrie sont très
sollicités comme voie finale commune pour tous les patients accueillis en service de soins
généraux et inaptes au retour à domicile… ce qui est éthiquement inacceptable mais
financièrement presque incontournable.
A côté de ce bref aperçu de l’évolution des demandes adressées à la psychiatrie pour
de nombreux motifs de souffrance psychique, quelle place pour la santé mentale dans les
textes officiels ?
1.2 La santé mentale dans les textes officiels
Rappelons que pour les psychiatres, aux débuts de l’organisation de la psychiatrie
publique en Secteurs il y a plus de quarante ans, la santé mentale et les dispensaires d’hygiène
mentale visaient au premier chef l’insertion des malades sortis de l’hôpital psychiatrique et
leur maintien dans la cité. La psychiatrie s’est donc initialement appropriée la notion de santé
mentale dans la mouvance de la « psychiatrie citoyenne » [12].
Voyons ce qu’il en est dans quelques textes français récents. Avec le Plan Santé
Mentale 2005-2008 [18], dont la révision est annoncée pour l’automne 2011, il est certes fait
état de perturbation de la santé mentale sous forme de souffrance psychique mais la réflexion
reste centrée sur le soin aux malades mentaux dans et hors les institutions. Le rapport Couty
au Ministre de la Santé de janvier 2009 « Missions et organisation de la santé mentale et de la
psychiatrie », quant à lui, valide l’évolution des concepts et souligne la nécessité de « Penser
la santé mentale comme une politique de santé publique s’appuyant sur trois aspects
indissociables : sanitaire, social et médico-social » [4]. Citons encore, le rapport intitulé « La
santé mentale, l’affaire de tous » [5], remis le 17 novembre 2009 par un groupe d’experts du
Centre d’Analyse Stratégique présidé par Viviane Kovess-Masféty à la Secrétaire d’Etat
chargée de la Prospective et du Développement Numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce
rapport, en s’inspirant de l’expérience québécoise, développe spécifiquement les enjeux de
l’évolution de cette notion désormais européenne depuis deux Résolutions du Parlement
Européen en 2008 et 2009 (au sujet de la Santé Mentale puis de la Santé Mentale et du Bien-
être [19, 20]) où il est question cette fois des populations vulnérables tels les âges extrêmes de
la vie, les chômeurs, les migrants, etc. Le rapport reprend la tripartition devenue usuelle
depuis le Plan Santé Mentale 2005-2008, et ce bien que discutable [10], qui attribue à la santé
mentale trois dimensions : les troubles mentaux, la détresse psychologique et la santé mentale
positive.
C’est donc la deuxième dimension de la santé mentale, celle de la détresse
psychologique, qui pose la question des limites de l’exercice psychiatrique ; à cet égard le
rapport indique que « Ce sont la mesure du degré d’intensité de la souffrance psychique, sa
permanence et sa durée, ainsi que ses conséquences, qui peuvent conduire à la nécessité d’une
prise en charge sanitaire. Si la souffrance est temporaire et fait suite à un événement stressant,

!
!
!
3
on la considère comme une réaction adaptative normale. En revanche, lorsqu’elle devient
intense et perdure, elle peut constituer l’indicateur d’un trouble psychique » [5].
Mais comment les psychiatres mesurent-ils le degré d’intensité de la souffrance
psychique, sa permanence et sa durée pour déterminer ce qui de la « détresse psychologique »
relève du sanitaire ? Plus largement, où en est la profession psychiatrique quant à la définition
de la part de la santé mentale qui relève de son champ de compétence ?
La question « qu’est-ce qu’être psychiatre ? » « que fait un psychiatre ? » est présente
dans la société depuis longtemps : soigner le psychisme, est-ce voir ce qui se passe dans la
tête des gens … ? La profession génère en écho les fantasmes que la folie suscite. Mais cette
question identitaire est aussi, de façon récurrente sans doute, celle de la profession elle-même
et ce pour de nombreuses raisons : l’évolution des psychotropes et de l’imagerie donc de la
place du cerveau, la polémique autour du statut de psychothérapeute, les injonctions
sécuritaires récurrentes, la pression économique au sein du système de santé, enfin l’évolution
de la notion de la santé mentale devenue question de santé publique et bien d’autres raisons
sans doute. C’est donc sur ce dernier point que nous allons nous arrêter un instant.
1.3 La santé mentale comme nouvel objet de savoir d’une discipline en pleine refondation
identitaire
De quelles références le psychiatre, disons européen, dispose-t-il pour penser sa place
face à ces nouveaux objets de savoir présumé ? Ses références demeurent multiples : le
psychiatre a à sa disposition des nosographies, des monographies, des paradigmes que nous
faisons que signaler ici [14] auxquels sont venues s’ajouter les classifications syndromiques
internationales dont nous ne faisons qu’évoquer les limites. Cependant, à l’époque de la
neuro-imagerie dynamique, de la stimulation magnétique transcrânienne, le clinicien est seul
face à l’évolution des demandes en santé mentale et, pour reprendre le mot de Guyotat, il fait
toujours du « bricolage » à partir de références multiples et de son expérience.
Mais le bricolage a aussi ses faiblesses et porte en creux, le défaut de savoir et son corrélat :
l’abus, subjectif, de pouvoir.
Nous soutenons la thèse selon laquelle, aujourd’hui, l’évolution nécessaire des
références et repères, notamment au vu de l’extension des demandes liées à la souffrance
psychique, la « refondation identitaire » [17] appelle une définition de l’être-malade comme
biologie et personne qui intègre la nature en même temps que le contextuel,
l’environnemental mais aussi le personnel [9]. Ce qui implique de fournir un cadre conceptuel
à ce « bricolage » originaire, plus même à l’enrichir en le structurant. Quels seraient donc les
pré-requis de l’élaboration d’un tel paradigme de l’être-malade ? Là où les termes de
nosographie et de nosologie sont en règle confondus [9 ; 10], nous proposons d’appeler
nosologique le discours sur l’être-malade, biologie et personne. Ce qui nous amène dans une
seconde partie à envisager quelques repères pour cette nosologie aujourd’hui en devenir et à
montrer comment elle bénéficierait d’un examen critique du savoir-faire.
2. Discours sur l’être-malade et savoir-faire
2.1 Nosologie
Si nous examinons le quotidien de la psychiatrie publique, tandis que le duel entre
psychanalyse et cognitivo-comportementalisme anime périodiquement les médias, émeut une
certaine intelligentsia et inquiète certains usagers, ce quotidien consiste à dépister et traiter la
maladie et les troubles handicapants psychiquement derrière les manifestations
comportementales plus ou moins désocialisantes et ce au milieu des demandes psycho-
sociales croissantes. Or, décider qu’un patient qui dit penser qu’il est le Christ réincarné est
plus irrationnel que celui qui dit croire qu’il fera beau dans deux jours ou accorder une sortie

!
!
!
4
de l’hôpital à un patient délirant relève d’autre chose que du pur recours aux théories ou
même aux classifications dites athéoriques. Cela ne fait pas plus appel au corpus
psychanalytique ni aux schèmes cognitivo-comportementaux. Au quotidien, entre théories et
pratiques, pour s’engager dans la contenance psychique et l’ajustement en temps réel des
soins au patient, le psychiatre mobilise des interactions avec l’être-malade singulier
auxquelles il accède par l’expérience et le savoir-faire. Les phénoménologues (Blankenburg
notamment) ont d’ailleurs montré que plus de la moitié des décisions en psychiatrie ne
procède pas de la démarche diagnostique inférentielle constitutive de la médecine mais d’une
intuition perceptive, stylistique ou typologique [10 ; 21].
En se demandant « que puis-je prétendre savoir objectivement de ce qui est
pathologique chez ce patient ? », le psychiatre s’interroge en effet sur les objets de
connaissance de la psychiatrie. Sa recherche épistémologique est donc régionale. Le
relativisme partiel qui fonde le questionnement épistémologique régional est cette posture qui
permet d’éviter à la fois le relativisme absolu (pour lequel tout se vaut, il n’y a aucune vérité)
et le dogmatisme. Pour le reformuler avec Lanteri-Laura, le relativisme partiel tient au fait
que la psychiatrie ne soit pas sans rapport avec les cultures - celle où elle est apparue et les
autres - mais que « par son effort constant vers une connaissance rigoureuse elle ne s’y réduit
pas » [15]. Mais, de plus, lorsque le psychiatre rencontre le malade et se demande : « en quoi
cette personne estime-t-elle être malade ? » autre forme de « qu’est-ce que ce patient me dit
de ce qu’est pour lui « aller bien » et qu’il espère recouvrer ? », il fait alors systématiquement
report au patient comme étant sa propre norme et lui indexe les critères de sortie du
pathologique. C’est donc bien que son savoir-faire inclut une réflexion éthique première. Et
c’est, entre autres, parce que la psychiatrie, ne produisant pas de théorie de l’homme, produit
des théories du psychisme aux références en partie subjectives et contradictoires que son
exercice exige au quotidien un questionnement épistémologique et éthique. Or ce double
questionnement c’est ce qui permet aussi de travailler au lit du malade, à un autre niveau, sur
l’écart entre la ou les théories de référence et la pratique.
2.2 Savoir-faire
En effet, entre savoir et faire, entre langage et action, entre discours et soins, entre
théorie et pratique, se trouve le savoir-faire. C’est le savoir-faire qui oriente et adapte l’action
face à l’être-malade et à l’être souffrant. Lanteri-Laura s’inspire de Bourdieu pour penser la
théorie de la pratique comme fondement du savoir-faire. Bourdieu montre en effet qu’y
compris face à des actions répétées et traditions, les agents ne peuvent fournir une explication
de leur pratique qu’« au prix d’un retour quasi théorique » sur celle-ci qui « dissimule, à leurs
yeux mêmes, la vérité de leur maîtrise pratique comme docte ignorance » [3]. Pour Lanteri-
Laura toutefois la « docte ignorance » en psychiatrie ne peut pas traduire la conviction des
praticiens que la pratique existe isolément, en toute indépendance de la théorie. Ce serait
masquer de façon « démagogique » « la place exacte du savoir » [13]. La « docte ignorance »
correspond en psychiatrie à l’impossibilité d’écrire une théorie de la pratique « de façon
positive ». La théorie de la pratique « n’a pas de vertu didactique propre et on ne saurait
l’enseigner à [la] place [des théories] ; elle ne constitue donc ni une sorte de niveau
élémentaire d’un savoir commun, ni quelque degré zéro de la théorisation » [13].
La théorie de la pratique est donc ce discours souvent implicite, fait de théorisations
partielles fondant le savoir-faire, qui correspond à l’aménagement clinique (au
« bricolage » ?) d’un espace de questionnement à la fois éthique et épistémologique du
praticien. Statut de « provocateur d’étonnement », statut d’ « opérateur de questionnement »,
étonnement et questionnement au sujet de l’altérité, du normal et du pathologique, la théorie
de la pratique fonctionne comme le questionnement philosophique.

!
!
!
5
La transmissibilité de la théorie de la pratique ne se questionne donc pas comme celle
d’un contenu ; la théorie de la pratique se transmet selon nous comme une attitude. Attitude
clinique dont la dimension éthique recentre les soins sur la norme du patient, attitude critique
sur les conditions de possibilité de la connaissance. Or attitude clinique et attitude critique
sont les deux bras, séculaires, de l’attitude phénoménologique [8]. Une telle attitude permet le
questionnement du savoir-faire et ce questionnement, sans cesse renouvelé, toujours inachevé,
sur la Vérité épistémologique et éthique, vient structurellement nourrir une théorie de la
pratique [11].
C’est ainsi que le développement de la réflexion sur la théorie de la pratique,
aujourd’hui limitée, menée « en flux » par les acteurs de terrain nous apparait être un pré-
requis de la nosologie manquante et, partant, de la refondation identitaire attendue. Ceci étant,
nous estimons qu’aujourd’hui, le questionnement sur la théorie de la pratique comme variable
d’ajustement épistémologique et éthique pourrait d’ores et déjà, face à l’extension de la
demande de soins pour souffrance psychique, aider le psychiatre à délimiter son rôle, son
champ de compétence, et de là, la nature, la durée des soins jusqu’à leur articulation avec
l’intervention de professionnels non médicaux.
!
Conclusion
Pour parler de la maladie mentale et de la souffrance psychique émanant de la
perturbation de la santé mentale, le psychiatre européen « bricole » entre épistémologie et
éthique.
Et en 2011, la psychiatrie française s’interroge plus que jamais : elle observe la
révision des Classifications Internationales (la Classification Internationale des Maladies va
produire sa XIème révision, tandis que le D.S.M. annonce la Vème). Elle constate aussi que,
là où aujourd’hui coexistent sur le même plan clinique trois notions aussi hétérogènes que
maladie, syndrome, trouble, le discours sur l’être-malade, discours que nous avons appelé
nosologique, reste insuffisant.
Un Congrès Français de Psychiatrie, congrès annuel, créé voici trois ans et qui connaît
un succès sans précédent dans l’histoire de la discipline, montre, lui aussi, que la refondation
identitaire est à l’ordre du jour et la nosologie en gestation.
Mais pour dire aujourd’hui comment le psychiatre pense ce qu’il fait, c’est pour
l’heure de nouveau vers Lanteri-Laura que nous nous tournons. En effet, « sauf à professer un
dogmatisme dont peu possèdent à la fois le courage, l’aveuglement et l’impérantisme, le
champ théorique et pratique de notre discipline continue à paraître divers, polymorphe,
multicentrique, répondant un peu à l’introduction de quelque dictionnaire qui s’annoncerait
ainsi : a comme ambidextre ; b comme bicéphale ; c comme caméléon,… » [15].
Références bibliographiques :
[1] BENKIMOUN P., MAMOU Y. : « Une étude remet en question l’efficacité des
antidépresseurs » in Le Monde, 28 février 2008 ; p.8.
[2] BADER J.M., PETITNICOLAS C. : « L’efficacité du Prozac sérieusement contestée » in
Le Figaro, 27 février 2008 ; p.12.
[3] BOURDIEU P. : Esquisse d’une théorie de la pratique. Paris : Points Essais 2000.
[4] COUTY E. : Missions et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie ; Rapport au
Ministre de la santé et des sports ; La Documentation Française ; Janvier 2009.
[5] C.A.S. Dir. V.Kovess-Masféty. La santé mentale, l’affaire de tous ; pour une approche
cohérente de la qualité de vie ; Rapport à la Secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du
Développement numérique ; novembre 2009 ; www.strategie.gouv.fr
 6
6
1
/
6
100%