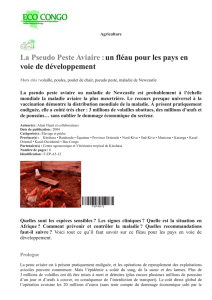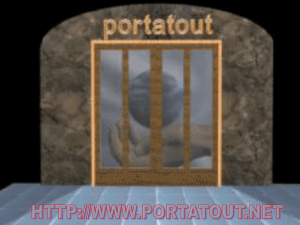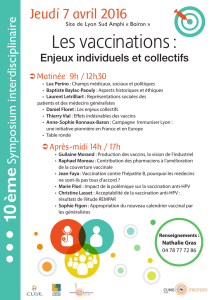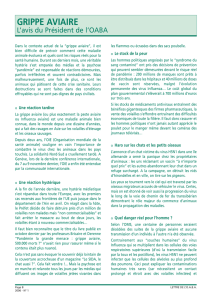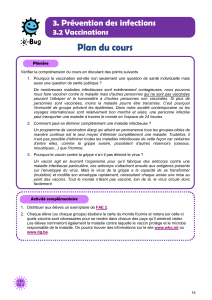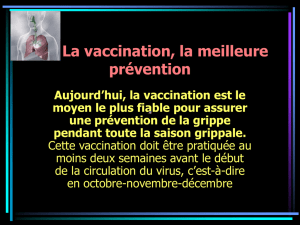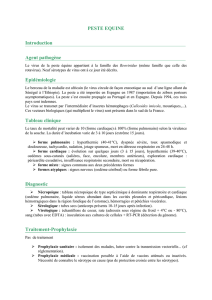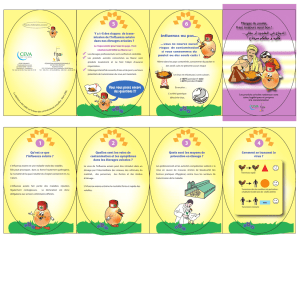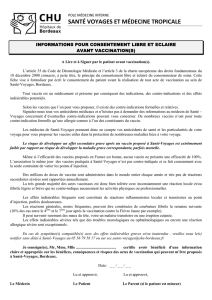La Pseudo Peste Aviaire : un fléau pour les pays en voie de

Ecocongo • 1
Agriculture
La Pseudo Peste Aviaire : un éau pour les pays
en voie de développement
Mots clés :volaille, poules, poulet de chair, pseudo peste, maladie de Newcastle
Quelles sont les espèces sensibles ? Les signes cliniques ? Quelle est la situation en Afrique ? Comment prévenir et contrô-
ler la maladie ? Quelles recommandations faut-il suivre ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce éau pour les pays en voie de
développement.
La pseudo peste aviaire ou maladie de Newcastle est probablement à l’échelle mondiale la maladie aviaire la
plus meurtrière. Le recours presque universel à la vaccination démontre la distribution mondiale de la maladie.
À présent pratiquement endiguée, elle a coûté très cher : 3 millions de volailles abattues, des millions d’œufs
et de poussins… sans oublier le dommage économique du secteur.
Auteur(s) : Alain Huart et collaborateurs
Date de publication : 2004
Catégorie(s) : Élevage et pêche
Province(s) : Kinshasa • Bandundu • Équateur • Province Orientale • Nord-Kivu • Sud-Kivu •
Maniema • Katanga • Kasaï-Oriental • Kasaï-Occidental • Bas-Congo
Partenaire(s) : Centre agronomique et Vétérinaire tropical de Kinshasa
Nombre de pages : 6
Identication : F-EP-A5-12
Prologue
La peste aviaire est à présent pratiquement
endiguée, et les opérations de repeuplement
des exploitations avicoles peuvent com-
mencer. Mais l’épidémie a coûté du sang,
de la sueur et des larmes. Plus de 3 mil-
lions de volailles ont dû être mises à mort
et détruites (plus encore plusieurs millions
de poussins d’un jour et d’œufs à couver, en
conséquence de l’interdiction de transport).
Le coût direct global de l’opération avoisine
les 20 millions d’euros (sans tenir compte du
dommage économique subi par le secteur).
Extrait du bulletin de l’Agence Fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire
AFSCA -Juillet 2003.
Introduction & terminologie
La pseudo peste aviaire ou maladie de
Newcastle est probablement à l’échelle
mondiale, la maladie aviaire la plus meur-
trière. Les premières épizooties ont été
formellement reconnues et reportées en
1926 à Java, Indonésie (Kraneveld 1926) et
à Newcastle-upon-Tyne, en Grande Bretagne
(Doyle 1927). Doyle nomma la maladie
« Maladie de Newcastle » suivant la localisa-
tion géographique des premières épizooties
en Grande Bretagne.
Avec le développement de la virologie et
des nouvelles techniques de propagation et
d’identication des virus, il devint évident
que plusieurs autres pathologies virales
étaient causées par des virus très proches du
virus de la maladie de Newcastle notamment
pneumœncéphalite (Beach 1944) (Hitchner
& Johnson, 1947) (Asplin, 1952).
Une épizootie : apparition brusque d’une
maladie transmissible au sein d’une popu-
lation animale donnée dans une zone géo-
graphique bien délimitée. Elle peut sévir sur
une courte durée ou s’échelonner sur plu-
sieurs années.
Une panzootie : enzooties (épidémies) très
étendues dans le temps et dans l’espace.
Distribution
Le recours presque universel à la vaccination
dans les élevages industriels démontre à suf-
sance la distribution mondiale de la mala-
die sous les formes enzootique et épizoo-
tique, à l’exception de l’Océanie qui semble
être exempte de la Pseudo peste aviaire.
Alexander D. J. (1988) considère que le
monde a connu trois « panzooties » depuis
la première identication de la maladie : la
première en Asie (Doyle 1935), la seconde
panzootie est partie du Moyen Orient vers n
1960 ; il est bon de noter le développement
fulgurant que con naît l’aviculture entre ces
deux panzooties ; dans beaucoup de pays,
la basse cour familiale et les petits établis-
sements de villages se transforment en une
aviculture de rapport ou mieux en agro-
industries caractérisées par d’importants
échanges internationaux.
Le virus responsable de cette seconde pan-
zootie apparaît comme lié aux mouvements
commerciaux des psittacidés, le transport
aérien ayant joué un rôle déterminant dans
la dissémination. Il est actuellement établi
qu’une maladie très proche de la forme neu-
rotropique des volailles mais non accompa-
gnée de signes respiratoires a sévi au Moyen
Orient vers la n des années 1970 (Kaleta
et al., 1985). Vers 1981, elle a atteint
l’Europe (Bianciori & Fiorini 1981) et s’est
répandue rapidement dans tous les conti-

2 • Ecocongo
Agriculture
nents comme une conséquence des contacts
entre volailles de compétition lors des foires
et divers concours.
En 1984, la Grande Bretagne connut 20 épi-
zooties dans des lots de volailles non vac-
cinés ayant consommé des aliments conta-
minés par des pigeons infectés. (Alexander
et al., 1985). Au niveau de la sous région
de l’Afrique australe et particulièrement
la RSA, une variante sauvage de la pseudo
peste aviaire (souche vélogénique) a frappé
en 1993 causant des pertes chiffrées à 80 %
du cheptel de poulets de chair. Les fermes
commerciales de ponte connurent jusqu’à
40 % de chute de ponte. Un nouveau passage
moins dévastateur fut signalé en 1998 mais
la souche vélogénique sauvage n’est tou-
jours pas sous contrôle et peut frapper à tout
moment. (Anon).
La conséquence directe d’une telle catas-
trophe c’est aussi l’impossibilité d’ expor-
ter les produits avicoles allant des œufs de
table, œufs fécondés, poussins d’un jour,
poulets de chair jusqu’ à la viande d’au-
truche qui jusque là constituait presque une
exclusivité sous régionale RSA, Botswana,
Zimbabwe…
Plus près de nous, au Nigeria, en Afrique de
l’Ouest, les espèces exotiques et autoch-
tones de volailles sont élevées dans les
milieux urbains et ruraux. On compte envi-
ron 30 millions de volailles exotiques (impor-
tées) et on estime à 120 millions l’effectif
des poules villageoises dont 85,5 % dans le
Nord et 14,5 % dans le Sud du pays.
La Pseudo peste aviaire constitue l’une des
principales causes de mortalités de volaille
sous les formes vélogeniques pour les souches
locales et mésogéniques pour les souches
exotiques. (Adu 1987, Nawathe et al., 1981,
Onunkwo & Momoh 1981).
Entre 1981 et 1989, 11 à 82 épisodes de la
pseudo peste aviaire furent reportés dans
différents États par l’Institut National de
Recherche Vétérinaire, avec une mortalité
estimée à 75 % du cheptel concerné.
Au Soudan, le premier passage d’une épizoo-
tie de PPA date de 1951 (Anon 1951). Depuis
les services vétérinaires signalent dans tous
leurs rapports l’existence de la PPA sous une
forme enzootique dans toutes les provinces.
Le virus a été isolé et identié lors de l’épi-
zootie de 1962 dans la Province de Khartoum
(Karrar & Mustapha 1964) ; la série noire va
se poursuivre avec plusieurs épisodes cau-
sant une mortalité de 81 % (Elobeid 1964,
Kassala 1969, Barakat et Kuku 1973).
En Ouganda, les premiers cas de PPA remon-
tent à 1955, au centre du pays. Il est inté-
ressant de noter que du point de vue épi-
démiologique, les cas de PPA sont identiés
à Mombassa en 1935, Nairobi Kenya 1939,
Soudan 1951, Nigéria 1952. Il est donc pro-
bable que le virus ait atteint l’Afrique proba-
blement par les ports maritimes de Mombassa
(pour l’Afrique de l’Est) et par les grands
ports de la Côte Ouest pour se répandre par
la suite dans les régions du Centre.
En RDC, la maladie de Newcastle est connue
depuis les années 1940, les rapports des ser-
vices vétérinaires de l’ancienne province
du Katanga font état des pertes énormes
causées par cette maladie depuis 1950,
(Dr Eyanga E. 1990).
Étiologie
Les membres de la famille des « PARAMYXO-
VIRIDAE » sont des virus ou micro-orga-
nismes constitués essentiellement d’un
acide nucléique (l’acide ribonucléique : ARN)
entouré d’une capside ou coque protéique
et sont des parasites intracellulaires obliga-
toires.
La famille comprend plusieurs genres.
Les « morbillivirus » (peste bovine), les
« pneumovirus » (rhinotrachéite de la dinde
et le syndrome de la grosse tête des poules)
et les « paramyxovirus » (Newcastle, para
inuenza aviaire agent de la grippe du
poulet). De ce dernier genre, on distingue
9 groupes sérologiques classés de type 1 à
type 9 en abrégé PMV1 à PMV 9 (Alexander
1986). De ces sérotypes, le NDV (PMV1)
demeure l’agent pathogène le plus impor-
tant en aviculture.
Espèces sensibles
Une étude de Kaleta et Baldauf (1988)
a établi qu’en plus des espèces aviaires
domestiques (poules, canards,oies,dindes et
pigeons) l’ infection soit naturelle ou expéri-
mentale a déjà été démontrée sur au moins
236 espèces appartenant à 27 ordres du total
des 50 ordres d’oiseaux connus. Malgré le
polymorphisme qui caractérise la symptoma-
tologie de la PPA, ces auteurs ont tenté de
classier les espèces selon l’ ordre de sensi-
bilité suivant :
Très sensibles, les Phasianidae (poule
domestique), Psittacidae (perroquets)
Sthruthioniformes (autruchés) et les colum-
bidae (pigeons et colombes).
Sensibilité moyenne, Spheniscidae (pin-
gouins), Falconidae (faucons), Acciptridae
(aigles), Passeridae (passereaux et oiseaux
chanteurs).
Faible sensibilité, Anatidae (palmipèdes
aquatiques).
Il est intéressant de noter que les espèces
aquatiques sont les moins sensibles tandis
que les plus sensibles se recrutent parmi les
oiseaux à comportement grégaire formant
des troupeaux temporaires, saisonniers ou
permanents.
Classication
La seule classication des souches de virus
de la pseudo peste aviaire faite à ce jour
repose sur le groupage des isolats de même
niveau pathogénique ou encore selon la
contagiosité (virus à évolution enzootique
ou épizootique). C’est ainsi que par conve-
nance, les chercheurs ont groupé les souches
de PPA en type : vélogénique, mésogénique
et lentogénique, selon le temps nécessaire
pour tuer des embryons de poules après une
inoculation allantoïdienne, soit respective-
ment, moins de 60 heures (vélo), 60 à 90
heures (méso) et plus de 90 heures (lento).
Les valeurs obtenues donnent une précieuse
indication sur le niveau de virulence de la
maladie induite (soit une haute, moyenne et
faible virulence).
Pathogénie
La pathogenèse est en général détermi-
née par la souche virale aussi bien que par
la sensibilité de l’hôte. La race, la dose, la
voie d’infection, l’âge et les conditions du
milieu peuvent fortement inuencer le cours
de la maladie. Ainsi, les palmipèdes (oies et
canards) manifestent peu ou pas de signes
cliniques même pour des souches mortelles
pour les poules.
En général, les poussins présenteront une
réaction aiguë et éventuellement une mort

Ecocongo • 3
Agriculture
subite sans signe clinique en présence d’une
souche sauvage pendant que les oiseaux plus
âgés présenteront toutes les nuances du
tableau symptomatique de la pseudo peste
aviaire. Par contre, la race et la souche
génétique des oiseaux n’ont pas d’effet du
point de vue de la pathogénie.
Les voies naturelles d’infection (intra-
nasale, orale et oculaire) semblent exa-
cerber la nature respiratoire de la maladie
(Beard & Easterday 1967), pendant que la
voie parentérale (IM, IV, intracérébrale) tend
à développer les signes nerveux (Beard &
Hanson 1984).
Le polymorphisme clinique, comme nous
venons de le voir, est un caractère impor-
tant : l’affection présente différents aspects
d’un oiseau à l’autre, d’un élevage à l’autre,
d’une épizootie à l’autre. Les lésions sont
également polymorphes. C’est ainsi que la
maladie a connu plusieurs dénominations
(Pseudo-peste aviaire, pseudovogel-pest,
Atypische Geugelpest, Peste aviaire, avian
distemper, Ranikhet disease…).
Signes cliniques, morbidité,
mortalité
Dans une tentative de simplication et de
division de matières selon les différentes
formes pathogéniques et sur la base des
signes cliniques observés sur les poules,
Beard & Hanson (1984) en sont arrivé au
regroupement ou classication des formes
suivantes :
La forme de Doyle (Doyle 1927) : Infection
létale, aiguë qui atteint tous les âges, carac-
térisée par des lésions hémorragiques du
tractus intestinal d’où la dénomination « PPA
vélogénique et viscérotropique ou VVND ».
La forme de Beach (Beach 1942) : Infection
aiguë, souvent mortelle pour les poussins de
tous âges, caractérisée par des signes respi-
ratoires et neurologiques « PPA vélogénique
et neurotropique ou NVND ».
La forme de Baudette (Baudette & Black
1946) : Infection moins pathogénique, mor-
talité uniquement chez les jeunes poussins ;
les virus causant cette forme peuvent être
utilisés comme « vaccins vivants secon-
daires ».
La forme de Hitchner (Hitchner & Johnson
1948) : Cette forme est caractérisée par une
infection respiratoire frustre et inapparente.
Les virus de ce groupe sont généralement
utilisés comme « vaccins vivants ». C’est une
forme entérique asymptomatique localisée
essentiellement dans le tube digestif.
En dehors de cette classication, il faut rap-
peler que la sévérité de l’infection peut être
fortement inuencée par l’espèce hôte, le
bilan immunitaire de l’hôte, l’exacerbation
par des germes opportunistes, le stress envi-
ronnemental, la voie d’infection. La magni-
tude et la durée de la dose infectante
inuenceront fortement la vitesse d’incu-
bation, l’apparition des premiers signes cli-
niques, la morbidité et la mortalité.
Pour les souches extrêmement virulentes,
la maladie apparaîtra soudainement avec
une forte mortalité sans signes cliniques.
Pour le pathotype vélogénique et viscéro-
tropique, les signes cliniques commencent
par la torpeur, abattement, respiration hale-
tante, faiblesse, prostration et mort.
Au cours de la panzootie causée par ce type
de virus en 1970-1973, la maladie a évolué
sous sa forme respiratoire sévère dans cer-
tains pays (Grande Bretagne et Irlande du
Nord) tandis que ces signes étaient absents
dans d’autres pays (McFerran & McCracken
1988).
Ce type viral peut causer aussi l’œdème
facial, une diarrhée verdâtre pour les oiseaux
ayant échappé à la mort précoce, et peu
avant la mort, on observe un tremblement
musculaire, le torticolis, la paralysie des
pattes et des ailes, l’opisthotonos accom-
pagnés d’une mortalité qui peut atteindre
100 % du troupeau sensible.
La forme vélogénique et neurotropique a été
rapportée très souvent aux États-Unis, dans
des lots de poussins frappés soudainement
par un accès respiratoire sévère suivi un ou
deux jours après par des signes nerveux.
On peut observer une chute dramatique
de la ponte mais la diarrhée est souvent
absente. La morbidité peut atteindre 100 %,
mais la mortalité est faible quoique pouvant
atteindre 50 % chez les poules adultes et
100 % chez les poussins.
La forme « mésogénique » de la pseudo peste
aviaire, qui comprend les vaccins viraux
Roakin, Mukteswar, Komarov et H provoque
généralement une maladie respiratoire en
présence d’ une souche sauvage. Chez les
adultes, on observe une importante chute de
ponte qui peut durer plusieurs semaines et
la qualité des œufs est médiocre. Les signes
nerveux peuvent apparaître, mais pas sou-
vent. Cependant chez les jeunes oiseaux
complètement sensibles, on peut observer
des signes respiratoires sévères.
Quelle est la situation
de la P.P.A. en Afrique ?
En général, dans beaucoup de pays en déve-
loppement et en particulier dans les pays
africains, de la zone tropicale et australe,
du Sénégal, Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud
en passant par l’Afrique Centrale et l’Afrique
de l’Est (RDC, Kenya, Ouganda, Éthiopie…),
la typologie des élevages avicoles est pra-
tiquement semblable. Malgré le niveau dif-
férent de développement des lières avi-
coles en Afrique du Sud, Égypte, Nigeria,
Zimbabwe, Kenya, on retrouve de façon
constante la classication suivante :
L’élevage traditionnel villageois
Les volailles sont élevées en liberté et ne
font l’objet d’aucun soin particulier ni sur le
plan zootechnique (alimentation, utilisation
des souches améliorées), ni sur le plan des
intrants vétérinaires (vaccins, médicaments,
etc.). La maladie de Newcastle se dispute la
vedette avec la pathologie parasitaire.
L’élevage artisanal (ou élevage tradition-
nel amélioré)
Dans cette catégorie, on retrouve des éle-
veurs qui apportent des améliorations
techniques (recours aux races et souches
améliorées) ; l’apport de compléments ali-
mentaires, amélioration de l’habitat (éle-
vage en enclos) ; amélioration sanitaire (vac-
cinations et traitements antiparasitaires,
antibiotiques et vitamines), la situation sani-
taire générale est mauvaise sinon pire. En
effet, aux parasitoses internes et externes
s’ajoutent de multiples affections liées aux
carences nutritionnelles du fait de l’utilisa-
tion de souches à croissance rapide et donc
beaucoup plus exigeantes que les races
locales. (J. Domenech, B.Sanogo, E. Couacy,
1989) (E. Eyanga 1990).
Sur le plan de la pathologie infectieuse, les
vaccinations (PPA, Gumboro, variole..) ne
sont pas toujours correctement réalisées.
Les erreurs techniques les plus fréquentes
sont la mauvaise conservation des vaccins,
la mauvaise utilisation, le stress des animaux
au moment de la vaccination. La consé-

4 • Ecocongo
Agriculture
quence logique de cette situation, c’est la
protection vaccinale limitée et la concentra-
tion d’animaux en état de faible résistance
qui explique le fait que certaines maladies
sévissent avec une acuité extrême.
L’élevage industriel
L’élevage industriel est caractérisé par
l’intensication et la concentration des
ressources : élevage de bandes de plusieurs
milliers de poulets ou de poules pondeuses
dans des bâtiments fortement mécanisés
et à environnement contrôlé (ventilation,
climatisation). L’élevage industriel recourt
aux souches génétiquement performantes,
à une alimentation adaptée et une conduite
d’élevage et une prophylaxie contraignante.
La situation sanitaire et le statut immuni-
taire des oiseaux sont naturellement diffé-
rents des précédentes formes d’élevage.
Dans les élevages traditionnels, en l’absence
de toute mesure de prophylaxie, la maladie
de Newcastle constitue un véritable éau.
L’extension de la maladie à de nombreuses
régions, voire à la totalité des pays en
période d’épizootie et les forts taux de mor-
talité enregistrés (80 à 100 %) dans les formes
aiguës et suraiguës, les retards de croissance
et les mauvais indices de consommation chez
les poules pondeuses font d’elle la princi-
pale cause des pertes économiques de cette
lière de la production animale.
Comme dans les autres zones géographiques,
le diagnostic des formes aiguë et suraiguë se
fait sur base des données épizootologiques
et sur base des formes caractéristiques de la
maladie : haute contagiosité, atteintes des
gallinacés de tout âge, les symptômes de
type septicémiques avec troubles nerveux,
respiratoires et digestifs ; l’évolution rapide
dans le temps et l’espace, la mortalité éle-
vée et la conrmation par les lésions décou-
vertes à l’autopsie.
Résumé de l’épidémiologie de la Pseudo Peste Aviaire
La maladie sévit sous forme épizootique en
saison sèche (décembre-avril) en zone sahé-
lienne où probablement, les facteurs clima-
tiques (air sec et poussiéreux, température
de nuit basse : c’est l’harmattan) favorise-
raient la dissémination du virus qui est du
reste bien résistant dans le milieu extérieur.
En RDC, et dans la zone intertropicale en
général, la maladie sévit pendant la petite
saison sèche (janvier-février) et pendant la
grande saison sèche juin-août, pour l’hémis-
phère sud et décembre-février dans l’hémis-
phère Nord.
Prévention et contrôle
Les mesures de prévention de la PPA doivent
être appliquées à différents niveaux :
Au niveau international : Le caractère in-
ternational et multinational de l’industrie
avicole montre qu’il y a un besoin d’échange
non seulement des produits de consomma-
tion mais aussi de matériel génétique avec
des contraintes prophylactiques liées à ce
type d’échange. La prévention au niveau in-
ternational sera donc basée sur l’obligation

Ecocongo • 5
Agriculture
de déclarer à l’O.I.E. (Ofce International des Epizooties) des maladies épizootiques aussitôt
qu’elles sont identiées.
Au niveau national : L’organisation de la prophylaxie sera orientée vers la prévention de
l’ introduction d’agents pathogènes et une réglementation limitant la propagation à l’inté-
rieur du pays sous forme de mesures restrictives d’importation de produits avicoles (œufs de
consommation, œufs fécondés et volailles vivantes). Ces mesures varient selon le niveau ou
l’état sanitaire du pays exportateur et du pays importateur notamment la mise en quarantaine
des oiseaux exotiques élevés en cages.
Au niveau régional : Quelques pays ont adopté des mesures d’estampillage et d’éradication
avec abattage obligatoire des volailles atteintes ainsi que la destruction des produits contami-
nés. De telles mesures comprennent généralement la restriction de circulation et commerce
de volaille à l’intérieur d’un espace délimité autour de la source de l’épizootie. Certains pays
ordonnent une vaccination préventive même en absence de maladie, pendant que d’autres
recourent plutôt à une « vaccination circonscrite » en vue d’établir une zone tampon autour
de l’épicentre de l’épizootie.
Cas de l’Union Européenne : Une politique de non-vaccination est applicable aux zoonoses
telles que la èvre aphteuse, la peste porcine et la peste aviaire ; en effet, l’isolation du
virus par les assainissements est pratiquement la seule manière d’empêcher la propagation
de l’épidémie, à l’exception des espèces rares des parcs zoologiques, pour lesquelles une
vaccination ciblée est autorisée en cas de nécessité avérée.
De plus en plus fréquemment se pose la question de savoir si cette politique d’assainissement
– la mise à mort et la destruction de grands nombre d’animaux est acceptable sur le plan
social et éthique (en raison notamment des énormes pertes économiques et de la souffrance
humaine qu’elle entraîne), et si la politique de non vaccination ne devrait pas être revue dans
le sens de la possibilité d’ effectuer une vaccination ciblée d’espèces rares et la vaccination
des poules des particuliers, vivant à proximité des foyers d’inuenza aviaire ou enn une vac-
cination générale ou ciblée dans les exploitations avicoles professionnelles.
Higgins et Shortridge (1988) insistent beaucoup sur la nécessité de mise en place des légis-
lations nationales « sur mesure » et attirent l’attention sur l’application de mesures dogma-
tiques et universelles qui ne tiendraient pas compte du contexte social, économique et clima-
tique de différents pays.
Prévention et contrôle à l’échelle
de la ferme
L’infection et la propagation du virus de
la PPA au niveau de la ferme dépendent
étroitement des conditions d’élevage et du
niveau de biosécurité en application dans la
ferme. (voir aussi l’article sur la biosécurité :
échelles conceptuelle, structurelle et opéra-
tionnelle).
On n’insistera pas assez sur le fait que les
mouvements du personnel, visiteurs et ser-
vices extérieurs : équipe de prélèvement
et vaccination, inséminateurs, vétérinaires
sont inévitables, mais doivent être consi-
dérés comme la méthode ou la voie la plus
probable de dissémination des enzooties et
épizooties et que les mesures fondamentales
de désinfection du matériel, changement
de tenues, douches entre les visites de lots
devraient faire l’objet d’une large diffusion
et application.
Autocontrôle, traçabilité et notication
obligatoire
Dans les fermes atteintes par la PPA, le per-
sonnel et les propriétaires devraient être
conscients de leur responsabilité vis-à-vis
de toute l’industrie avicole et s’assurer qu’
ils ont pris sufsamment de précautions et
mesures pour contenir le risque de dissé-
mination au niveau le plus bas. En effet,
l’implication des opérateurs dans le contrôle
des animaux et des produits dont ils ont en
charge la gestion et la responsabilité de
sécurité est primordiale. Même dans les ré-
gions où les mesures d’abattage ne sont pas
appliquées, la dépopulation doit être sérieu-
sement considérée.
La plupart des pays ayant une réglementa-
tion de marquage (estampillage) font géné-
ralement appliquer des réglementations sur
l’élimination des poules mortes, les produits
contaminés, les œufs, la ente soit par
enfouissement soit encore par incinération.
Après, les installations doivent être soigneu-
sement nettoyées, désinfectées et si possible
laissées sous vide sanitaire pendant plusieurs
semaines avant toute nouvelle repopulation.
Normalement la vaccination contre la mala-
die de Newcastle assure une stimulation
d’une réponse immunitaire qui empêche
l’infection ou la réplication du virus. Mais
en réalité, la vaccination ne protège les
volailles que contre les plus graves lésions
(conséquences) provoquées par le virus, tan-
 6
6
1
/
6
100%