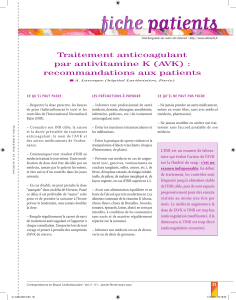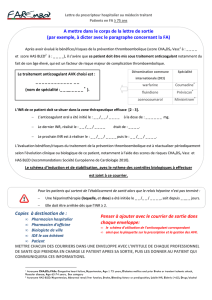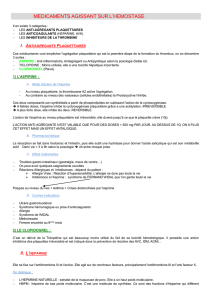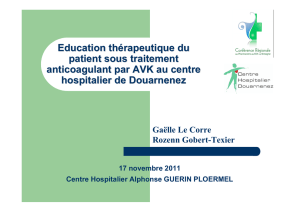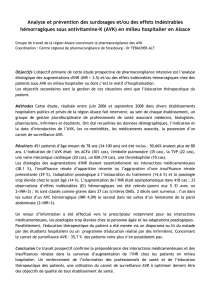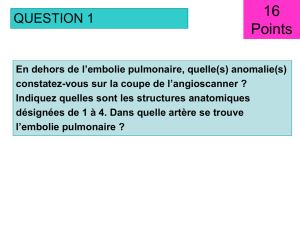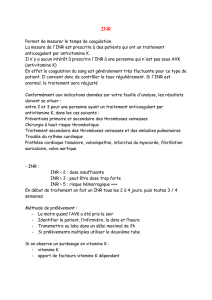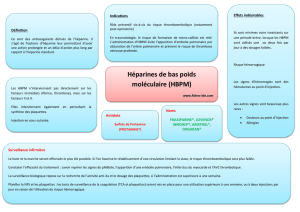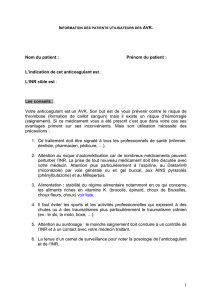Relais périop AVK MP.Guillaumont

Dr MP Guillaumont et Groupe de travail réuni le 12 Mars 2004
D
D
Dr
r
r
M
M
MP
P
P
G
G
GU
U
UI
I
IL
L
LL
L
LA
A
AU
U
UM
M
MO
O
ON
N
NT
T
T
D
D
Dé
é
ép
p
pa
a
ar
r
rt
t
te
e
em
m
me
e
en
n
nt
t
t
d
d
d’
’’A
A
An
n
ne
e
es
s
st
t
th
h
hé
é
és
s
si
i
ie
e
e
R
R
Ré
é
éa
a
an
n
ni
i
im
m
ma
a
at
t
ti
i
io
o
on
n
n
C
C
Ch
h
hi
i
ir
r
ru
u
ur
r
rg
g
gi
i
ic
c
ca
a
al
l
le
e
e
A
A
A
H
H
Hô
ô
ôp
p
pi
i
it
t
ta
a
al
l
l
N
N
No
o
or
r
rd
d
d
C
C
CH
H
HU
U
U
A
A
AM
M
MI
I
IE
E
EN
N
NS
S
S
G
G
GE
E
ES
S
ST
T
TI
I
IO
O
ON
N
N
P
P
PE
E
ER
R
RI
I
IO
O
OP
P
PE
E
ER
R
RA
A
AT
T
TO
O
OI
I
IR
R
RE
E
E
D
D
DE
E
ES
S
S
P
P
PA
A
AT
T
TI
I
IE
E
EN
N
NT
T
TS
S
S
R
R
RE
E
EC
C
CE
E
EV
V
VA
A
AN
N
NT
T
T
D
D
DE
E
ES
S
S
A
A
AN
N
NT
T
TI
I
IC
C
CO
O
OA
A
AG
G
GU
U
UL
L
LA
A
AN
N
NT
T
TS
S
S
A
A
AU
U
U
L
L
LO
O
ON
N
NG
G
G
C
C
CO
O
OU
U
UR
R
RS
S
S
C
C
Ce
e
es
s
s
r
r
re
e
ec
c
co
o
om
m
mm
m
ma
a
an
n
nd
d
da
a
at
t
ti
iio
o
on
n
ns
s
s
n
n
ne
e
e
r
r
re
e
ep
p
pr
r
ré
é
és
s
se
e
en
n
nt
t
te
e
en
n
nt
t
t
q
q
qu
u
u’
’’u
u
un
n
ne
e
e
a
a
ai
iid
d
de
e
e
à
à
à
l
lla
a
a
d
d
dé
é
éc
c
ci
iis
s
si
iio
o
on
n
n
d
d
du
u
u
m
m
mé
é
éd
d
de
e
ec
c
ci
iin
n
n
e
e
et
t
t
n
n
n’
’’o
o
on
n
nt
t
t
p
p
pa
a
as
s
s
d
d
de
e
e
c
c
ca
a
ar
r
ra
a
ac
c
ct
t
tè
è
èr
r
re
e
e
n
n
no
o
or
r
rm
m
ma
a
at
t
ti
iif
f
f,
,
,
l
lle
e
e
m
m
mé
é
éd
d
de
e
ec
c
ci
iin
n
n
c
c
co
o
on
n
ns
s
se
e
er
r
rv
v
va
a
an
n
nt
t
t
s
s
so
o
on
n
n
l
lli
iib
b
br
r
re
e
e
a
a
ar
r
rb
b
bi
iit
t
tr
r
re
e
e.
.
.
E
E
El
lll
lle
e
es
s
s
d
d
do
o
oi
iiv
v
ve
e
en
n
nt
t
t
ê
ê
êt
t
tr
r
re
e
e
p
p
pé
é
ér
r
ri
iio
o
od
d
di
iiq
q
qu
u
ue
e
em
m
me
e
en
n
nt
t
t
r
r
ré
é
éa
a
ac
c
ct
t
tu
u
ua
a
al
lli
iis
s
sé
é
ée
e
es
s
s
à
à
à
l
lla
a
a
l
llu
u
um
m
mi
iiè
è
èr
r
re
e
e
d
d
de
e
es
s
s
n
n
no
o
ou
u
uv
v
ve
e
el
lll
lle
e
es
s
s
d
d
do
o
on
n
nn
n
né
é
ée
e
es
s
s
p
p
pu
u
ub
b
bl
lli
iié
é
ée
e
es
s
s.
.
.
I
I
Im
m
mp
p
po
o
or
r
rt
t
ta
a
an
n
nt
t
t
:
:
:
D
D
Da
a
an
n
ns
s
s
l
lle
e
e
c
c
ca
a
ad
d
dr
r
re
e
e
d
d
de
e
e
l
lla
a
a
m
m
mi
iis
s
se
e
e
e
e
en
n
n
p
p
pl
lla
a
ac
c
ce
e
e
d
d
de
e
e
c
c
ce
e
es
s
s
r
r
re
e
ec
c
co
o
om
m
mm
m
ma
a
an
n
nd
d
da
a
at
t
ti
iio
o
on
n
ns
s
s,
,
,
i
iil
ll
e
e
es
s
st
t
t
r
r
ra
a
ap
p
pp
p
pe
e
el
llé
é
é
l
ll’
’’o
o
ob
b
bl
lli
iig
g
ga
a
at
t
ti
iio
o
on
n
n
d
d
de
e
e
d
d
dé
é
éc
c
cl
lla
a
ar
r
re
e
er
r
r
t
t
to
o
ou
u
ut
t
t
e
e
ef
f
ff
f
fe
e
et
t
t
i
iin
n
nd
d
dé
é
és
s
si
iir
r
ra
a
ab
b
bl
lle
e
e
g
g
gr
r
ra
a
av
v
ve
e
e
(
(
(a
a
ac
c
cc
c
ci
iid
d
de
e
en
n
nt
t
t
h
h
hé
é
ém
m
mo
o
or
r
rr
r
ra
a
ag
g
gi
iiq
q
qu
u
ue
e
e
o
o
ou
u
u
d
d
dé
é
éf
f
fa
a
au
u
ut
t
t
d
d
de
e
e
p
p
pr
r
ré
é
év
v
ve
e
en
n
nt
t
ti
iio
o
on
n
n
d
d
de
e
e
l
lla
a
a
t
t
th
h
hr
r
ro
o
om
m
mb
b
bo
o
os
s
se
e
e)
)
)
p
p
pa
a
ar
r
r
u
u
un
n
ne
e
e
n
n
no
o
ot
t
ti
iif
f
fi
iic
c
ca
a
at
t
ti
iio
o
on
n
n
d
d
de
e
e
p
p
ph
h
ha
a
ar
r
rm
m
ma
a
ac
c
co
o
ov
v
vi
iig
g
gi
iil
lla
a
an
n
nc
c
ce
e
e.
.
.

Dr MP Guillaumont et Groupe de travail réuni le 12 Mars 2004
G
G
Gr
r
ro
o
ou
u
up
p
pe
e
e
d
d
de
e
e
t
t
tr
r
ra
a
av
v
va
a
ai
i
il
l
l
d
d
du
u
u
1
1
12
2
2
M
M
Ma
a
ar
r
rs
s
s
2
2
20
0
00
0
04
4
4
Présents
:
:
:
Mr le Professeur M. ANDREJAK PHARMACOLOGIE CLINIQUE
Mme le Docteur P. BESSERVE ANESTHESIE C- CHIRURGIE CARDIAQUE
Mr le Docteur H. DUVAL CHIRURGIE GENERALE VISCERALE ET DIGESTIVE
Mme le Docteur M.P. GUILLAUMONT CARDIOLOGIE
Mr Emmanuel LORNE INTERNE - ANESTHESIE
Mr le Professeur P. MERTL ORTHOPEDIE
Mme le Docteur M. MOUBARAK ANESTHESIE C - UROLOGIE
Mr M.PANNIER PHARMACIE
Mr le Docteur M. RADJI ANESTHESIE B - ORTHOPEDIE
Mr B.ROUSSEL LABORATOIRE HEMATOLOGIE
Mr le Docteur B.TRIBOUT EXPLORATION des MALADIES VASCULAIRES
Mr le Docteur F.TROJETTE CARDIOLOGIE - CHIRURGIE CARDIAQUE
Absents : Excusés, nous ayant transmis leurs remarques
Mr le Professeur S.BELOUCIF ANESTHESIE C
Mme le Docteur G.JARRY CARDIOLOGIE
Mr le Docteur E. NGUYEN KHAC HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Absents Excusés
Mr le Professeur H.DUPONT REANIMATION POLYVALENTE
Mr le Docteur D.MONTPELLIER ANESTHESIE A
Mr le Professeur M.SLAMA THERAPEUTIQUE - NEPHROLOGIE
Mr le Docteur J. TCHAOUSSOFF ANESTHESIE A NEUROCHIRURGIE

Dr MP Guillaumont et Groupe de travail réuni le 12 Mars 2004
INTRODUCTION
PRINCIPES DE PRECAUTION
1 / Il est fondamental de savoir pour quelle raison le patient est anticoagulé et de tenir compte de la
cinétique propre de chaque Héparine et chaque AVK et des interactions médicamenteuses (antibiothérapie
post-opératoire par exemple),
2 / En moyenne et, si au départ, il est bien en zone thérapeutique, l'INR est à 1.5 après 4 jours d'arrêt
des AVK à demi-vie longue : Préviscan ou Coumadine (48 h pour ceux à demi vie courte : Sintrom)
3 / Environ 3 jours après leur reprise à dose habituelle chez un patient bien équilibré, l'INR est à 2.
On tiendra donc compte des éléments suivants :
• on considère qu’en moyenne, sans relais, la période minimum de carence en anticoagulants est de
quatre jours.
• Il est inutile et dangereux de prescrire une Héparine tant que l’INR est > à 2
4 / Le risque de thrombose veineuse est considérablement plus important en postopératoire qu'en
préopératoire. Penser à utiliser la contention veineuse +/- compression pneumatique, surtout chez les
patients à haut risque et chez qui, on ne peut utiliser les anticoagulants à doses efficaces.
5 / En ce qui concerne le risque d'embolie artérielle, l’augmentation post-opératoire du risque n'est pas
prouvé.
6 / En matière de prothèses valvulaires, le plus haut risque de thrombose est pour :
• les prothèses mitrales
• les prothèses à bille ou à disque basculant (Starr, Bjork)
• si, il y a en plus, une fibrillation auriculaire ou une dysfonction ventriculaire gauche
• dans un contexte de néoplasie, quelque soit la prothèse
7 / Tous les patients ne relèvent pas d’un relais étroit.
• Une anticoagulation efficace postopératoire de 48 h par Héparine majore le risque de saignements
majeurs de 3%. Chaque équipe chirurgicale devra établir la procédure post-opératoire en fonction du
geste opératoire et de la technique anesthésique.
• Tous les gestes n’ont pas les mêmes conséquences hémorragiques,
• Tous les gestes n’augmentent pas le risque de phlébite en post procédure.
8 / L’utilisation de la vitamine K est aisée, n’entraîne pas de rebond d’hypercoagulation, et permet de
normaliser l’INR en 12 à 24 h. Mais l’utilisation d’une dose inutilement élevée va entraîner une résistance
prolongée aux AVK et compliquer considérablement le relais post-opératoire.
Donc : Vitamine K 1 mg maximum, soit en IV, soit en gouttes par voie sublinguale

Dr MP Guillaumont et Groupe de travail réuni le 12 Mars 2004
MODE D’EMPLOI
A / TABLEAU 1 : Ce tableau permet de déterminer, dans la majorité des cas, s’il s’agit d’un patient à
risque thrombo-embolique : élevé, intermédiaire ou faible. En cas de doute, naturellement un avis
spécialisé sera pris auprès du prescripteur des AVK au long cours.
L’opérateur aura pris connaissance :
• du niveau de risque thrombo-embolique individuel du patient : bénéfice attendu du relais anticoagulant
• et l’aura mise en balance avec le risque hémorragique individuel du geste prévu et ses conséquences
• Il pourra alors choisir un compromis : relais minimaliste (B1) ou étroit (B2) ou intermédiaire(B3)
B / TABLEAU 2 : 3 protocoles pratiques : B1, B2, B3
Il permet de suivre les « rails », une fois la décision prise par l’opérateur.
• Le type de relais pré et post opératoire
• L’heure de reprise de l’héparine
• Le jour de reprise des AVK = J AVK
C / CAS PARTICULIER : LES SOINS DENTAIRES
D / PEUT ON SUBSTITUER UNE HBPM A DOSE CURATIVE A L’HEPARINE NON FRACTIONNEE ?
AVEC QUELLES MODALITES ET PRECAUTIONS
E / BIBLIOGRAPHIE

Dr MP Guillaumont et Groupe de travail réuni le 12 Mars 2004
A / TABLEAU 1
I
I
I
/
/
/
E
E
EV
V
VA
A
AL
L
LU
U
UA
A
AT
T
TI
I
IO
O
ON
N
N
D
D
DU
U
U
N
N
NI
I
IV
V
VE
E
EA
A
AU
U
U
D
D
DE
E
E
R
R
RI
I
IS
S
SQ
Q
QU
U
UE
E
E
T
T
TH
H
HR
R
RO
O
OM
M
MB
B
BO
O
OE
E
EM
M
MB
B
BO
O
OL
L
LI
I
IQ
Q
QU
U
UE
E
E
A
A
AR
R
RT
T
TE
E
ER
R
RI
I
IE
E
EL
L
L
E
E
ET
T
T
V
V
VE
E
EI
I
IN
N
NE
E
EU
U
UX
X
X
D
D
DU
U
U
P
P
PA
A
AT
T
TI
I
IE
E
EN
N
NT
T
T
äToujours vérifier l’indication précise de la prise d’AVK au long cours.
PATHOLOGIE JUSTIFIANT
LES AVK PARTICULARITE NIVEAU DE RISQUE
EMBOLIQUE
- DE MOINS D'UN MOIS**
Risque élevé
A CHAQUE FOIS QUE
POSSIBLE, ON DOIT
DIFFERER LE GESTE**
- de 2 à 3 mois Risque élevé
- alitement préopératoire
- facteurs aggravants (Cancer,
thrombophilie, paralysie) risque intermédiaire
Maladie veineuse thrombo-
embolique
Sus-poplitée*
de plus de 3 mois
- patients ambulatoires
- chirurgie réglée Risque faible
FA non valvulaire, sans ATCD embolique depuis un an. Risque faible
Fibrillation Auriculaire
permanente FA avec :
- Rétrécissement mitral
- Cardiomyopathie dilatée Risque élevé
Avec rétrécissement mitral Risque élevé Actuellement en rythme
sinusal (Fibrillation
Auriculaire paroxystique) FA non valvulaire, sans ATCD embolique depuis un an Risque faible
Thrombus /
Embolie artérielle
- Thrombus de diagnostic récent
- Embolie artérielle, quelque soit la source, récente DE
MOINS D'UN MOIS
Risque élevé
A CHAQUE FOIS QUE
POSSIBLE, ON DOIT
DIFFERER LE GESTE
- Valve de Starr ou à disque basculant Aortique ou Mitrale
- Prothèse mécanique mitrale
- Double prothèse mécanique
- Prothèse mécanique Aortique ou Mitrale (même à
ailettes) + 1 Facteur de risque :
FA, CMD, Embolie récente, insuffisance cardiaque,
Contexte néoplasique
Risque élevé
Prothèses valvulaires
mécaniques
- Prothèse Aortique à ailettes, sans embolie récente
- Bioprothèse de moins de 3 mois risque intermédiaire
Prothèses vasculaires Risque faible
* : les thromboses sous poplitées doivent bénéficier d’un contrôle régulier doppler pour vérifier l’absence
d’extension mais ne justifient pas une prise de risque hémorragique
** : Si le geste opératoire est indispensable : indication d’interruption de la Veine Cave Inférieure à discuter au
cas par cas.
I
I
II
I
I
/
/
/
E
E
EV
V
VA
A
AL
L
LU
U
UA
A
AT
T
TI
I
IO
O
ON
N
N
D
D
DU
U
U
R
R
RI
I
IS
S
SQ
Q
QU
U
UE
E
E
H
H
HE
E
EM
M
MO
O
OR
R
RR
R
RA
A
AG
G
GI
I
IQ
Q
QU
U
UE
E
E
P
P
PO
O
OS
S
ST
T
T-
-
-O
O
OP
P
PE
E
ER
R
RA
A
AT
T
TO
O
OI
I
IR
R
RE
E
E
L
L
LA
A
A
C
C
CO
O
ON
N
NC
C
CE
E
ER
R
RT
T
TA
A
AT
T
TI
I
IO
O
ON
N
N
A
A
AV
V
VE
E
EC
C
C
L
L
LE
E
E
C
C
CH
H
HI
I
IR
R
RU
U
UR
R
RG
G
GI
I
IE
E
EN
N
N
E
E
ES
S
ST
T
T
F
F
FO
O
ON
N
ND
D
DA
A
AM
M
ME
E
EN
N
NT
T
TA
A
AL
L
LE
E
E
En post-opératoire, la priorité est donnée, EN GENERAL, au risque hémorragique avec ses conséquences vitales et
fonctionnelles, en tenant compte du terrain du patient, de l’indication des anticoagulants et du geste effectué.
Le protocole concernant le risque intermédiaire = peut donc se substituer, en post opératoire, à celui du risque
élevé, quand le taux d’hémorragies graves est trop important, ou que les conséquences d’une hémorragie seraient
gravissimes (exemple : neurochirurgie)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%