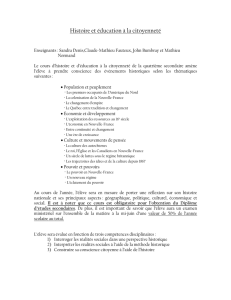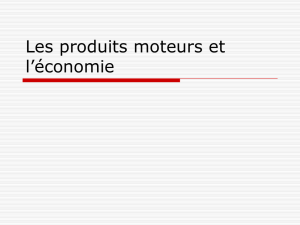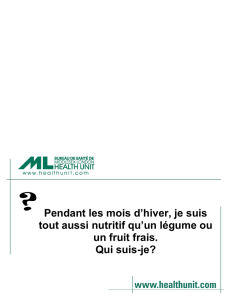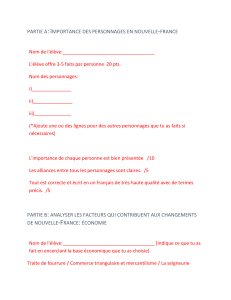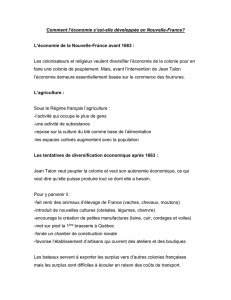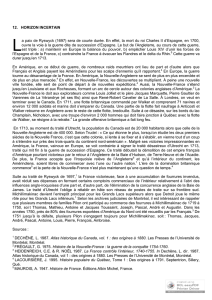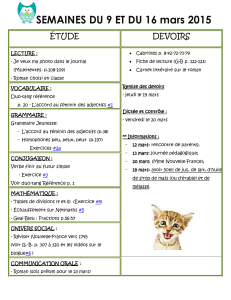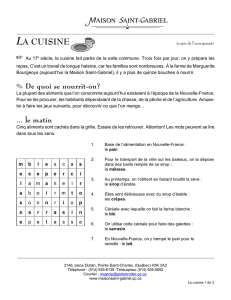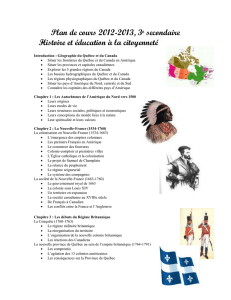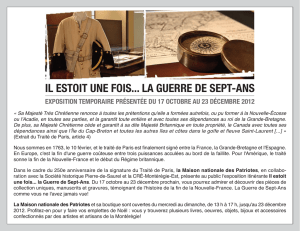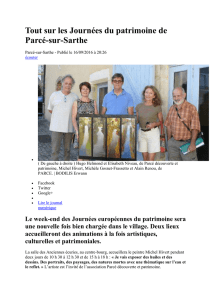Manoir Mauvide-Genest Quand cuisine rime avec médecine Les

Manoir Mauvide-Genest ©2010
1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0
Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com
1
Manoir Mauvide-Genest
Quand cuisine rime avec médecine
Les jardins en Nouvelle-France
Samuel de Champlain fut le premier à planter un potager en Nouvelle-France.
En 1608, il fit aménager des jardins près de son habitation de Québec. Dans ses
écrits, il nous informe que ceux-ci sont : « bien garnis d’herbes potagères de
toutes sortes, avec de forts beau bled d’inde, et du froment, seigle et orge, qu’on
avoit semé et des vignes que j’y avois fait planter durant mon yvernement »
1
Les colons qui s’établirent sur les rives du fleuve Saint-
Laurent organisèrent aussi des potagers près de leur maison
afin de pouvoir y produire tous les légumes nécessaires à
leur alimentation. Les communautés religieuses telles que
les Jésuites, les Ursulines et les Augustines entretenaient
également de grands jardins composés de potagers, de vergers et de jardins de
plantes médicinales. Elles embauchaient des
jardiniers expérimentés afin d’assurer une production
suffisante de fruits et légumes pour nourrir tous leurs
personnels, leurs malades ou leurs élèves.
Les membres de la bourgeoisie ou de la noblesse,
tel que Jean Mauvide, possédaient aussi des jardins. Jean Mauvide fut le
seigneur d’une partie de l’île d’Orléans a la fin du Régime français. Il se fit
construire un grand manoir dans la paroisse de St-Jean en 1733.
2
Près de sa
résidence, Jean Mauvide et sa femme Marie-Anne Genest devaient avoir fait
planter un grand potager, un verger et peut-être même un jardin de fleurs.
1
Œuvres, vol I, p. 156.

Manoir Mauvide-Genest ©2010
1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0
Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com
2
Les fruits et les légumes
On cultivait de nombreuses variétés de légumes et de fruits sous le Régime
français. Les légumes racines tels que les carottes, les radis, les panais, les
oignons, les navets, les betteraves et les topinambours sont les plus populaires
car ils se conservent durant tout l’hiver dans des caveaux à légumes. Les
légumineuses telles que les pois, les haricots et les gourganes occupent une
place de choix. Les habitants les font séchés et les utilisent pour faire des
soupes durant la saison froide. Par contre, les habitants ne sèment pas de
pommes de terre car ils n’apprécient par son goût. Ils plantent également des
légumes de courte conservation comme le concombre, la laitue, la chicorée dont
ils font des salades. La tomate et le piment sont cependant inconnus en
Nouvelle-France.
Dans les vergers, les colons récoltaient de nombreux fruits
dont les pommes, des prunes et des cerises Certaines
communautés religieuses entretenaient avec soin des
poiriers car ces derniers poussaient difficilement au Québec.
Parfois elles vendaient les surplus au marché lorsque les
récoltes étaient suffisamment abondantes.
Fruits communs et fruits exotiques
Les habitants des villes et des campagnes récoltaient les petits fruits de saisons
dans les sous-bois et les champs : fraises, framboises, mûres, bleuets,
amélanchiers, groseilles et atocas (canneberges). Beaucoup de fruits exotiques
étaient alors inconnus comme le kiwi, la banane et la mangue. Les abricots, les
raisins et les figues étaient importés de France sous la forme de fruits séchés.
D’autres fruits exotiques, plus dispendieux, étaient importés des Antilles par
bateau, par exemple les citrons, les oranges et les ananas. Cependant, seuls
les bourgeois et les nobles pouvaient se payer des fruits aussi rares.
3
3
AUDET, Bernard. Se nourrir au quotidien en Nouvelle-France. Québec, Les éditions GID, 2001, p. 94 à
127.

Manoir Mauvide-Genest ©2010
1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0
Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com
3
1. Complète le mot croisé suivant avec des noms de légumes:
4
2
1
2
5
1
6
3
4
3
5
6
Mots à l’horizontale :
1. Légume inconnu en Nouvelle-
France. Il est parfois vert, rouge ou
jaune.
2. Légume gros et rond dans la même
famille que la citrouille.
3. Légume racine que les habitants
n’appréciaient pas.
4. Légume racine blanc qui ressemble
à la carotte.
5. Petit légume racine rond, rouge et
blanc.
6. Fruit rouge que l’on considère aussi
comme un légume et qui n’était pas
connu en Nouvelle-France.
Mots à la verticale :
1. Légume long et vert.
2. Petit légume racine qui ressemble a
une patate et que les habitants
cultivaient en Nouvelle-France.
3. Légume racine qui fait pleurer
lorsqu’on le coupe.
4. Légume feuillu
vert avec
lequel on fait
des salades.
5. Légumineuse
en forme de
demi-lune.
6. Légume petit,
rond et vert.

Manoir Mauvide-Genest ©2010
1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0
Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com
4
2. Inscrit chaque fruit dans la bonne colonne selon qu’ils sont des fruits
sauvages des fruits cultivés, des fruits importés ou inconnus:
abricot, amélanchier, ananas, banane, atoca, bleuet, citron, figue, fraise,
framboise, groseille, kiwi, orange, mangue, mûre, poire, pomme, prune, raisin.
Fruits sauvages
Fruits cultivés
Fruits importés
Fruits inconnus
3. Complète les phrases suivantes :
a. En Nouvelle-France, on retrouvait surtout trois types de jardins : le
_______________ dans lequel on cultivait les légumes, le _______________
où l’on récoltait les fruits et le __________________________ qui était plus
rare.
b. ___________________________________ fut le premier à planter un jardin
en Nouvelle-France, dans la future ville de Québec.
c. Les __________________________________________ possédaient de
grands jardins comprenant un ________________, des _______________ et
un jardin de _________________________________________.

Manoir Mauvide-Genest ©2010
1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0
Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com
5
La médecine et la pharmacie en Nouvelle-France
Chirurgien, médecin ou apothicaire ?
Durant le régime français, les malades pouvaient se faire soigner dans
des hôpitaux tenus par des sœurs hospitalières comme les Augustines à
Québec ou les Sœurs Grises à Montréal. En ville, les personnes aisées
pouvaient se payer les services d’un médecin du roi.
Cependant il y avait très peu de médecins en Nouvelle-
France. Dans les régions, les habitants faisaient plutôt
appel à un chirurgien. Plus nombreux, les chirurgiens
exerçaient la médecine et parfois le métier d’apothicaire,
c’est-à-dire pharmacien.
Jean Mauvide était un chirurgien important qui a vécu entre 1701 et 1782.
Il s’occupa de soigner les habitants de Saint-Jean de l’île d’Orléans et des
villages avoisinants. Le plus souvent, il combattait les maladies à l’aide des
mêmes traitements utilisés en France à cette époque. Il pouvait aussi prescrire
différentes tisanes, des infusions, des poudres, des emplâtres (sorte de pâte que
l’on déposait sur le dos ou le ventre du malade), des onguents et des
gargarismes (liquide avec lequel on se rince la gorge).
Des remèdes à base de plantes…
Pour fabriquer ces remèdes, l’apothicaire ou le chirurgien
utilisaient surtout des plantes, parfois des produits à base d’animaux – comme
le castor - et rarement des produits chimiques, comme le mercure et le soufre.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%