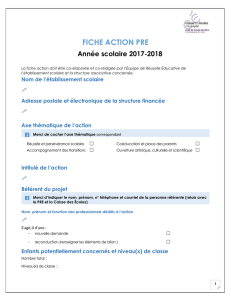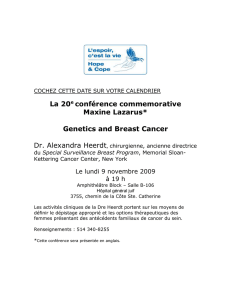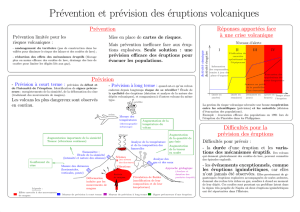Recommandations pour la pratique clinique : Nice, Saint

Recommandations pour la pratique clinique :
Nice, Saint-Paul de Vence 2009 «cancers du sein »
et «soins de support »
Partie II - Soins de support
1
Promoteur
Cours de Saint-Paul-de-Vence
Coordination logistique et scientifique
LOb Conseils
P. Ferran, L. Massa-Auvray, N. Mathivas, J. Tessaire
Comite´ d’organisation
J. Gligorov, I. Krakowski, E. Luporsi, M. Namer
Correspondance : joseph.gligorov@tnn.aphp.fr ; i.krakowski@nancy.fnclcc.fr
Membres du groupe de travail «Cancers du sein »
L. Aimard, radiothe´ rapie, centre Clairval, Marseille, France
F. Andre´ , oncologie me´ dicale, institut Gustave-Roussy,
Villejuif, France
M. Antoine, anatomie et cytologie pathologiques,
AP–HP, hoˆ pital Tenon, Paris, France
B. Barreau, radiologie, centre Futura, Anglet, France
C. Bourgier, radiothe´ rapie, institut Gustave-Roussy,
Villejuif, France
E. Brain, oncologie me´ dicale, centre Rene´ -Huguenin,
Saint-Cloud, France
RPC NICE SAINT PAUL DE VENCE 2009
1
La partie «Cancers du sein »de ces recommandations a fait l’objet d’une publication dans le volume 11 –Nume´ro 11 –
novembre 2009 de la revue Oncologie.
Oncologie (2009) 11: 612–793
©Springer 2009
DOI 10.1007/s10269-009-1823-9
ONCOLOGIE
612

L. Ceugnart, radiologie, centre Oscar-Lambret, Lille, France
K. Clough, oncologie chirurgicale, institut du sein, Paris,
France
J. Chiras, radiologie, AP–HP, la Pitie´ -Salpeˆtrie` re, Paris,
France
M. Cohen, oncologie chirurgicale, cabinet me´ dical,
Aubagne, France
B. Coudert, oncologie me´ dicale, centre Georges-
Franc¸ ois-Leclerc, Dijon, France
B. Cutuli, oncologie radiothe´ rapique, polyclinique de
Courlancy, Reims, France
T. Delozier, oncologie me´ dicale, centre Franc¸ois-
Baclesse, Caen, France
S. Delaloge, oncologie me´ dicale, institut Gustave-
Roussy, Villejuif, France
N. Dohollou, oncologie me´ dicale, polyclinique Nord,
Bordeaux, France
F. Ettore, anatomie et cytologie pathologiques, centre
Antoine-Lacassagne, Nice, France
T. Facchini, oncologie me´ dicale, polyclinique de Cour-
lancy, Reims, France
C. Falandry, oncologie me´ dicale, centre hospitalier
Lyon-Sud, Pierre-Be´ nite, France
G. Freyer, oncologie me´ dicale, centre hospitalier
Lyon-Sud, Pierre-Be´ nite, France
G. Ganem, oncologie radiothe´ rapique, centre Jean-
Bernard, Le Mans, France
S. Giard, oncologie chirurgicale, centre Oscar-Lambret,
Lille, France
J.-P. Guastalla, oncologie me´ dicale, centre Le´on-Be´rard,
Lyon, France
J.-M. Guinebretiere, anatomie et cytologie pathologi-
ques, centre Rene´ -Huguenin, Saint-Cloud, France
G. Houvenaeghel, chirurgie, institut Paoli-Calmette,
Marseille, France
M. Hery, oncologie radiothe´rapique, centre hospitalier
Princesse-Graˆ ce, Monaco, France
J. Jacquemier, anatomie et cytologie pathologiques,
institut Paoli-Calmettes, Marseille, France
A. Lesur, oncologie gyne´ cologique, centre Alexis-
Vautrin, Vandœuvre-le` s-Nancy, France
P.-M. Martin, biologiste, faculte´deme´ decine, secteur
Nord, Marseille, France
L. Mauriac, oncologie me´ dicale, institut Bergonie´,
Bordeaux, France
F. Lokiec, pharmacologie, centre Rene´ -Huguenin, Saint-
Cloud, France
S. Me´ nard, oncologie expe´ rimentale et laboratoire,
Institut national du cancer, Milan, Italie
I. Morel-Soldner, ge´ rontologie, centre hospitalier
Lyon-Sud, Pierre-Be´ nite, France
L. Ollivier, radiodiagnostic, institut Curie, Paris,
France
T. Petit, oncologie me´ dicale, centre Paul-Strauss, Stras-
bourg, France
P. Pujol, oncoge´ne´tique, hoˆ pital Arnaud-de-Villeneuve,
Montpellier, France
H. Roche´ , oncologie me´ dicale, institut Claudius-Regaud,
Toulouse, France
G. Romieu, oncologie me
´ dicale, centre Val-d’Aurelle-
Paul-Lamarque, Montpellier, France
P. Rouanet, chirurgie, centre Val-d’Aurelle-Paul-
Lamarque, Montpellier, France
R. Salmon, oncologie chirurgicale, institut Curie, Paris,
France
J.-P. Spano, oncologie me´ dicale, AP–HP, la Pitie´-
Salpeˆ trie` re, Paris, France
M. Spielmann, oncologie me´ dicale, institut Gustave-
Roussy, Villejuif, France
A. Tardivon, radiologie, institut Curie, Paris, France
R. Villet, chirurgie, groupe hospitalier Diaconesses-
Croix-Saint-Simon, Paris, France
L. Zelek, oncologie me´ dicale, AP–HP, Henri-Mondor,
Cre´teil, France
Membres du groupe de travail «Soins de support »
M. Ackermann, pharmacologie Morges, Suisse
D. Ammar, me´ decine de la douleur, Marseille, France
E.-C. Antoine, oncologie me´ dicale, clinique Hartmann,
Neuilly-sur-Seine, France
T. Bachelot, oncologie me´dicale, centre Le´on-Be´rard,
Lyon (SFRO), France
P. Bachmann, nutrition, centre Le´on-Be´ rard, Lyon, France
C. Bagnis, ne´ phrologie, AP–HP, la Pitie´ -Salpeˆ trie` re,
Paris, France
F. Barruel, psychologie, CHI Le Raincy, Montfermeil,
France
K. Belhadj, he´ matologie, AP–HP Henry-Mondor, Cre´teil,
France
T. Bouillet, oncologie me´ dicale, Paris, France
C. Bouleuc, oncologie me´ dicale, institut Curie, Paris,
France
P.-A. Brioschi, gyne´ cologie–obste´ trique, Genolier,
Suisse
F. Brocard, oncologie me´ dicale, centre Alexis-Vautrin,
Nancy, France
L. Chaigneau, oncologie me´ dicale, CHU Jean-Minjoz,
Besanc¸ on, France
L. Chassignol, me´decinedeladouleur,centrehospita-
lier de Saintonge, Saintes, France
F. Chauvin, oncologie me´ dicale et sante´ publique,
institut de cance´ rologie, Saint-Priest-en-Jarez, France
CONSEIL SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC BOARD
613

G. Chvetzoff, oncologie me´ dicale, centre Le´on-Be´rard,
Lyon, France
C. Ciais, soins palliatifs, centre Antoine-Lacassagne,
Nice, France
M.-F. Cosset, Anesthe´ sie–re´ animation, institut Gustave-
Roussy, Villejuif, France
S. Dauchy, psychiatrie, institut Gustave-Roussy,
Villejuif, France
F. Debiais, rhumatologie, CHU de la Mile´ trie, Poitiers,
France
T. Delorme, me´ decine de la douleur, institut Curie, Paris,
France
M. Di Palma, oncologie me´ dicale, institut Gustave-
Roussy, Villejuif, France
M. Dicato, oncologie me´ dicale, centre hospitalier de
Luxembourg, Luxembourg
S. Dolbeault, psychiatrie, institut Curie, Paris, France
J.-P. Durand, oncologie me´ dicale, AP–HP Cochin, Paris,
France
J. Duret, kine´ sithe´ rapie, Avignon, France
P. Escure, oncologie me´ dicale, AP–HP Avicenne,
Bobigny, France
N. Jovenin, oncologie me´ dicale, centre Jean-Godinot,
Reims, France
L. Juhel, oncologie me´ dicale, clinique Victor-Hugo,
Le Mans, France
D. Kamioner, oncologie me´dicale, hoˆ pital prive´Ouest-
Parisien, Trappes, France
I. Kriegel, anesthe´ sie–re´ animation, AP–HP Lariboisie`re,
Paris, France
F. Laroche, rhumatologie, AP–HP, Saint-Antoine, Paris,
France
P. Latino-Martel, Nutrition, Jouy-en-Josas, France
D. Mayeur, oncologie me´dicale, hoˆ pital Andre´-Mignot,
Le Chesnay, France
V. Launay-Vacher, ne´ phrologie, AP–HP, La Pitie´-
Salpeˆ trie` re, Paris, France
A.-S. Le Bihan, psychiatrie clinique, AP–HP, Saint-
Antoine, Paris, France
J.-L. Machavoine, psycho-oncologie, centre Franc¸ois-
Baclesse, Caen, France
M. Magnet, oncologie me´ dicale, HAD, Lyon, France
S. Mimoun, gyne´ cologie-sexologie, Paris, France
S. Perrot, rhumatologie, AP–HP, Hoˆ tel-Dieu, Paris,
France
P. Poulain, soins palliatifs, polyclinique de l’Ormeau,
Tarbes, France
M. Reich, psychiatrie, centre Oscar-Lambret, Lille
P. Saltel, psychiatrie, centre Le´ on-Be´ rard, Lyon,
France
F. Scotte´ , oncologie me´ dicale, AP–HP, HEGP, Paris,
France
P. Se´ nesse, oncologie me´ dicale, centre Val-d’Aurelle–
Paul-Lamarque, Montpellier, France
S. Toussaint, soins palliatifs, centre Alexis-Vautrin,
Vandœuvre-le`s-Nancy, France
M. Tubiana, oncologie me´ dicale, centre Rene´ -Huguenin,
Saint-Cloud, France
M.-P. Vasson, pharmacologie, faculte´ de pharmacie,
Clermont-Ferrand, France
C. Villanueva, oncologie me´ dicale, CHU Jean-Minjoz,
Besanc¸on, France
F. Tiberghien, me´decine de la douleur, CHU Jean-
Minjoz, Besanc¸ on, France
C. Tournigand, oncologie me´ dicale, AP–HP, Saint-
Antoine, Paris, France
R.-M. Javier, rhumatologie, CHU Hautepierre, Stras-
bourg, France
M. Marty, rhumatologie, AP–HP, Henri-Mondor, Cre´teil,
France
J. Otto, oncologie me´ dicale, centre Antoine-Lacassa-
gne, Nice, France
Membres du comite´ d’organisation
J. Gligorov, oncologie me´ dicale, AP–HP Tenon, Paris,
France
I. Krakowski, oncologie me´ dicale, centre Alexis-Vautrin,
Vandœuvre-le`s-Nancy, France
E. Luporsi, oncologie me´ dicale, recherche clinique et
biostatistique, me´ thodologie, centre Alexis-Vautrin,
Vandœuvre-le`s-Nancy, France
M. Namer, oncologie me´ dicale, Nice, France
Membres du jury
M. Aapro, Suisse
Y. Belkacemi, Paris, France
A. Di Leo, Italie
A. Dicato, Luxembourg
C. Isamel-Domenge, Bre´sil
D. Khayat, Paris, France
M. Marty, Paris, France
F. Mornex, Lyon, France
M. Piccart, Belgique
J. Pouyssegur, Nice, France
I. Tannock, Canada
S. Uzan, Paris, France
ONCOLOGIE
614

Membres du groupe de lecture
D. Azria, oncologie radiothe´ rapique, centre Val-
d’Aurelle-Paul-Lamarque, Montpellier, SFRO, France
J.-L. Beal, anesthe´ sie–re´ animation, Que´tigny, France
P. Bensa, neurologie, Marseille, France
P. Bertheau, anatomie pathologie, SFP, Paris, France
J. Camerlo, oncologie me´ dicale, institut Paoli-Calmette,
Marseille, France
A. Carbonne, biologie me´ dicale, AP–HP, La Pitie´-
Salpeˆtrie` re, Paris, France
E. Carola, oncologie me´ dicale, centre hospitalier de
Senlis, France
J. Carretier, coordinateur des SOR Savoir Patient, Paris,
France
B. Sigal-Zafrani, anatomopathologie, institut Curie,
Paris, France
V. Conri, oncologie chirurgicale, hoˆ pital Saint-Andre´,
Bordeaux, France
A. Courdi, oncologie radiothe´ rapique, centre Antoine-
Lacassagne, Nice, France
H. Cure, oncologie me´ dicale, centre Jean-Godinot,
Reims, GEPOG, France
P. Debourdeau, oncologie me´ dicale, HIA Desgenettes,
Lyon, France
C. Delcambre, oncologie me´ dicale, centre Franc¸ois-
Baclesse, Caen, France
V. Doridot, oncologie chirurgicale, centre Re´ publique,
Clermont-Ferrand, France
A. Dufresne, oncologie me´ dicale, hoˆ pital E
´douard-
Herriot, Lyon, France
M. Espie´ , oncologie me´ dicale, AP–HP Saint-Louis, Paris,
France
R. Fauvet, oncologie chirurgicale, CHU Sud-Amiens,
France
B. Fervers, oncologie me´ dicale me´ thodologie, centre
Le´on-Be´ rard, Lyon, France
P. Genie´ s, anesthe´ sie, Montpellier, France
G. Hirsch, soins palliatifs, centre hospitalier de Blois,
SFAP, France
G. Laval, soins palliatifs, hoˆ pital Nord Albert-Michallon,
Grenoble, SFAP, France
M. Le Heurteur, oncologie me´ dicale, centre Jean-Perrin,
Clermont-Ferrand, France
C. Le´ vy, oncologie radiothe´ rapique, centre Franc¸ois-
Baclesse, Caen, France
N. Mahmoudi, oncologie me´ dicale, centre hospitalier
de Bourganeuf, France
P. Marti, oncologie me´ dicale, centre hospitalier Drace´-
nie, Draguignan, France
G. Masse´, me´decine ge´ne´ rale, Reims, France
O. Mejjad, rhumatologie, CEDR, France
C. Meyer, oncologie chirurgicale, hoˆpitaux civils de
Colmar, Colmar, France
S. Million Daessle, radiologie, cabinet me´dical, Colmar,
France
E. Monpetit, radiothe´ rapie, clinique Oce´ane, Vannes,
France
P. Montcuquet, oncologie me´ dicale, clinique Saint-
Vincent, Besanc¸ on, France
L. Moreau, oncologie me´ dicale, clinique des Doˆ mes,
Clermont-Ferrand, France
F. Mousteou, gyne´ cologie me´ dicale, Cagnes-sur-Mer,
FNCGM, France
F. Penault-Llorca, anatomie et cytologie pathologiques,
centre Jean-Perrin, Clermont-Ferrand, France
F. Pinguet, pharmacien, Montpellier, SFPO, France
N. Pinto, oncologie radiothe´ rapique, centre de Haute-
E
´nergie, Nice, France
I. Piollet, psycho-oncologie, SFPO
J. Provencal, oncologie me´ dicale, centre hospitalier,
Annecy, France
K. Prulhiere Corviole, oncologie me´ dicale, polyclinique
de Courlancy, Reims, France
I. Ray-Coquard, oncologie me´ dicale, centre Le´ on-
Be´ rard, Lyon, France
D. Serin, oncologie me´ dicale et oncologie radiothe´-
rapie, institut Sainte-Catherine, Avignon, France
A. Serrie, me´ decine de la douleur, AP–HP Lariboisie`re,
Paris, SFETD, France
C. Sibai-Sere, gyne´ cologie–obste´ trique, Bordeaux,
FNCGM, France
H. Simon Swirsky, oncologie me´ dicale, hoˆ pital Morvan,
Brest, France
J. Stines, radiologie, centre Alexis-Vautrin, Vandœuvre-
le` s-Nancy, SOFMIS, France
D. Tammam, neurologie, Marseille, France
A. Toledano, oncologie radiothe´ rapique, clinique Hart-
mann, Neuilly-sur-Seine, France
P. Troufleau, radiologie, centre Alexis-Vautrin, Vandœu-
vre-le` s-Nancy, France
N. Tubiana-Mathieu, oncologie me´ dicale, hoˆpital
Dupuytren, Limoges, France
M. Untereiner, oncologie radiothe´ rapique, centre
Baclesse, Esch-sur-Alzette, Luxembourg
L. Vanlemmens, oncologie me´ dicale, centre Oscar-
Lambret, Lille, France
M. Veluire, gyne´ cologie, Athis-Mons, France
D. Zarca, chirurgie gyne´ cologique, Paris, France
J.-P. Ziccarelli, Anesthe´ sie–re´ animation, clinique Beau-
regard, Marseille, France
P. Zlatoff, oncologie chirurgicale, centre Le´on-Be´rard,
Lyon, France
CONSEIL SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC BOARD
615

Socie´te´ s relectrices
AFSOS : Association francophone pour les soins onco-
logiques de support
CEDR : Cercle d’e´ tude de la douleur en rhumatologie
FNCGM : Fe´de´ ration nationale des colle` ges de gyne´co-
logie me´dicale
GEPOG : Groupe d’e´ change de pratiques en oncoge´riatrie
SFAP : Socie´te´ franc¸aise d’accompagnement et de
soins palliatifs
SFCP : Socie´te´ franc¸aise de cance´ rologie prive´e
SFCO : Socie´te´franc¸ aise d’oncologie chirurgicale
SFETD : Socie´te´ franc¸aise d’e´tudeetdetraitementdela
douleur
SOFMIS : Socie´te´franc¸aise de mastologie et d’imagerie
du sein
SFP : Socie´te´ franc¸aise de pathologie
SFPOa : Socie´te´ franc¸aise de pharmacie oncologique
SFPOb : Socie´te´franc¸ aise de psycho-oncologie
SFRO : Socie´te´franc¸aise de radiothe´ rapie oncologique
Patientes
Jeannine, Reine, Sylviane, Corinne, Pascale, Martine, Catherine et Silke
Coordination logistique et scientifique : LOb Conseils
Pierre Ferran
Laurie Massa-Auvray
Nathalie Mathivas
Juliette Tessaire
Me´ thodologie des recommandations pour la pratique clinique
(RPC) Saint-Paul de Vence 2009
Contexte et organisation
Depuis 22 ans, les experts de la pathologie mammaire
se re´unissent a` Saint-Paul de Vence pour e´ changer les
nouvelles donne´ es scientifiques dans leur domaine
d’exercice. En 2003, le groupe a souhaite´ formaliser en
recommandations pour la pratique clinique (RPC) ce
cours pour aider tous les acteurs de soin du cancer du
sein dans leur pratique clinique. La premie`ree´ditiondes
RPC, issue du travail du groupe en 2003–2004, a e´te´
publie´ e en septembre 2005 (Oncologie, 2005 7(5):
342–79). Le projet continue dans une dynamique de
mise a` jour biennale en inte´ grant par ailleurs de
nouvelles questions.
Pour la publication 2007 (Oncologie, 2007 9:
593–644), le projet s’est construit autour d’un comite´
d’organisation constitue´ de Moı¨se Namer, Joseph
Gligorov, Elisabeth Luporsi et Daniel Serin.
Pour 2009, la RPC Nice-Saint-Paul de Vence, en plus
des mises a` jour, traite de nouvelles the´matiques dans
le cancer du sein et aborde les soins de support en
cance´ rologie en partenariat avec l’AFSOS (Association
francophone des soins oncologiques de support).
Objectif du document
Ces RPC visent a`ame´liorer la qualite´delapriseen
charge des patientes atteintes de cancer du sein en
fournissant aux praticiens une aide a`lade´cision
facilement utilisable et actualise´e.
Cible du document
Ces recommandations s’adressent aux acteurs de soin
prenant en charge les patientes atteintes ou a`risquede
cancer du sein.
Questions traite´es
–Cancers du sein :
cancers des femmes non me´nopause´es ;
cancers des femmes aˆge´ es (hors situation
me´ tastatique) ;
cancers me´ tastatiques ;
surveillance posttraitement locore´gional ;
–Soins de support :
abord veineux de longue dure´e ;
extravasation ;
inte´reˆ t de l’activite´physique;
e´pide´ miologie, diagnostic, facteurs de risque et
pre´ vention des douleurs neuropathiques chroniques
se´ quellaires apre` s traitement locore´gional ;
ONCOLOGIE
616
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
1
/
182
100%