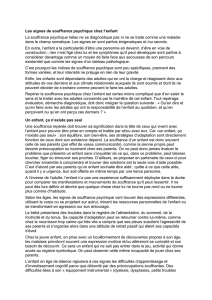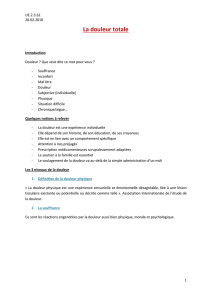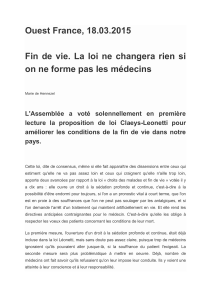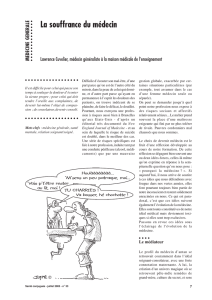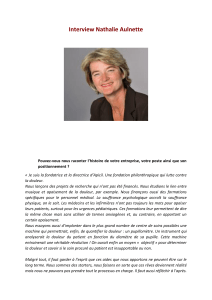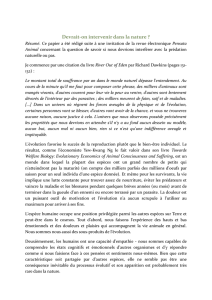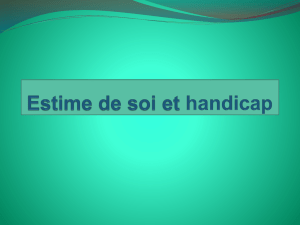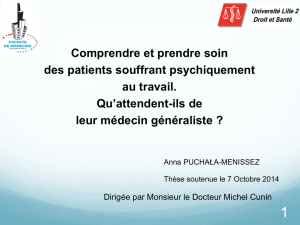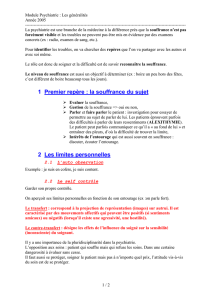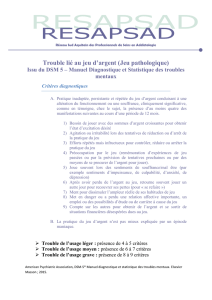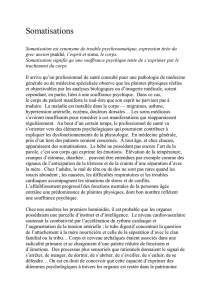La douleur : algie ou souffrance - Société Bioprogressive Ricketts

41
L’Orthodontie Bioprogressive - juin 2015
Adresse de correspondance : E-mail : [email protected]
À l’heure où les connaissances sur la psychologie de
la douleur sont devenues une actualité scientifi que,
le seul traitement médicamenteux peut paraître
insuffi sant. Soit parce qu’il ne traite pas la cause,
soit parce que la douleur est toujours associée à une
dimension psychologique. Le praticien qui s’imagine
ne traiter qu’un symptôme physique se fourvoie.
Dans cette approche thérapeutique il communique
déjà au patient le désir de ne pas se préoccuper de
sa souffrance. Il agit psychologiquement à son insu
(In-su).
Freud le premier, a invité les médecins à s’intéresser
non seulement au symptôme, mais à ce qui est dit de
celui-ci, afi n de rechercher la cause réelle du symp-
tôme : « vous avez mal, depuis quand, pourquoi,
comment ? Et à quoi nous renvoient les mots que
vous utilisez, votre langage est un code. »
L’odontologiste
dans son vécu clinique
Notre exercice, comme tout domaine médical nous a
confronté à la problématique de la douleur. Ayant par
ailleurs développé une compétence en psychologie
et en psychanalyse, nous avons dû évoluer de nos
connaissances de base vers une logique toujours plus
précise, obsédante, retournant, fouillant la logique
de la douleur, écoutant les patients. La douleur se
voudrait être un phénomène perceptif et traitable
techniquement, nous avons fi nalement découvert
un monde en soi, celui de l’humanité. Oui, la douleur
déborde largement sur le domaine de la souffrance,
et nous pourrions aujourd’hui énoncer : souffrir
c’est être humain. Nous espérons faire partager au
lecteur cette exploration étonnante de la douleur,
qui part d’un vécu négatif et peut si les circonstances
le permettent et si le praticien se situe de façon stric-
tement humaine, aboutir au franchissement d’une
étape de vie. En effet comme l’enseignent les philo-
sophes, il est des moments où l’homme doit renoncer
pour continuer, et ce renoncement peut se faire
dans la douleur. C’est exactement ce que signifi e le
terme proposé par FREUD : « la castration ». Douleur,
castration, renoncement, dépassement, voilà des
épreuves fondamentales de l’être, qui parfois se
ment à lui-même pour ne pas affronter ce moment
déterminant et le laisse dans un entre-deux insup-
portable. Derrière la douleur le patient cache une
vérité qu’il ne veut pas voir. Le praticien est-il alors un
gourou, un prêtre, un guide ? La tentation en serait
facile pour certaines personnes avides de pouvoir sur
l’autre. Ce qui nous sauve, c’est de savoir gérer cette
relation à mi-chemin entre le corps et la psyché, sans
être un « psy » ou un « sage », mais un praticien qui
La douleur :
algie ou souffrance ?
M.G. CHOUKROUN
Résumé
L’auteur propose de nommer « algie » les approches physiques de la douleur « l’algo-
thérapie » son traitement. Il présente l’aspect humain dit subjectif de la douleur c’est-à-
dire la « souffrance » et sa prise en charge selon les aspects les plus actuels des théories
psychologiques. Il présente des exemples cliniques pour illustrer cette approche.
Psychologie médicale

42
L’Orthodontie Bioprogressive - Vol. 23 - juin 2015
Choukroun M.G.
a étudié les implications psychologiques de son art.
Malheureusement, la faculté est encore très timide
sur cet enseignement et il m’a fallu fréquenter les
deux universités (médicale et psychologique) pour
acquérir cette compétence. Il ne faut pas s’étonner
que certaines personnes, faute de cumuler ces deux
diplômes, puissent par ignorance verser dans des
sciences douteuses, parfois ésotériques. Le traite-
ment peut être simple et biochimique ou biophy-
sique mais méfi ons-nous de jouer une complicité au
mensonge que le patient se fait à lui-même dans le
vécu de certaines douleurs.
Exemples cliniques
Un jeune patient se présente à ma consultation, se plaignant de douleurs consécutivement à la pose
d’une orthèse. Je lui prescris du paracétamol. Les jours suivants, le patient ne se plaint plus. L’interpréta-
tion médicale est simple : il s’agit d’un effet biochimique. Pourtant l’approche clinique agrémentée des
recherches en sciences humaines engendre plusieurs questions :
Est-ce le paracétamol qui a traité la douleur ? Est-ce la bienveillance du praticien qui a agit ? Est-ce l’effet
placebo du comprimé ?
Une autre patiente se présente en consultation se plaignant d’une fêlure dentaire très douloureuse. Son
odontologiste lui a proposé un traitement par pulpectomie. L’interrogatoire révèle que cette douleur
s’est déclarée lors d’une escapade à la campagne. Abandonnant ses enfants et son mari pour s’occuper de
son potager, la patiente déclare que la lésion est sans relation avec un traumatisme actuel ou antécédent.
Je lui explique que la fêlure n’est pas pathologique, que seule la douleur peut justifi er un acte thérapeu-
tique, je lui fais prendre conscience de la culpabilité qu’elle a éprouvée dans cette « escapade » et qu’elle
traduit sur son corps. Elle revient une semaine plus tard et déclare qu’elle a bien compris le sens de cette
douleur, et qu’elle ne ressent plus rien. La douleur était-elle réelle ? Pourquoi une pulpectomie aurait-elle
aussi répondu à la plainte ? Sur quoi exactement aurait agit l’acte médical ?
Une patiente se présente en consultation suite à une action très rapide sur un déplacement dentaire.
Elle désire anticiper sur la fi n de la correction et maintenir cette position obtenue. Je lui demande si elle
a souffert. Elle confi rme une douleur importante, mais me rassure en déclarant que celle-ci ne l’a pas
dérangée et qu’elle est contente du résultat.
Voici donc trois situations qui doivent nous interroger sur la nature de la douleur et de son traitement.
La douleur
et son champ sémantique
Les ouvrages médicaux que nous avons l’habitude de
parcourir n’exposent qu’un phénomène particulier
de la douleur. Ils analysent les éléments de la percep-
tion et de la sensation douloureuse, ainsi que les
circuits neurologiques, périphériques et centraux et
les médiateurs chimiques. Toute cette étude désor-
mais nous l’appellerons « l’algie » en relation avec
la réponse pharmacologique, qui lui correspond :
les antalgiques, les analgésiques, les anesthésiques
et de ce fait nous devons utiliser un terme pour le
traitement correspondant : « l’algothérapie ». Ces
innovations linguistiques nous permettent d’indi-
quer que la douleur n’est pas un terme scientifi que,
la parole reste le terme du patient. Nous devons le
conserver pour exprimer bien plus que ne le font
certains cliniciens qui réduisent cette clinique à la
partie objective de la douleur.
Pourquoi s’accorde-t-on à écrire qu’il existe une
partie subjective de la douleur et tenter avec insis-
tance de ne gérer que la partie objective ?
Pourquoi existe-il des échelles de la douleur comme
s’il fallait absolument objectiver le subjectif, sans
parallèlement subjectiver la réalité du patient ?
Pourquoi reconnaît-on l’effet placebo comme un
évènement affi rmé et positif, sans en chercher les
causes et les paramètres qui peuvent l’infl uencer ?
Humainement, le phénomène algique n’est pas
le seul qui affecte l’individu. C’est pourquoi nous
devons envisager le bouleversement psychique qui
accompagne la nociception et que nous nommerons
la douleur proprement dite. Au-delà de la douleur,
l’individu commotionné développe des réactions
d’adaptation, que nous pouvons regrouper sous le
terme de souffrance (Selon JD NASIO).

43
L’Orthodontie Bioprogressive - juin 2015
Psychologie médicale
Donc trois catégories de phénomènes :
• l’algie (phénomène perceptif),
• la douleur (plainte physique),
• la souffrance (plainte de l’être).
FREUD a désiré montrer que la douleur est un méca-
nisme de défense du sujet contre ses pulsions. L’être
humain utilise un processus physique d’alerte et de
défense contre les agressions environnementales. Ne
sachant combattre ses souffrances internes, il réuti-
lise ce processus de survie pour traduire de façon
métaphorique son mal-être. La preuve : la clinique
nous montre très souvent que sans s’occuper de la
cause physique de la douleur, celle-ci disparait. Le
contraire n’est cependant pas vrai. Certaines douleurs
persistent, non pas qu’elles soient objectives, mais
que le sujet s’y accroche pour ne pas rencontrer son
moi intérieur. D’où la nécessité pour le praticien de
respecter cette crainte.
Cette théorie rejoint totalement la recherche des
philosophes sur la réalité, à commencer par Platon : la
réalité extérieure est-elle objective ? Les philosophes
montrent que chacun perçoit la réalité selon son vécu
intérieur. D’où ce terme philosophique curieux, de
Réel avec un grand R. Le Réel est la vérité intérieure.
La réalité extérieure est fi ltrée par nos sens, certains
voient du noir ou d’autres voient du bleu, certains
voient le verre à moitié vide là ou d’autres le voient
à moitié plein. Nous comprenons bien à ce stade que
le langage est le médiateur idéal pour « jouer sur
les mots », à ceci près, que certains en arrivent au
point du délire : le verre n’existe pas (délire par sous-
traction : forclusion), il y a deux verres (délire par
addition, par création). Enfi n il y a le délire le plus
dangereux car jouant sur le rationnel, et dans une
société scientifi que le rationnel est « a priori » admis,
d’où tous ces patients qui semblent avoir raison mais
qui nous semblent « bizarres », (délire construit), le
plus affreux connu ayant été celui de Hitler avec sa
« solution fi nale ». Si l’homme normal est enrobé de
subjectivité, le délirant est lui radicalement patholo-
gique. C’est l’un des signes principaux de la psychose.
Nous retrouverons bien sûr ces phénomènes déli-
rants dans la clinique de la douleur :
absence de douleur (délire par déni, forclusion),
notamment chez les clochards qui refusent de
soigner des plaies graves. Douleur sur un organe
sain et exprimé par l’hypochondrie « j’ai des arai-
gnées qui me pincent le ventre docteur ». Ou encore
le patient qui demande des brackets transparents,
c’est-à-dire sans support matériel !
Application clinique
Un patient vient consulter pour une douleur chronique située an niveau du sterno-cleido-mastoïdien
droit.
Historique : ces douleurs ont suscité une consultation en médecine générale qui n’a pas donné de traite-
ment effi cace. Le patient est orienté en neurologie et fait l’objet d’une recherche de pathologies céré-
brales, avec scanner à l’appui. Les résultats sont négatifs. Il est alors invité à consulter une orthoptiste
dans le but de corriger une anomalie oculaire affectant les muscles posturaux. Cette démarche étant à
nouveau négative, le pauvre homme est orienté vers un orthodontiste pour explorer l’occlusion dentaire.
L’examen radiologique et clinique ne révèle aucune pathologie articulaire et nous devons conclure que
la douleur est probablement liée à une origine musculaire.
L’anamnèse va alors vite évoluer en hypnothérapie.
P : Quand avez-vous ressenti cette douleur pour la première fois ?
A : il y a trois mois docteur.
P : À quelle date plus précisément ?
A : En décembre 2006.
P : Dans quelles circonstances ?
A : J’étais dans ma voiture pour mon travail.
P : Racontez ?
A : Je travaillais beaucoup à cette époque…
P : Pour quelle raison ?
A : Parce que j’avais besoin d’argent.

44
L’Orthodontie Bioprogressive - Vol. 23 - juin 2015
Choukroun M.G.
P : Pourquoi ?
A : Pour racheter la maison de ma mère !
P : Ah ?
A : Oui, mon frère avait tout perdu au jeu et il a vendu la maison de la mère.
P : Et donc ?
A : Alors je travaillais tellement que j’étais obligé de m’arrêter pour dormir, je m’endormais au volant.
P : Vous dormiez dans la voiture ?
A : Oui.
P : On pourrait essayer de revisualiser la scène. Asseyez-vous confortablement.
Sentez-vous que vous êtes bien dans le fauteuil, peut-être comme dans votre voiture ?
Ratifi cation, dissociation, l’induction agit. Je lui demande de fermer les yeux et de sentir le froid autour
de lui, sur ses mains…
La résonance se met en œuvre et je rentre avec le patient dans son taxi. Je me situe derrière lui comme
s’il ne savait pas que j’étais là. Je le regarde épuisé, anxieux. Je vois sa tête lourde, ses paupières se
ferment et s’ouvrent plusieurs fois. Je le sens résister au sommeil. Finalement il s’endort. Ses muscles se
relâchent, sa tête s’écrase contre la vitre. Elle est très froide. Son cou se tord en même temps que le froid
se communique à tout son buste…
P : Je vous imagine très bien dans la voiture et donc en décembre il faisait froid, et vous dormiez, la tête
appuyée sur la vitre, le cou tordu…
A : C’est exactement cela docteur.
P : Donc vous avez attrapé un coup de froid.
A : Oui.
Le patient revit avec moi la scène évoquée… Il est en transe, immobile détendu, le regard absent, il est
dans l’Autre Scène. Sa souffrance est là entre nous, comme si elle prenait corps, comme si elle n’était plus
absorbée par le froid, les douleurs, le réel. Il est souffrance.
P : Vous ne pouviez pas laisser votre mère à la rue ?
A : Non.
P : Mais vous ne pouviez pas frapper votre frère, on ne frappe pas son frère…
A : C’est exact docteur.
P : Alors comment aimer sa mère et détester son frère : n’est-ce pas incompatible ?
A : Oui sa famille c’est sacré.
P : Il y a une réponse…
A : Laquelle ?
P : Les protéger tous les deux, c’est cela votre salut.
A : Oui mais comment ?
P : Avez-vous réussi à racheter la maison de votre mère ?
A : Oui, ma mère ne sera pas à la rue…
P : Et votre frère, joue-t-il toujours au jeu ?
A : J’ai bloqué ses comptes, il ne peut plus faire de bêtises.
P : Très bien ! Vous en voulez à votre frère ?
A : Oui, il m’a mis et ma mère avec, dans une drôle de situation, mais maintenant c’est fi ni.
P : Je vous propose de rester sur ce dernier mot.
En visite de contrôle, le patient a eu progressivement une disparition de ses symptômes.

45
L’Orthodontie Bioprogressive - juin 2015
Psychologie médicale
Analyse :
Nous avons donc toute la situation potentielle de la
genèse de la douleur. Le patient a vécu une séance
d’hypnose dans sa voiture (BENHAIEM parle « d’auto
hypnose » à prendre ici à la lettre !). Il s’isole dans sa
voiture, s’assoupit, concentre ses angoisses sur une
partie du corps et en fait une métonymie : une partie
du corps devient un signifi ant en douleur et repré-
sente l’ensemble de sa souffrance. L’hostilité envers
son frère, qui date probablement de son enfance
(sadisme secondaire), se réactualise dans cet enjeu
avec la mère et n’ayant pu l’exprimer, il la retourne
sur son corps (masochisme secondaire).
La séance d’hypnothérapie peut s’expliquer comme
un dénouement de ce lien métonymique.
Au-delà du langage exprimé dans la conscience, la
relation mise en place par le thérapeute permet de
faire fonctionner l’inconscient.
L’état psychique hypnotique et le transfert activé par
l’« inconscient instrumental » (JD NASIO) effectuent
une déliaison de la métonymie, visent à un apaise-
ment des pulsions hostiles.
Le patient visiblement avait résolu le problème. Pour-
quoi alors le symptôme avait-t-il persisté ? Parce que
la question affective, elle était restée en suspens.
Le thérapeute a décodé la situation philosophique
et a apporté une réponse. Le symptôme a perdu son
sens.
Mais alors qu’est-ce
que la douleur ?!
Lorsque le patient dit « j’ai mal », cette locution est
polysémique. Elle interpelle le thérapeute par une
demande que nous devons explorer avant de décider
quelle est l’attitude à adopter.
La douleur est un cri, un appel à l’autre, car seul un
être humain peut aider un autre être humain. Faute
de trouver dans son groupe une empathie, l’homme
moderne médicalise sa détresse et va trouver un
thérapeute pour plaider sa cause. Malheureuse-
ment, le thérapeute ne voit pas toujours la dimen-
sion humaine et ne lui renvoie rien d’autre qu’un
service technique dans lequel le patient bien souvent
doit se contenter de « glâner » un peu de transfert…
Conclusion
Recevoir en consultation la douleur d’un patient et
se contenter d’un comprimé, au sens littéral, n’est-ce
pas enfermer l’humanité dans une pilule… !
La douleur transcendée par les artistes
ED Glyphe de Patrice Queneau
Cet ouvrage préfacé par le professeur Henri-Bernard,
s’annonce en parfaite conformité avec nos pensées.
« Le symptôme douleur a un sens ; il s’inscrit dans
l’histoire, passée et présente de la personne malade. »
Pour ceux qui n’en seraient pas convaincus et qui
posent l’hypothèse de trouver la cause physique de
la douleur suffi t en soi pour la traiter, ce livre nous
adresse toute l’histoire de l’homme en images, à
travers la douleur comme expression de l’âme.
Le message chrétien notamment apparaît plus que
jamais différent des autres religions en ce sens qu’il
ne cherche pas à masquer la souffrance humaine
par une idéalisation de l’homme, mais au contraire
en le rendant plus que jamais réaliste par la « dolo-
rosité ». Que ce soit le « massacre des innocents »,
ou « la piéta » en peinture et en sculpture, l’auteur
 6
6
1
/
6
100%