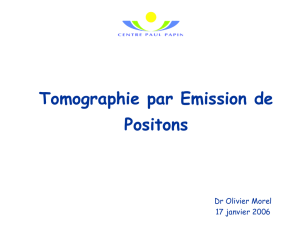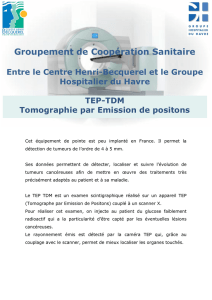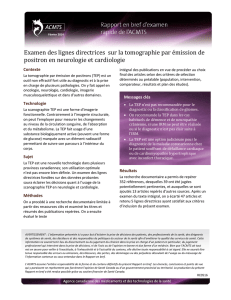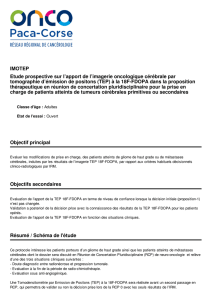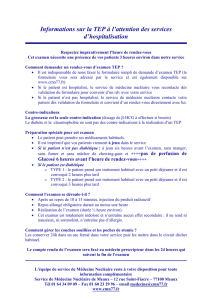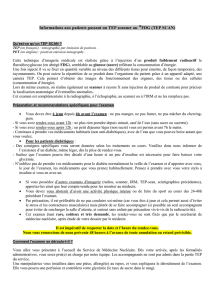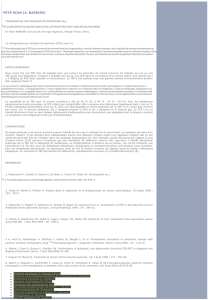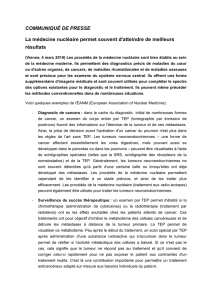Tomographie par émission de positons dans les lymphomes.

Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2001 - vol.25 - n°6 347
J. Lumbroso
Résumé
La tomographie par émission de positons (TEP) utilisant le 18-fluoro-desoxyglucose est
une modalité de la Médecine Nucléaire permettant une exploration fonctionnelle très précieuse
pour la détection des sites tumoraux de plusieurs types de cancers. Son application dans les lym-
phomes paraît déjà très prometteuse, à diverses étapes de la maladie : bilan initial pour l’aide à la
détermination du stade, analyse des masses résiduelles en fin de traitement, détection des rechu-
tes. De plus, la TEP réalisée en début de traitement pourrait avoir une valeur prédictive sur la
réponse en fin de traitement, ce qui permettrait de détecter précocement les patients qui n’entre-
ront pas en rémission à l’issue de ce traitement ; d’autre part, la TEP pourrait ainsi devenir un
outil indispensable pour l’évaluation de nouvelles drogues ou de nouvelles modalités thérapeuti-
ques dans les lymphomes.
Après un bref rappel du contexte clinique, cet exposé tente d’analyser, à la lumière des
références bibliographiques les plus récentes, la place actuelle de la TEP dans la maladie de
Hodgkin et dans les lymphomes non-hodgkiniens.
TEP / FDG / Lymphomes / Hodgkin
Correspondance et tirés à part : Dr Jean Lumbroso
Chef d’Unité, Médecine Nucléaire - Institut Gustave Roussy - 39 rue Camille Desmoulins - 94805 Villejuif Cedex
Tel : 01 42 11 42 79 - Fax: 01 42 11 52 24 - E-mail : lumbroso@igr.fr
Tomographie par émission de positons dans les lymphomes.
Jean Lumbroso Services de Médecine Nucléaire et de Physique, Institut Gustave Roussy,
Villejuif,
en collaboration avec le Service Hospitalier Frédéric Joliot, Orsay.
INTRODUCTION
ðLa tomographie par émission de po-
sitons (TEP) utilisant le 18-fluoro-
desoxyglucose (18FDG) est une mo-
dalité diagnostique de plus en plus
utilisée en Cancérologie [1].
De nombreuses publications ont
montré son intérêt pour la mise en
évidence des sites de lymphomes
(maladie de Hodgkin et lymphome
non Hodgkinien) avec des résultats
supérieurs à ceux obtenus grâce au
Gallium 67, utilisé depuis une tren-
taine d’années environ pour l’explo-
ration des lymphomes [2]. On peut
donc logiquement s’attendre à une
augmentation significative de la con-
tribution de la Médecine Nucléaire à
la prise en charge des patients atteints
de lymphomes [3].
La TEP au 18FDG est parmi toutes les
modalités d’imagerie médicale celle
qui paraît la plus sensible (en termes
de nombres de sites détectés par une
modalité unique) pour le bilan d’ex-
tension des lymphomes. Son utilisa-
tion peut permettre une meilleure
détermination du stade de la maladie
et par là même une meilleure adapta-
tion du traitement. De plus, le carac-
tère fonctionnel de l’exploration par
la TEP permet une évaluation précoce
de la réponse à la chimiothérapie,
avant modification volumique des
lésions cibles. De même, l’apport pa-
raît important pour le bilan des mas-

Tomographie par émission de positons dans les lymphomes
Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2001 - vol.25 - n°6
348
ses résiduelles après traitement ; la
TEP pourrait également être utile dans
le bilan de rémission des lymphomes
et la surveillance.
De nombreux articles de revue font
régulièrement le point sur les don-
nées bibliographiques concernant la
TEP dans les lymphomes, notamment
celui de Talbot et al. [4].
Les données actuelles montrent que
le 18FDG est fixé par la plupart des
lymphomes sauf par certains lympho-
mes non hodgkiniens de bas grade,
notamment les Malt.
Au moment du diagnostic et lors du
suivi en cas de maladie résiduelle,
compte tenu des réserves indiquées
ci-dessus concernant les lymphomes
de bas grade, la TEP est la modalité
qui à elle seule montre le plus grand
nombre de sites de la maladie. Au
niveau de la moelle osseuse, les infil-
trations médullaires correspondant à
un petit nombre de cellules lympho-
mateuses peuvent passer inaperçues
sur la TEP ; inversement la TEP ex-
plore tous les territoires médullaires.
La diminution de la fixation du FDG
est rapide après chimiothérapie, elle
pourrait indiquer une bonne réponse
à la chimiothérapie. La recherche
d’une fixation du FDG, par l’informa-
tion métabolique qu’elle apporte pa-
raît actuellement l’approche la plus
performante pour l’exploration des
masses résiduelles, avec des résultats
supérieurs à ceux du Gallium 67 : ceci
est probablement dû aux performan-
ces médiocres du Gallium en dehors
du médiastin, et à la faible résolution
de l’imagerie monophotonique ne
permettant d’analyser des lésions ré-
siduelles de petite taille.
La TEP n’a pas une sensibilité égale à
100 %, elle ne peut donc remplacer
les autres examens actuellement va-
lidés dans l’exploration des lympho-
mes. Néanmoins, elle peut les com-
pléter, les réorienter ou orienter une
biopsie.
De plus, la spécificité de la TEP est de
80 à 90 %, la confirmation cytologi-
que ou histologique d’un site tumo-
ral détecté uniquement par la TEP
reste vivement recommandée si son
résultat entraîne des modifications
importantes de la prise en charge,
surtout si celles-ci sont potentielle-
ment préjudiciables pour le patient
[5].
Il paraît préférable d’envisager sépa-
rément la problématique clinique
dans la maladie de Hodgkin et dans
les lymphomes non hodgkiniens.
MALADIE DE HODGKIN
ðLe point de départ de la maladie de
Hodgkin (MdH) est un site ganglion-
naire unifocal initial à partir duquel
se produit une dissémination princi-
palement lymphatique et plus rare-
ment hématogène.
Le diagnostic repose sur la mise en
évidence par un examen cytologique
ou histologique (biopsie) de la cel-
lule de Reed-Sternberg.
L’incidence de la maladie est de 1,7 à
2,4 cas annuels pour 100 000 habi-
tants dans l’Union Européenne. La
MdH représente en France 0,24 % de
la mortalité par cancer.
Près de 80 % des patients peuvent être
guéris. L’efficacité des associations de
radiothérapie et chimiothérapie est
prouvée mais l’incidence des com-
plications à long terme, essentielle-
ment cardiaques (radiothérapie), et
seconds cancers ou leucémies (radio-
thérapie, chimiothérapie) est liée à
l’intensité du traitement.
L’adaptation du traitement au stade de
la maladie est donc particulièrement
importante. En effet, un excès de trai-
tements sera ultérieurement respon-
sable d’une mortalité secondaire in-
due liée aux complications tardives.
A l’opposé, un traitement insuffisam-
ment intense entraînera une maladie
résiduelle ou des rechutes précoces,
nécessitant des traitements de rattra-
page qui ont cependant une bonne
efficacité.
La classification en stades de la MdH
repose sur les modifications dites de
"Cotswolds" [6] de la classification ini-
tiale d’Ann Arbor [7]. Les éléments
complémentaires de classification
comprennent l’absence (A) ou la pré-
sence (B) de signes généraux (perte
de poids ou fièvre ou sueurs noctur-
nes), la présence d’une masse tumo-
rale volumineuse (X) ganglionnaire
ou médiastinale et l’envahissement
localisé d’une structure extra-lympha-
tique (E).
Le classement des patients en grou-
pes thérapeutiques prend en compte
le stade et les facteurs pronostiques :
ces facteurs sont variables en fonc-
tion du stade de la maladie, il s’agit
essentiellement de l’âge, du nombre
de territoires ganglionnaires envahis,
de la vitesse de sédimentation, de
l’existence et de l’importance d’une
atteinte abdominale incluant l’atteinte
splénique, de la présence d’une ané-
mie, d’une élévation des LDH séri-
ques, d’un envahissement médullaire
et d’une atteinte multi-viscérale. Au
terme de cette classification, on iden-
tifie un groupe favorable, comprenant
essentiellement des patients ayant
une MdH stades I et II sus-diaphrag-
matique sans facteur pronostique dé-
favorable, pour lesquels une chimio-
thérapie allégée suivie d’une irradia-
tion des territoires initialement enva-
his peut être envisagée ; dans un sous-
groupe de patients à pronostic très
favorable (stade très limité, sujet
jeune) une radiothérapie seule peut
être envisagée. Cet allégement des
traitements permet de diminuer l’in-
cidence des complications tardives
par rapport aux associations incluant
une chimiothérapie prolongée suivie
d’une radiothérapie, réservées aux
stades défavorables.
Explorations conventionnelles.
Maladie de Hodgkin après diagnos-Maladie de Hodgkin après diagnos-
Maladie de Hodgkin après diagnos-Maladie de Hodgkin après diagnos-
Maladie de Hodgkin après diagnos-
tic histologtic histolog
tic histologtic histolog
tic histologique :ique :
ique :ique :
ique :
Les standards comprennent, outre l’in-
terrogatoire et l’examen clinique
complet, des examens d’imagerie dia-
gnostique qui sont la radiographie
pulmonaire, le scanner thoracique et
le scanner abdomino-pelvien. La lym-
phographie pédieuse n’est pratique-
ment plus utilisée et l’IRM, la scinti-
graphie osseuse, l’exploration de la
sphère ORL ne sont pratiquées qu’en
cas de signe d’appel.
Le scanner joue donc un rôle central
pour la détermination du stade de la
maladie ; sa sensibilité et sa spécifi-
cité sont étroitement liées au seuil
décisionnel qui permet de classer un
ganglion comme normal ou patholo-
gique. Ce seuil est généralement va-
riable : 10 mm pour les ganglions
trachéo-bronchiques, 12 mm pour les
ganglions carinaires, 15 mm selon les
recommandations de Cotswolds.
La scintigraphie au Gallium apporte

Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2001 - vol.25 - n°6 349
J. Lumbroso
essentiellement des renseignements
utiles pour l’extension thoracique de
la maladie mais ses performances
étant inférieures à celles du scanner,
elle ne fait pas partie des explorations
(standard) réalisées lors du bilan ini-
tial de la MdH [8,9].
La scintigraphie au Gallium 67 n’est
pas contributive au niveau de l’abdo-
men et du pelvis. La modalité de ré-
férence dans ce domaine est l’explo-
ration chirurgicale (laparotomie avec
biopsies multiples et splénectomie)
dont les résultats ont bien mis en
évidence les insuffisances du scan-
ner [10]. Néanmoins, la pratique sys-
tématique de la laparotomie a été
abandonnée en raison des risques et
des complications qu’elle entraîne :
il y a donc actuellement une "prise
de risque" sur la possibilité d’erreur
au niveau de l’appréciation par le
scanner de l’extension sous-diaphrag-
matique de la maladie ; ce risque d’er-
reur influe sur les décisions thérapeu-
tiques : celles-ci tiennent compte éga-
lement des informations fournies par
les facteurs pronostiques et de la pro-
babilité, obtenue à partir des bases de
données, de l’existence d’une exten-
sion sous-diaphragmatique plutôt
que de sa mise en évidence directe.
Evaluation de la réponse au trai-Evaluation de la réponse au trai-
Evaluation de la réponse au trai-Evaluation de la réponse au trai-
Evaluation de la réponse au trai-
tement.tement.
tement.tement.
tement.
Cette évaluation repose principale-
ment sur l’examen clinique, les exa-
mens biologiques et l’imagerie. Ce-
pendant, celle-ci met en évidence des
modifications morphologiques qui
sont parfois tardives et très souvent
partielles, conduisant au problème
des masses résiduelles qui concer-
nent près de 80 % des patients.
Aucune méthode ne permet d’affir-
mer ou d’exclure l’existence d’une
maladie résiduelle en cas de persis-
tance d’anomalies morphologiques,
il est donc proposé une surveillance
étroite, par scanner ou IRM, parfois
une biopsie ; le rôle de la scintigra-
phie au Gallium est diversement ap-
précié, une scintigraphie nettement
positive indiquant en principe un ris-
que élevé de persistance de la mala-
die ou de rechute [11,12,13].
SurSur
SurSur
Survv
vv
veillance après treillance après tr
eillance après treillance après tr
eillance après traitement aitement
aitement aitement
aitement
Le taux de rechute après la fin du trai-
tement initial est estimé à environ 30
%. Ces rechutes se produisent princi-
palement dans les 5 ans. Une sur-
veillance étroite est donc recomman-
dée après la fin du traitement (tous
les trois mois pendant deux ans, puis
allégement progressif jusqu’à une
surveillance annuelle au delà de cinq
ans). Cette surveillance repose sur
l’interrogatoire du patient et l’examen
clinique. Les examens para-cliniques
sont la NFS, la mesure de vitesse de
sédimentation et la radiographie tho-
racique ; les scanners sus- et sous-
diaphragmatiques sont optionnels.
Cette surveillance doit également in-
clure la détection des complications
possibles des traitements, soit béni-
gnes (hypothyroïdie), soit plus sérieu-
ses (insuffisance coronarienne, fi-
brose pulmonaire, second cancer et
leucémie).
La TEP dans la maladie de Hodgkin
Bilan initial de la maladie et TEPBilan initial de la maladie et TEP
Bilan initial de la maladie et TEPBilan initial de la maladie et TEP
Bilan initial de la maladie et TEP
Plusieurs études ont comparé l’apport
de la TEP en complément du scan-
ner. La grande sensibilité de la mé-
thode est constamment retrouvée [4,
14]. L’étude de Bangerter [15] mon-
tre un avantage de la TEP pour la dé-
tection d’adénopathies claviculaires,
axillaires et éventuellement inguina-
les ; il n’a pas été mis en évidence
d’apport décisif de la TEP pour l’ap-
préciation de l’extension sous-dia-
phramatique qui est un facteur impor-
tant dans la détermination du stade.
Par contre, une supériorité de la TEP
par rapport à l’imagerie convention-
nelle a été mise en évidence pour l’ap-
préciation de l’extension viscérale. De
même, un avantage a été retrouvé au
niveau de l’appréciation de l’exten-
sion ostéo-médullaire de la maladie,
la biopsie médullaire pouvant être
mise en défaut en raison de l’hétéro-
généité de cette atteinte.
L’étude de Partridge [16] a montré
l’influence de la TEP sur la détermi-
nation du stade de la maladie, avec
une augmentation du stade chez 18
sur 44 patients et une diminution du
stade chez 3 sur 44 ; les modifica-
tions thérapeutiques ont respective-
ment concerné 10/18 et 1/3 patients.
L’étude de Jerusalem [5] a porté sur
33 patients ; la TEP avant traitement
de la MdH a permis de détecter tous
les ganglions pathologiques de plus
de 1 cm de grand axe. Cependant,
seul 1 patient a bénéficié grâce à la
TEP d’une diminution du stade de la
maladie avec modification thérapeu-
tique.
Bien que ces données soient encore
incomplètes et insuffisantes sur le
plan de la spécificité des images TEP,
il semble donc que la réalisation d’un
examen TEP lors du bilan initial de la
MdH pourrait avoir une importance
sur le plan de la détermination du
stade et donc la classification dans les
groupes thérapeutiques. Ceci pourrait
amener à une meilleure adéquation
du traitement à l’extension de la ma-
ladie, la détection précoce des stades
étendus évitant la réalisation de trai-
tements de rattrapage (bien que ceux-
ci soient efficaces) , alors que l’allé-
gement des traitements pourrait être
proposé avec une meilleure sécurité
aux patients atteints de stades peu
étendus, faisant partie des groupes
favorables ou très favorables. Pour ces
derniers, l’incidence des complica-
tions tardives des traitements pour-
rait être diminuée, entraînant un bé-
néfice indiscutable à long terme.
Evaluation de la MdH après trai-Evaluation de la MdH après trai-
Evaluation de la MdH après trai-Evaluation de la MdH après trai-
Evaluation de la MdH après trai-
tement.tement.
tement.tement.
tement.
Une étude clinique récente [17] a con-
cerné 37 patients atteints de MdH qui
ont bénéficié en fin de traitement
d’une réévaluation de la maladie par
scanner et TEP. La sensibilité et la spé-
cificité (détection des rechutes)
étaient respectivement de 72 % et 21
% pour le scanner et de 91 % et 69 %
pour la TEP. L’influence du résultat du
scanner n’était pas significative sur
les courbes de survie sans progres-
sion (suivi moyen 26 mois) , alors que
celle du résultat de la TEP l’était net-
tement ; par contre, ni le résultat de
la TEP, ni celui du scanner réalisés en
fin de traitement n’avaient d’in-
fluence sur les courbes de survie glo-
bale dans cet intervalle de sur-
veillance, probablement en raison de
l’efficacité des traitements de rattra-
page. Cette étude n’a pas comporté
de comparaison avec le Gallium 67.
Cependant, les études préliminaires
comparant la TEP au Gallium 67 pour
l’évaluation post-thérapeutique sont
en faveur de la TEP FDG [18].
Les facteurs influençant négativement

Tomographie par émission de positons dans les lymphomes
Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2001 - vol.25 - n°6
350
la spécificité de la TEP peuvent être
un délai insuffisant entre la fin du trai-
tement et la réalisation de la TEP, par-
ticulièrement pour la radiothérapie
(possibilité de pneumopathie radi-
que) [19], ou aux conditions de réali-
sation de l’examen (artéfacts, absence
de correction d’atténuation).
LYMPHOMES NON-HODGKINIENS
ðLes lymphomes non hodgkiniens
(LNH) représentent la 5ième affection
maligne aux USA avec une prévalen-
ce annuelle de 55 à 60 000 cas (12 à
15 cas annuels pour 100 000 habitants
aux USA et en Europe). Ils sont res-
ponsables aux Etats Unis de 24 000
décès annuels. On observe un ac-
croissement annuel de l’incidence de
4 à 5 % par an, sans explication uni-
voque. Il s’agit d’une affection qui
recouvre une grande hétérogénéité
nosologique et regroupe une quaran-
taine d’entités différentes sur les
plans clinique, immuno-histologique
et cytogénétique.
Plus que le stade, le caractère déter-
minant dans le pronostic des LNH est
l’agressivité, qui conduit à une clas-
sification en LNH de bas grade, de
grade intermédiaire ou de haut grade.
Les LNH de bas grade représentent
environ 40 % des patients. Ils sont ca-
ractérisés par une longue évolution
pauci-symptomatique, sont souvent
étendus au diagnostic (d’après l’exa-
men clinique et le scanner) et offrent
peu d’options thérapeutiques. La sur-
vie médiane est de 10 à 12 ans, un
certain nombre de ces LNH de bas
grade vont se transformer (10 à 20 %
des cas) en LNH agressifs.
Les LNH de haut grade (10 % des pa-
tients) ont un pronostic redoutable à
court terme et justifient une poly-chi-
miothérapie permettant d’obtenir
environ 60 % de rémission complète ;
la recherche précoce des réponses
incomplètes et des rechutes est un
problème important pour le clinicien.
Les LNH de grade intermédiaire re-
présentent environ 40 % des patients :
1/3 de ces patients ont une maladie
peu évoluée et bénéficieront d’un
traitement par chimiothérapie, éven-
tuellement complétée d’une radiothé-
rapie, dont l’usage est moins impor-
tant que dans la maladie de Hodgkin.
En cas de stade limité confirmé par
les méthodes diagnostiques, le traite-
ment de ces patients pourrait être al-
légé. Inversement, l’alourdissement
du stade orientera vers un allonge-
ment de la chimiothérapie. Les LNH
de grade intermédiaire posent égale-
ment le problème de l’évaluation de
la réponse thérapeutique (présence
de masses résiduelles dans environ
40 % des cas) et de la surveillance
après traitement.
TEP et grade des LNH
ðLapela et al [20] ont montré l’exis-
tence d’une association statistique
entre le grade des LNH et les paramè-
tres de consommation du glucose ou
de fixation du FDG (SUV). Ils ont mis
en évidence des différences signifi-
catives entre les LNH de bas grade et
de haut grade, avec toutefois pré-
sence d’une zone de recouvrement.
L’intérêt de l’examen TEP repose es-
sentiellement sur son caractère non
invasif, permettant une répétition pen-
dant le suivi.
TEP et bilan d’extension des LNH
ðLa méthode de référence actuelle-
ment reconnue pour la détermination
du stade des LNH est le scanner. Une
étude clinique a comparé [21] les per-
formances diagnostiques de la TEP et
du scanner au niveau des atteintes
ganglionnaires et extra-ganglionnaires
sus et sous-diaphragmatiques ; les
résultats de cette étude sous la forme
de courbes de R.O.C. ont montré un
gain en sensibilité et en spécificité
apporté par l’utilisation de la TEP qui
a dans tous les cas montré plus de
sites de lymphome que le scanner
(gain en sensibilité de 10 à 20 %). Il
semble donc que la TEP ait là encore
un intérêt pour améliorer la précision
de la détermination du stade de la
maladie.
LNH et évaluation post-thérapeu-
tique par la TEP
ðAprès la fin de la chimiothérapie
de première ligne, la TEP réalisée dans
un délai de 1 à 3 mois a montré dans
une étude clinique [22] une rechute
ou une progression de la maladie
chez tous les patients chez lesquels
elle était positive, indépendamment
du résultat du scanner. Chez les pa-
tients ayant une TEP négative alors
que le scanner montrait une masse
résiduelle, une progression de la
maladie n’a été détectée que dans 1
cas sur 13, alors que chez 43 patients
ayant une imagerie conventionnelle
négative et une TEP négative il y a eu
dans 10 cas une rechute de la mala-
die. Ces résultats montrent que la clas-
sification des patients après chimio-
thérapie première est considérable-
ment améliorée par la TEP par rapport
à l’utilisation du scanner. Des résul-
tats analogues ont été retrouvés par
Jérusalem et al [23] montrant une très
nette influence des résultats de la TEP
sur les courbes de survie sans pro-
gression, comparées à l’influence
modérée de la présence ou de l’ab-
sence d’une masse résiduelle sur le
scanner. Dans l’étude de Mikhaeel et
al. [24], la positivité de la TEP a été
prédictive de rechute dans 100 % des
cas alors que ces rechutes n’étaient
observées que chez 18 % des patients
ayant une TEP négative. De plus, cette
étude a montré la concordance des
résultats de 4 examens TEP réalisée
précocement (après 2 à 3 cycles de
chimiothérapie) avec les résultats de
la TEP réalisée en fin de chimiothéra-
pie. Ces résultats sur la valeur prédic-
tive d’une TEP réalisée précocement
après une médiane de 3 cycles de
chimiothérapie ont été confirmés par
Jérusalem et al [25] chez 28 patients
atteints de LNH : la positivité de la
TEP réalisée précocement a été
corrélée chez 5 patients avec l’ab-
sence de rémission complète en fin
de traitement (4 sur 5) ou une rechute
ou réévolution (5/5). Un résultat né-
gatif de la TEP a été associé chez 7/21
patients à une rechute ou une réévo-
lution de la maladie, ce qui indique
une sensibilité prédictive modérée de
cet examen (environ 50 %) et une
grande spécificité (près de 100 %).
Ces résultats pourraient avoir une
grande valeur pour la modification
précoce de certaines chimiothérapies
ou l’évaluation de nouveaux proto-
coles thérapeutiques.

Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2001 - vol.25 - n°6 351
J. Lumbroso
COMPARAISON DE LA TEP FDG
ET DU GALLIUM 67 DANS LES
LYMPHOMES
ðLes données les plus récentes sont
actuellement disponibles sous la
forme de résumés de présentation à
des congrès (à l’exception de A Rifai
et al. [14]), elles paraissent néanmoins
tout à fait significatives.
Dans le bilan initial et la détermina-
tion du stade de la maladie, deux étu-
des [26,27] ont montré une nette su-
périorité en terme de classification
des patients en stade (différentiel de
sensibilité de 20 %) et en terme de
nombre de sites détectés (différentiel
de sensibilité de 30 %). Pour la détec-
tion de la maladie résiduelle,
Kostakoglu [18] a retrouvé chez 46
patients examinés après traitement
(LNH : 36 cas, MdH : 10 cas) 40 con-
cordances entre la scintigraphie au
Gallium et le résultat de la TEP et 6
discordances, avec positivité isolée
d’un seul examen; une biopsie (1
patient) et l’évolution clinique ont
validé dans les 6 cas le résultat de la
TEP, le gallium-67 se trouvant en dé-
faut. Dans notre étude [28] concer-
nant les LNH, les résultats du gallium-
67 ont été décevants. L’intérêt actuel
du gallium paraît circonscrit aux mas-
ses résiduelles médiastinales dans les
MdH. Certains auteurs font valoir des
arguments pratiques liés à la durée
de l’examen TEP (réponse en 2 heu-
res contre 48 heures pour le gallium)
et des arguments théoriques liés à la
physique de détection en TEP :
meilleure statistique photonique per-
mettant de détecter des contrastes
plus faibles qu’en SPECT, meilleure
résolution (5 mm en TEP contre 1,5 à
2 cm en profondeur pour la SPECT)
évitant l’effet de volume partiel pour
la détection de foyers fixants de pe-
tite taille, exploration tomographique
du corps entier, possibilité de quan-
tification par le SUV. Tout ceci sem-
ble indiquer que la scintigraphie au
gallium-67 doit être remplacée par la
TEP FDG chaque fois que ceci est
possible.
Il n’en demeure pas moins que les
deux approches reposent sur des
principes différents, la fixation du
FDG est liée à une augmentation lo-
cale de l’entrée cellulaire du glucose,
la fixation du gallium-67 reposant sur
de multiples mécanismes complexes
(liaison à la transferrine, fixation lyso-
somiale) ; des informations nouvel-
les pourraient donc être obtenues a
partir des discordances de résultat
entre les deux examens.
LIMITES DU FDG
ðComme tout examen d’imagerie, la
TEP FDG comporte un seuil de dé-
tection : dans ce cas, il s’agit d’un si-
gnal positif indiquant une augmenta-
tion de la fixation du FDG et donc
une anomalie du métabolisme gluci-
dique tissulaire. Pour être détectable,
ce signal doit être suffisamment in-
tense et concerner une lésion d’un
volume suffisant (en théorie 2 fois la
résolution de l’appareil de détection
pour éviter l’effet de volume partiel).
En pratique, ceci correspond à un
seuil de 5 à 10 mm en fonction de la
localisation superficielle ou profonde
du site tumoral détectable. Ceci ex-
clut la possibilité de détecter une
maladie microscopique, sous la for-
me d’îlots de cellules tumorales. Par
contre, une atteinte microscopique et
diffuse d’un organe tel que la rate
pourra être détectée si elle s’accom-
pagne d’une augmentation diffuse du
métabolisme glucidique.
La spécificité de la fixation du FDG
n’est pas parfaite, comme cela a été
décrit pour toutes les applications
cancérologiques de la méthode : des
lésions inflammatoires, granuloma-
teuses ou post-radiques peuvent en-
traîner des fixations du FDG, souvent
reconnues en raison du contexte cli-
nique ou de la topographie des ima-
ges.
Pour ce qui concerne plus spécifi-
quement l’exploration des lympho-
mes, il faut rappeler que le thymus
peut présenter une fixation du FDG,
physiologique ou en cas de rebond
après chimiothérapie ; la résolution
des images TEP permet en général de
reconnaître la morphologie de cette
glande. De même, la moelle osseuse
peut fixer de façon diffuse, souvent
homogène après une chimiothérapie
(augmentation du métabolisme mé-
dullaire liée à la régénération des li-
gnées sanguines). Occasionnelle-
ment, des pathologies cancéreuses ou
non lymphomateuses peuvent être
mises en évidence par l’examen. Les
paramètres physiques de la réalisation
de l’examen doivent également être
pris en compte. Idéalement, la semi-
quantification de l’examen avec dé-
termination du paramètre SUV néces-
site la réalisation d’images corrigées
pour l’auto-atténuation ; toutefois,
avec les caméras TEP actuelles, dans
un souci de limitation de la durée de
l’examen tolérable par le patient, le
plus souvent les examens ne sont
pas corrigés pour l’auto-atténuation
et ne sont donc pas quantifiés : il y a
donc une interprétation visuelle des
fixations, qui peut être en partie sub-
jective. Une amélioration est attendue
sur ce plan grâce au couplage des
caméras TEP avec un dispositif à
rayons X du type scanner, qui permet-
tra l’obtention en quelques secondes
des images nécessaires à la correc-
tion d’atténuation et qui également
permettra d’identifier chaque foyer
fixant sur le plan anatomique, amé-
liorant la spécificité de l’interpréta-
tion des examens.
CONCLUSION
TEP et maladie de HodgkinTEP et maladie de Hodgkin
TEP et maladie de HodgkinTEP et maladie de Hodgkin
TEP et maladie de Hodgkin
Dans le bilan initial de la MdH, la TEP
semble avoir un apport modéré, qui
pourrait néanmoins être précieux
pour la diminution des risques à long
terme, liés au traitement par radio-
chimiothérapie, dans les stades limi-
tés favorables ou très favorables ; la
TEP pourrait également avoir un in-
térêt pour l’exploration complémen-
taire d’images jugées douteuses sur
les explorations conventionnelles no-
tamment adénopathies de taille li-
mite). Une évaluation complémen-
taire est nécessaire pour apprécier
l’impact de la TEP sur la prise des dé-
cisions thérapeutiques et les résul-
tats : on peut donc recommander l’in-
clusion de la TEP dans tous les essais
thérapeutiques à venir concernant la
MdH.
L’évaluation très précoce de l’effica-
cité thérapeutique paraît être une voie
très prometteuse avec des objectifs
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%