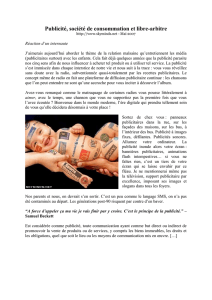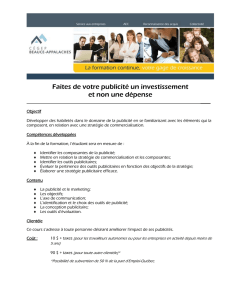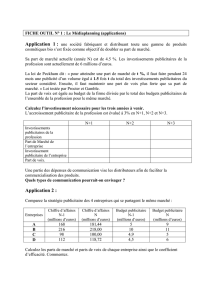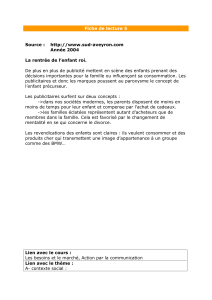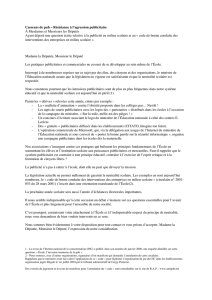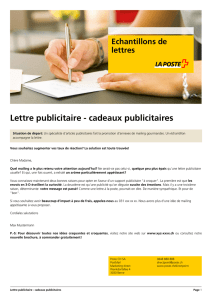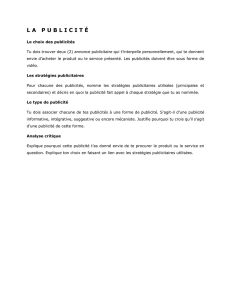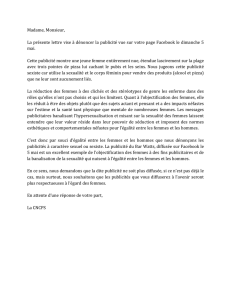La publicité tentaculaire - com1422

La publicité tentaculaire
Jean-Claude Ravet
La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force - George Orwell, 1984
La publicité conquiert sans cesse de nouveaux espaces. Insatiablement. Elle tend à coloniser le
moindre recoin de l'espace public. L'homme-sandwich d'antan s'est policé et généralisé. Il est
devenu homme de la rue, citoyen consommateur. Les écoles ouvrent leurs portes et leurs cahiers
aux commandites. Les lieux publics sont rebaptisés de noms de compagnies. Les publicitaires sont
les nouveaux mécènes de l'art, du sport, des universités, de l'information. Les politiciens se forment
à l'école du marketing, tandis que les publicitaires sont invités tout naturellement dans les médias à
commenter les affaires publiques, à expliquer pourquoi tel politicien se vend bien et tel autre pas.
Un expert en publicité affirmait récemment: «Vendre un politicien c'est comme vendre du
dentifrice, à la seule exception que le dentifrice ne parle pas»!
L'espace privé est tout autant ciblé. Celui des enfants et ados ne fait pas exception, au contraire. Il
fait l'objet d'une intense convoitise - et on s'étonne qu'ils se modèlent à l'image que la pub projette
d'eux. Sur Internet, les communications peuvent être gratuites à condition de visionner un certain
nombre de pubs. Le cellulaire n'est pas en reste: certains offrent la gratuité si la conversation est
entrecoupée de spots publicitaires aux deux minutes.
La pieuvre publicitaire étend ses tentacules. Et nous sommes ses proies. Souvent dociles.
Consentantes ou non. Nous devons nous déprendre, rivaliser d'astuce pour lui échapper encore.
Mais combien ont abandonné le combat. Elle gruge nos résistances. Elle apprivoise nos répulsions.
Elle devient art, savoir, beauté, nature. Patrimoine à préserver du temps qui passe, dans des
musées, et même mémoire «de nos rapports sociaux» (sic), selon les propos du président de
l'Association des agences de publicité du Québec, Yves Saint-Armand, rapporté par Fabien Deglise
(Le Devoir, 21 février 2006).
L'industrie publicitaire, quant à elle, montre patte blanche. Elle est dans son droit, et nous, libres de
la regarder ou non - on calcule en milliers le nombre de pubs qui nous assaillent par jour! Faudrait-il
marcher à tâtons, ne plus lire les journaux?
C'est ce phénomène envahissant - si peu remis en cause - dont nous voulons prendre la mesure.
Pourquoi la pub est-elle l'air que nous respirons? Pourquoi s'immisce-t-elle dans notre existence
entière, tout naturellement? Pourquoi laisse-t-on la société se modeler à la pub - médias, politique,
culture? Pourquoi la dit-on inoffensive alors qu'on dépense des sommes faramineuses pour la
produire et la diffuser? Pourquoi les sciences neuronales, psychologiques, comportementales y sont-
elles mises à contribution - tout en en appelant à la liberté individuelle? Pourquoi cette insouciance
envers elle... quand elle fait vivre de plus en plus nos journaux, nos médias, notre pensée?
Une voiture longe une route bordée de chaque côté de hauts panneaux-réclames représentant un
horizon azuré et campagnard - au-delà, invisible aux yeux des automobilistes, s'étend le désert du
réel, lugubre, désolé. Ce plan célèbre du film futuriste des années 1980 Brazil, de Terry Gilliam, en
dit plus sur la société contemporaine qu'il n'y paraît. Non que la publicité nous cacherait la vue,
même si elle est de plus en plus omniprésente. Son jeu n'est pas de boucher l'horizon, c'est de se
substituer à lui. Elle ne cache pas, elle montre, et montre tant et tellement qu'elle aveugle. Elle fait
rêver les yeux ouverts. Au lieu de la réalité elle projette l'image de la réalité.
[début de la p. 11 du texte original]

La pub n'est pas un mur mais un filet qui piège notre existence, l'arrache du monde - constitué de
mémoire, de paroles, de désirs autant que d'êtres et de choses. Elle met à la place, au moyen de
désirs succédanés et d'images prédigérées, dans le seul but de vendre, un univers fabuleux de
marchandises où les être humains dorénavant se meuvent. Mais elle le fait de telle manière qu'elle
efface le caractère marchand des choses et met en scène leur vie extraordinaire, source de bonheur
et de jouissance dans laquelle notre pauvre et terne existence a l'occasion enfin de s'épanouir. Le
bonheur a désormais un visage que tous voudraient presser contre soi: le capitalisme. La pub y a une
valeur thérapeutique indéniable: elle nourrit le désir dans une société inégalitaire.
Car le but de la publicité n'est pas tant de vendre tel ou tel produit. C'est là une fonction bien
secondaire en regard de celle de domestiquer l'existence, de rendre naturelle et désirable la
production déchaînée de marchandises en quête de clients. Celle-ci traque sa proie, elle en a besoin
pour vivre. L'achat boulimique est l'autre face de la croissance continue de la production sur laquelle
le capitalisme repose. Il s'agit de nourrir sans relâche cette grande bouche dévastatrice qui gère et
digère le réel. Chacun doit accepter de se vendre et de négocier ses conditions d'élevage.
Il ne faut pas s'étonner que cette manière de vivre sous le signe de la marchandise fasse fleurir la
marchandisation des corps. La multitude de corps esthétisés, irréellement beaux, sans défaut,
érotisés, insatiables de désir à fleur de peau virtuelle - banalement projetés tous azimuts -,
représentent à merveille le rêve sans merci du capitalisme: une marchandise humaine si étrangère à
son humanité «qu'elle vit sa propre destruction comme une jouissance esthétique de tout premier
ordre» (Walter Benjamin).
Cet humble dossier contribuera peut-être à en crever l'écran.
[début de la p. 12 du texte original]
L'air publicitaire
Nicolas Renaud, rédacteur au webzine Hors champ
Au-delà de chaque publicité qui glorifie un bien de consommation quelconque, c'est l'ensemble de la
logique publicitaire qui investit tous les recoins de la société, assurant ainsi une fonction de
reproduction idéologique.
Parler de publicité implique généralement une opinion: on l'aime ou on ne l'aime pas. On l'aime
parce qu'elle amuse, qu'elle informe, qu'elle est «bien faite»; on ne l'aime pas parce qu'on la trouve
stupide, insidieuse ou «mal faite». Par-delà ces critiques, nous serions finalement tous libres de la
regarder ou pas, et d'être ou non influencés par ses messages. Nous serions «libres de choisir».
Ces arguments demeurent à la surface de la réalité publicitaire et jouent même son jeu jusqu'à un
certain point. En effet, plus qu'une «réclame» pour un produit ou un autre, la publicité répond d'une
logique plus vaste et déterminante: celle de s'imposer en tant que partie intégrante et légitime de la
culture et, par le fait même, d'assurer la représentation idéologique de la société capitaliste,
consumériste, individualiste et médiatique. La publicité cherche à s'étendre dans l'espace, sur tous
les supports de diffusion, dans diverses formes de mise en scène, pour normaliser la logique
marchande et auréoler le pouvoir économique d'un «rôle social».
La liberté de choisir?

Dès lors, l'argument de la «liberté de choisir» n'a de sens que dans une discussion qui se limite à
l'impact de la publicité sur les esprits. Il est vrai que cet effet est variable selon les individus. Pour
plusieurs, la publicité joue certainement un rôle dans l'orientation de leurs désirs, de leurs
comportements et de leurs dépenses. C'est donc à l'égard des intentions persuasives de la publicité
que s'affirmerait la liberté du spectateur consommateur. Le point de vue critique se résume alors à
dénoncer la manipulation des esprits par la publicité. C'est là donner beaucoup de crédit aux
publicitaires, comme s'ils parvenaient à «programmer» les êtres humains. Même dans l'éventail de
leurs tactiques «subliminales», nous sommes loin de pouvoir croire qu'ils détiennent réellement les
secrets de l'inconscient et des ondes vibratoires du désir. Certes, l'impact psychologique et
commercial de la publicité est une donnée réelle - davantage dans certains cas, par exemple auprès
des enfants. Cet impact demeure néanmoins une notion vague et incertaine. Les ventes de Honda
sont en hausse alors que celles de Ford stagnent. Rien ne permet de croire que la situation
s'inverserait si Honda cessait toute publicité ou que Ford en diffusait deux fois plus.
Le véritable enjeu est le suivant: de la même manière que nous sommes libres de vivre en ville mais
pas de l'air qu'on y respire, personne n'est libre à l'égard de l'omniprésence publicitaire qui
contamine tout «l'oxygène social». Nous pouvons bien décider qu'elle ne nous dérange pas et
affirmer que nous avons le choix de regarder ailleurs. Il est toutefois impossible de s'affranchir de ce
qui apparaît partout dans notre champ visuel, qui fragmente la pensée devant un film ou les
nouvelles télévisées, qui est devenu la condition d'existence des événements sportifs et culturels...
Du reste, cette idée de la liberté de choisir est elle-même produite en partie par l'idéologie. Elle est
essentielle à la société capitaliste, l'individu doit être fondé comme sujet libre de ses désirs, de ses
pulsions, de son expression et de ses choix. Une part de cette liberté n'est qu'une nouvelle
«contrainte», une sommation de choisir librement dans l'abondance offerte. Si la société de
consommation exalte la liberté de choisir, elle s'appuie sur la contrainte d'affirmer cette liberté dans
la consommation (voir: Jean Baudrillard, La société de consommation).
La conquête de l'espace public
La publicité occupe de manière stratégique le champ de la perception dès que l'on s'avance dans
l'espace social, que ce soit en prenant l'autobus, en allant au cinéma, en roulant sur l'autoroute ou
en consultant ses courriels. Son expansion est constante dans l'espace physique et médiatique (en
2005, les télédiffuseurs ont demandé au CRTC la permission d'augmenter de deux minutes par heure
le temps pouvant être consacré à la publicité). Elle se fixe sur tout nouveau moyen de
communication, comme Internet et les téléphones portables.
À la télévision, la publicité exerce indirectement une certaine censure. Toutes les minutes occupées
par les pauses commerciales au cours d'un bulletin de nouvelles condensent davantage l'information
- pourtant déjà limitée et trop souvent traitée de manière superficielle. De nombreux réseaux privés
ne diffusent, après minuit, que des infopublicités. Il n'y a pas si longtemps, à la même heure, ces
[début de la p. 13 du texte original]
réseaux diffusaient des films. Les possibilités sont infinies quant à ce qu'on pourrait choisir de
présenter, au lieu d'abandonner les ondes à de longues émissions publicitaires vantant les mérites
de toutes sortes de gadgets, quand ce n'est pas de produits et de services à caractère sexuel.
Désormais, une grande part du petit écran appartient principalement à un vaste et croissant marché
du sexe - et pour que ce marché fleurisse et que les médias en profitent, il faut bien que la sexualité
soit «libérée».

Un autre espace public particulièrement remodelé par l'empire publicitaire est celui des enceintes
de sports professionnels. Les nouveaux amphithéâtres de hockey doivent permettre d'accroître les
revenus en augmentant le nombre de sièges et de loges corporatives, ainsi que l'espace vendu à la
publicité. L'amphithéâtre sportif est ainsi devenu un prototype de médium publicitaire total, un
immense dispositif technologique pouvant à tout moment capter l'attention des spectateurs et
diffuser un maximum de messages publicitaires dans une variété de formes.
Rappelons que ce n'est qu'à la fin des années 1980 que la publicité a commencé à tapisser le
pourtour des bandes et les gradins. Aujourd'hui, des logos sont même imprimés sur la glace et,
surtout, une multitude d'écrans saturent le champ visuel et diffusent sans cesse de la publicité.
Depuis quelques années, lors d'un certain nombre d'arrêts de jeu, l'arbitre doit laisser s'écouler 90
secondes afin que l'on diffuse davantage de commerciaux à la télévision. Pendant ce temps, les
spectateurs sur place regardent d'autres publicités sur les écrans, accompagnées d'un volume
sonore aussi démesurément élevé qu'au cinéma. Évidemment, cette fragmentation du match
soumis aux exigences publicitaires affecte le spectacle sportif - si bien que les amateurs présents
dans l'amphithéâtre sont soumis à autant, sinon à plus d'agressions publicitaires que ceux qui
regardent le match à la télévision.
Montréal n'a pas échappé à ce délire. Le légendaire Forum fut abandonné pour construire le Centre
Molson, devenu par la suite le Centre Bell. Le nom des édifices
[début de la p. 14 du texte original]
devient lui-même un affichage publicitaire. On ne peut plus nommer un lieu pour désigner sa
particularité, reconnaître son histoire ou énoncer sa situation géographique... Finis les Forum de
Montréal, Colisée de Québec, Maple Leaf Gardens de Toronto, Pacific Coliseum de Vancouver, etc.
Place aux Centre Bell, Colisée Pepsi, Air Canada Center, General Motors Place... (voir: Les nouveaux
amphithéâtres de hockey: dispositif totalitaire de la publicité, au ).
L'intégration sociale de la publicité
La publicité cherche à s'intégrer à la vie sociale, à la culture et à être ainsi reconnue elle-même
comme une «production culturelle» - pensons aux festivals de publicité, aux discours sur notre
«industrie distincte» de la publicité, au Super Bowl où elle constitue en elle-même un événement
médiatique. On entend parfois dire que les publicités télévisées sont de «petits films»: une
aberration qui démontre que la publicité a réussi à se faire passer pour autre chose que ce qu'elle
est.
Un autre de ses déguisements est celui du «mécénat». La publicité fonde sa légitimité et, du même
coup, celle du pouvoir économique privé comme «acteur social», par l'entremise de la commandite.
Elle est ainsi parvenue à se rendre essentielle à une multitude d'événements sportifs et culturels, à
des fondations pour les enfants malades (McDonald's), voire à des départements universitaires. Par
exemple, on ne pourrait plus imaginer, à Montréal, la tenue des grands festivals de musique sans
que le centre-ville ne soit transformé en parc thématique de la compagnie Bell.
Si faire connaître un produit et le vendre est l'objectif commercial de la publicité, sa «fonction
sociale» est de voiler cette logique marchande, de maquiller l'intégration aux principes économiques
de toutes les sphères de la vie et de l'activité sociale. Car cette logique serait sans doute
insupportable si elle se présentait comme telle. C'est précisément en ce sens qu'il est possible
d'affirmer qu'elle est un médium idéologique et non strictement commercial.

On voit bien d'ailleurs que dans son contenu, la publicité informe très peu et que, dans sa forme, les
méthodes de persuasion ne sont pas l'élément dominant. Au lieu de mettre le produit à l'avant-plan,
elle s'habille plutôt des parures de l'émotion, du ludique, du divertissement, de la mise en scène
d'histoires, de personnages, de messages aux accents de vérités existentielles... Elle utilise un ton
empreint d'émotion ou encore des formules «philosophiques». La majorité des slogans
commerciaux des entreprises de services financiers sont de ce type: «La tranquillité
[début de la p. 15 du texte original]
d'esprit», «Avant l'argent il y a les gens» (Banque de Montréal), «Conjuguer avoirs et êtres»
(Desjardins)... Reprenant des figures populaires, jouant sur les codes du langage, sur l'humour, les
sentiments, des allusions érotiques, invitant à des jeux d'esprit et des histoires à suivre: on cherche
bien moins à convaincre qu'à créer de la collusion, de la relation, du consensus.
L'offre marchande se présente comme sollicitude. Elle s'adresse aux gens sous les auspices d'une
relation attentionnée et personnelle. Si elle est parfois criarde, la publicité nous parle le plus souvent
sur un ton attendri, compréhensif et bienveillant. Elle injecte ainsi de «l'humain» et du «relationnel»
dans le système. Les publicités de téléphones et autres moyens de communication ne nous vendent
pas tant l'appareil et le service, qu'elles nous rappellent l'importance d'être en contact avec nos
proches. Récemment, les cabines téléphoniques de Bell, au coin des rues, étaient ainsi devenues -
selon les panneaux publicitaires qu'on y avait apposés - des «aires de rapprochement»...
La reproduction idéologique
Lors d'un sondage qui indiquait une légère augmentation de la «méfiance» des gens envers la
publicité, le président de la firme CROP s'inquiétait: «On risque d'avoir une pub désincarnée, ayant
perdu ses références et sa pertinence dans la vie des gens [...]. Il faudrait pouvoir rejoindre les gens
dans leur singularité, leur humanité. La publicité doit essayer d'arrêter de convaincre, il lui faut
émouvoir» (Le Devoir, 19 janvier 2006). Ces propos expriment exactement le motif publicitaire. Si les
gens manifestent un esprit plus critique, les publicitaires ne feront qu'aller toujours plus loin dans
l'émotion, le «vécu» et la personnalisation, bref dans le maquillage humaniste d'une logique froide
et abstraite.
Du côté des grandes compagnies, on constate que leurs vastes et permanentes campagnes
publicitaires misent assez peu sur la promotion détaillée de produits précis. Il s'agit plutôt de la
construction d'un «imaginaire», du faire-valoir d'une raison sociale sur la place publique. Ces
campagnes publicitaires ne sont pas qu'un jeu symbolique dans la virtualité médiatique. La
reproduction plus ou moins consciente d'une idéologie dominante profite à la classe dominante des
cadres du monde financier et industriel, dont les salaires ne cessent d'accroître leur écart avec ceux
des classes moyennes et inférieures. Cette classe dominante a fait de la publicité une activité
majeure des grandes compagnies. C'est aussi par la publicité qu'elle répond aux critiques pouvant
s'élever à son endroit dans la société.
À l'heure des préoccupations sur la «malbouffe», un géant des aliments industriels comme McCain
s'engage dans une campagne de messages portant sur la saine alimentation. Dans la controverse
entourant Wal-Mart et sa lutte anti-syndicale, la multinationale annonçait son programme d'aide à
des fondations pour les enfants pauvres. En même temps que s'élargissait la discussion sur les
changements climatiques, lors de la signature du Protocole de Kyoto, la pétrolière Shell produisait
une série de commerciaux à saveur «environnementale» et Petro-Canada mettait des ours polaires
sur de grands panneaux à l'entrée de ses stations-service. On dénonce l'aliénation des jeunes filles
par les standards de beauté de l'industrie du divertissement, de la mode et des cosmétiques: dans
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%