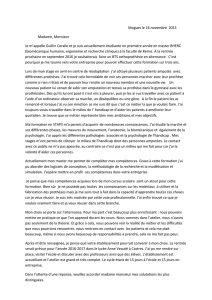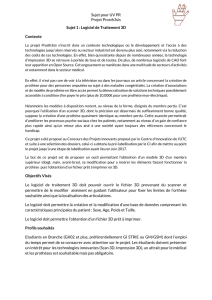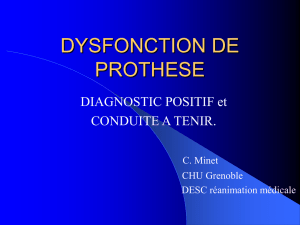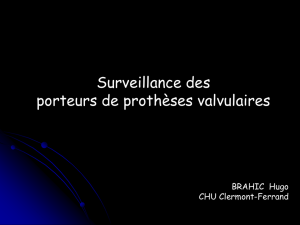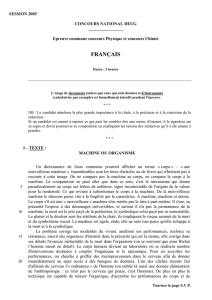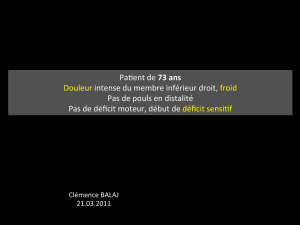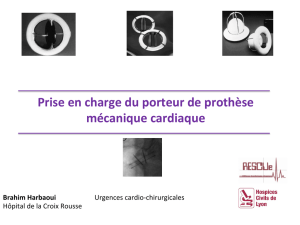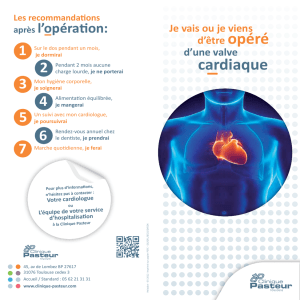Polycopi du Cours Echocardiographie Doppler

~ Échocardiographie - Doppler ~ 1
~ © 2010 DCAM ~ Université Victor Segalen Bordeaux 2 ~ France 1/8
É
Éc
ch
ho
oc
ca
ar
rd
di
io
og
gr
ra
ap
ph
hi
ie
e
-
-
D
Do
op
pp
pl
le
er
r
S
S.
.
L
La
af
fi
it
tt
te
e,
,
M
M.
.
L
La
af
fi
it
tt
te
e,
,
P
P.
.
R
Ré
éa
an
nt
t,
,
R
R.
.
R
Ro
ou
ud
da
au
ut
t
C.H.U. de Bordeaux ~ Hôpital Cardiologique du Haut Lévêque Pessac ~ France
Dysfonctionnement de Prothèse
I
In
nt
tr
ro
od
du
uc
ct
ti
io
on
n
Le risque de dysfonctionnement de prothèse fait partie intégrante de la vie d’un patient implanté qu’il
soit porteur d’une prothèse mécanique ou biologique.
La responsabilité du diagnostic de ces complications incombe quasi-exclusivement au cardiologue qui
se doit de les traquer systématiquement et à fréquence régulière.
Grace à sa rapidité de mise en œuvre et sa performance diagnostique, l’échocardiographie-Doppler
possède une place de choix dans cette recherche.
Les principales complications envisagées dans ce chapitre seront :
- les inadéquations prothèse/patient,
- les thromboses de valve,
- les désinsertions prothétiques,
- les dégénérescences de bioprothèses,
- et enfin, les hémolyses sur valve mécanique.
Les endocardites sur prothèses sont traitées dans le cours sur les endocardites bactériennes.
I
In
na
ad
dé
éq
qu
ua
at
ti
io
on
n
p
pr
ro
ot
th
hè
ès
se
e
/
/
p
pa
at
ti
ie
en
nt
t
L’inadéquation prothèse/patient (mismatch) (IPP) est définie par une disproportion entre la surface
valvulaire effective (SVE) et la surface corporelle du patient. Il en résulte un barrage fonctionnel à
l’écoulement sanguin trans-prothétique.
Trois stades de gravité d’IPP sont décrits :
- une IPP est dite légère quand l’AVE indexée est comprise entre 0,85 et 1,0 cm²/m²
- l’IPP est modérée pour des valeurs d’AVE comprises entre 0,65 et 0,85 cm²/m²
- enfin, elle est sévère en-dessous de 0,65 cm²/m²
Sur un plan épidémiologique, il s’agit d’une complication fréquente dont la prévalence varie de 20 à
70% selon les études pour une IPP modérée et de 1 à 10% si elle est sévère.
A l’opposé de l’IPP légère sans conséquence clinique, à un stade plus évolué, l’IPP est directement
liée à une mauvaise tolérance symptomatique et une plus haute incidence d’événements cardiaques,
aussi bien en péri-opératoire immédiat que sur le long terme.
L’inadéquation prothèse/patient est identifiée par échocardiographie avec la mise en évidence d’une
surface valvulaire effective diminuée en-dessous de 1 cm².
Le calcul de la surface valvulaire fonctionnelle doit faire appel à l'équation de continuité :
Sao = S ch ch x ITV ch ch / ITV Ao
Le positionnement de l'échantillon Doppler dans la chambre de chasse doit se faire 1 cm au-dessous
de la prothèse sous peine d'être dans une zone d'accélération du flux en amont de la prothèse.
L’indexation à la surface corporelle est dès lors obtenue à partir des données de poids et de taille du
patient.
Il est à savoir que parmi l’ensemble des facteurs de risque de mortalité post-opératoire, l’IPP est un
des rares qui puisse être évité. Ceci est réalisé par le calcul pré-opératoire de la surface valvulaire

~ Échocardiographie - Doppler ~ 2
~ © 2010 DCAM ~ Université Victor Segalen Bordeaux 2 ~ France 2/8
effective minimale (SVE indexée X SC) pour le patient comparé à la valeur de référence de la SVE
pour le modèle et la taille de la prothèse sélectionnée.
T
Th
hr
ro
om
mb
bo
os
se
e
d
de
e
v
va
al
lv
ve
e
G
Gé
én
né
ér
ra
al
li
it
té
és
s
Les thromboses de valve demeurent une des complications les plus graves de la chirurgie de
remplacement valvulaire par leur risque de défaillance cardiaque et d’embolie systémique.
Leur diagnostic doit être précoce, approché par l’ETT/ETO et le radiocinéma de valve qui permettent
un diagnostic positif et surtout d’orienter la thérapeutique (héparine, fibrinolyse ou chirurgie) en
fonction des constatations anatomiques effectuées : thrombose obstructive ou non, taille du thrombus,
blocage partiel ou complet, et de l’état hémodynamique sous-jacent.
Les thromboses des prothèses mécaniques sont loin d’être exceptionnelles, principalement lors des
premières années post-implantation, de l’ordre de 0,3 à 1,3 pour 100 années / patient pour les
prothèses mécaniques et 0,09 à 0,15 pour les bioprothèses. Elles sont plus fréquentes en position
tricuspide (20% année-patient) qu’en position aorto-mitrale (0,5 à 6% année-patient). Les thromboses
obstructives sont généralement accompagnées d’un fort taux de mortalité (2/3 des cas classiquement).
A côté de la thrombose, deux autres situations peuvent générer une obstruction de prothèses : le
pannus fibreux et l’endocardite avec végétation obstructive.
Sur un plan physiopathologique, on distingue les thromboses aiguës constituées de thrombus frais
généralement conséquence d’un arrêt impromptu du traitement anti-coagulant.
A l’opposé, il existe des thromboses de constitution sub-aiguë voir chronique par strates successives
de caillots plus ou moins organisés.
Les facteurs favorisants sont une mauvaise anticoagulation, la période post-opératoire précoce, les
relais pour chirurgie extra-cardiaque.
L’expression clinique de la thrombose obstructive est généralement bruyante quand elle est complète
avec œdème aigu pulmonaire et anomalies auscultatoires patentes, plus modérée si la thrombose est
partielle avec possible dyspnée, fièvre ou encore embolies systémiques.
La thrombose non obstructive peut être de découverte fortuite ou à l’occasion d’une embolie
systémique.
Au moindre doute, il faudra réaliser devant ces symptômes au moins en 1ère intention une
échocardiographie transthoracique et un radiocinéma de valve et si nécessaire en 2ème intention une
ETO.
É
Éc
ch
ho
og
gr
ra
ap
ph
hi
ie
e
t
tr
ra
an
ns
st
th
ho
or
ra
ac
ci
iq
qu
ue
e
L’échocardiographie bidimensionnelle permet l’analyse directe des éléments mobiles des prothèses
valvulaires, en sachant que les valves de nouvelles générations à double ailette sont de faible
encombrement et que les clapets sont difficiles à dégager de part leur petite taille.
Les valves à bille sont mieux visualisées que les valves à disque, elles-mêmes mieux visualisées que
les valves à ailettes.
Le diagnostic positif de thrombose est donné par la visualisation du thrombus, conditionnée par sa
taille, sa mobilité et sa localisation. Le thrombus apparaît alors comme un écho anormal généralement
bien circonscrit sessile ou pédiculé au contact de la prothèse. Il faudra en préciser la taille, la mobilité
et le caractère localisé ou diffus.
Il est primordial de varier les incidences employées afin de contourner les cônes d’ombre lié au
matériel prothétique.
Le mode TM de part sa haute résolution temporelle est indispensable à réaliser sur tout matériel
prothétique, permettant parfois, si le thrombus est mobile, de voir des vibrations de basse fréquence le

~ Échocardiographie - Doppler ~ 3
plus souvent, différentes et décalées de celles des éléments mobiles.
Cependant, en raison de la difficulté de visualisation du thrombus en ETT, ce sont les signes indirects
de thrombose au niveau de la valve qui seront recherchés :
Pour une prothèse à bille, il s’agira de la disparition des ressauts d’ouverture.
Concernant les prothèses à disque, on observera un arrondi de l’angle d’ouverture qui paraît retardé,
en 2 temps, avec une diminution de la vitesse d’ouverture.
Enfin, pour les prothèses à ailettes, le défaut d’ouverture des ailettes et l’élargissement de l’écart inter-
ailettes seront suspects.
Les principales limites de l’ETT sont d’une part les faux négatifs générés par les mauvaises fenêtres
ultrasonores, les réverbérations multiples, les cônes d’ombre et les thromboses non obstructives ;
d’autre part, les faux positifs, avec les végétations comme principal diagnostic différentiel.
Le mode Doppler permet l’analyse hémodynamique de l’obstruction par le biais de ses différentes
modalités.
Doppler Couleur
En Doppler Couleur, le flux antérograde peut présenter une déviation par blocage de l’élément mobile
unique, ou une asymétrie de flux si blocage d’un des 2 éléments d’une valve à double ailette, surtout
visible pour la position mitrale.
L’analyse du flux rétrograde identifie la présence de fuites centro ou intra-prothétiques par fermeture
incomplète de l’élément mobile, mais généralement difficiles à visualiser au niveau mitral et plus facile
en position aortique (cône d’ombre).
Doppler continu
Le Doppler continu permet d’obtenir des paramètres quantitatifs, qu’il est nécessaire de comparer à
l’examen de référence post-opératoire réalisé avec une situation hémodynamique stabilisée (en
général à 1 mois).
Une thrombose mitrale est suspectée devant :
- un gradient moyen > 8 mmHg en l’absence de fuite significative,
- une surface valvulaire effective < 1,5 cm².
Une thrombose aortique est suspectée devant :
- un gradient moyen > 45 mmHg,
- une surface valvulaire effective < 1 cm²,
- un indice de perméabilité < 0,25.
Comme pour toute valvulopathie, la notion de gradient isolé est insuffisante ; il faut tenir compte du
débit et de la surface effective de la prothèse.
De plus, un retentissement droit avec HTAP d’apparition ou d’aggravation récente plaide en faveur du
diagnostic.
Les données précédemment enregistrées sont toujours à intégrer en fonction de la taille du VG et de
ses fonctions systolique et diastolique, et à interpréter en fonction de la présence éventuelle d’autre
valvulopathie, d’une HVG.
Il sera également important de noter l’existence d’un épanchement péricardique, d’une péricardite
constrictive ou d’une myocardiopathie restrictive.
On retiendra comme principaux faux négatifs :
- les mauvaises fenêtres US
- les cônes d’ombre prothétiques
- les thromboses peu ou pas obstructives
- les pannus fibreux
- les gradients faibles mais sur bas débit.
~ © 2010 DCAM ~ Université Victor Segalen Bordeaux 2 ~ France 3/8

~ Échocardiographie - Doppler ~ 4
~ © 2010 DCAM ~ Université Victor Segalen Bordeaux 2 ~ France 4/8
Les faux positifs se résument aux cas d’hyperdébit (hyperthyroïdie et anémie) et aux prothèses
aortiques de petit calibre comme la N°19, qui par son diamètre peut donner des gradients moyens
voisins de 45 mmHg ‘physiologiques’.
É
Éc
ch
ho
og
gr
ra
ap
ph
hi
ie
e
t
tr
ra
an
ns
s-
-o
oe
es
so
op
ph
ha
ag
gi
ie
en
nn
ne
e
Le rôle de l’échographie trans-oesophagienne est primordial dans le diagnostic de thrombose de
prothèse. En particulier, l’effet de masque des prothèses mitrales observé en ETT est alors projeté en
regard du VG dégageant ainsi la face atriale de la prothèse.
Dans un premier temps, l’ETO est d’un apport indéniable pour la visualisation des éléments
prothétiques mobiles, leur excursion, ou leur angle d’ouverture ou de fermeture.
Le mode multiplan explore au mieux les «doubles ailettes» permettant d’affiner la description du
blocage en visualisant le plan d’ouverture des deux ailettes.
Les principaux critères d’obstruction sont les anomalies de jeu des clapets (immobilité, jeu diminué),
les thrombus prothétiques, les fuites centroprothétiques, et la disparition des fuites de lavage et les
échos de stases, mais non spécifiques.
L’ETO permet d’appréhender parfaitement les différents éléments pouvant être à l’origine d’une
obstruction comme les thrombus et pannus fibreux ou autres éléments anormaux de diagnostic
différentiel.
Thrombus
Le thrombus est défini comme un écho anormal de plus de 1 mm persistant malgré la variation des
gains et des incidences avec des bords bien définis de densité plus ou moins différente des structures
cardiaques adjacentes.
Il peut être observé sur la face auriculaire mitrale et tricuspide des anneaux des prothèses et de leur
axe central, mais peut se voir également sur les anneaux prothétiques isolés de type Carpentier.
L’incidence transgastrique permet l’exploration de la face ventriculaire des prothèses mitrales et des
prothèses aortiques, même si cette incidence est de réalisation plus délicate.
La recherche de thrombus s’effectue au niveau de la prothèse mais également au niveau de l’oreillette
et de l’auricule gauches ; la présence de contraste spontané est considérée de nos jours comme un
marqueur de risque thromboembolique chez les patients porteurs de prothèse.
L’ETO permet de rapporter la localisation du thrombus avec le maximum d’exactitude, et de distinguer
les thrombi plans, difficilement visibles en ETT, des thrombi sessiles, d’en notifier le nombre et d’en
mesurer la taille (grand axe et planimétrie) et la mobilité ; elle peut parfois permettre de distinguer un
thrombus frais homogène et d’échogénicité proche du tissu avoisinant, d’une thrombus ancien de
densité acoustique hétérogène et plus soutenue ; elle permet enfin d’en suivre l’évolution sous
traitement.
Plus la masse thrombotique est importante avec un caractère pédiculé et mobile, plus grand est le
risque embolique spontané ou lors de la fibrinolyse (>0,8 cm²).
Enfin, la thrombose peut être non obstructive avec la mise en évidence d’un thrombus sessile ou
pédiculé n’entravant pas le jeu des ailettes.
Ce dernier est généralement situé sur l’anneau ou les pivots avec une prédilection pour la face
auriculaire des prothèses mitrales et la face ventriculaire des prothèses aortiques.
L’ETO permet alors de préciser la taille, la localisation précise et le degré de mobilité du thrombus.
Ce thrombus devra être distingué d‘autres masses paraprothétiques :
- végétation endocarditique obstructive
- pannus fibreux
- strands

~ Échocardiographie - Doppler ~ 5
~ © 2010 DCAM ~ Université Victor Segalen Bordeaux 2 ~ France 5/8
Pannus fibreux
Le pannus fibreux est défini comme un processus évolutif de fibrose qui se développe habituellement
de part et d’autre de l’anneau et parfois au niveau des picots.
Ce pannus tend à s’étendre de façon circonférentielle. Il évolue généralement lentement et peut
tapisser l’endocarde avoisinant.
Le pannus modifie plus ou moins précocement le profil hémodynamique de manière progressive avec
sténose mais sans thrombose directe ; il peut cependant faire le lit d’une éventuelle thrombose.
Strands et échos brillants
Les strands sont des échos fins, linéaires et très mobiles, de 1 mm d’épaisseur et d’une longueur
variable de 3 à 15 mm, appendus au matériel prothétique (anneau et très souvent axe central) et
présents pendant tout le cycle cardiaque.
Ces filaments de fibrine sont souvent vus dès le post-opératoire précoce même avec une
anticoagulation paraissant de bonne qualité.
Ils semblent être un marqueur fiable de thrombose plus qu’une cause directe d’embolie.
Les échos brillants sont très fréquemment rencontrés à proximité des prothèses mitrales mais leur
physiopathologie (microcavitation) et leur signification pronostique restent obscures.
A l’heure actuelle, ils ne sont pas considérés comme franchement pathologiques.
Modes Doppler
Le mode Doppler Couleur permet de façon plus fine qu’en ETT de recenser :
- les modifications des fuites physiologiques avec éventuelle disparition,
- l’apparition d’une fuite pathologique centro-prothétique signant la fermeture incomplète de l’élément
mobile
- la modification du flux de convergence pour les doubles ailettes.
Le Doppler continu permet de confirmer les gradients transvalvulaires retrouvés en ETT. Il autorise de
les calculer quand l’ETT est défaillante.
Si le calcul des gradients ne pose pas de problème au niveau mitral et tricuspide, il n’en est pas de
même pour la valve aortique qu’il faudra appréhender à partir de l’incidence transgastrique.
T
Th
hr
ro
om
mb
bo
os
se
e
d
de
e
v
va
al
lv
ve
e
:
:
T
Tr
ra
ai
it
te
em
me
en
nt
t
L’ensemble des éléments retrouvés en ETT et ETO dans ce contexte de thrombose de prothèse est
indispensable pour guider la prise en charge thérapeutique.
Classiquement les recommandations de l’ACC / AHA prônent une prise en charge chirurgicale pour les
thromboses obstructives des prothèses valvulaires.
Cependant, devant une hémodynamique critique, la fibrinolyse de ‘sauvetage’ peut être envisagée si la
durée de prise en charge chirurgicale est incompatible avec la survie du patient.
Une thrombose obstructive de valve du cœur droit relève avant tout de la fibrinolyse car le risque d’une
embolisation est moins grave qu’au niveau du cœur gauche.
Dans les autres situations, l’ETT, le radiocinéma et l’ETO font envisager 4 situations :
1) Un pannus est retrouvé avec ou sans thrombus sur une prothèse obstructive : la chirurgie est
incontournable.
2) Un thrombus de taille importante est associé au blocage d’une ailette : ici aussi, c’est la chirurgie
qui est de mise.
3) Un thrombus de petite taille est observé avec un blocage d’ailette : la fibrinolyse peut être discutée
sauf contre-indications, à fortiori si l’épisode est de constitution récente.
4) Enfin, il n’est pas visualisé de thrombus mais un blocage isolé d’une ailette : la fibrinolyse peut être
discutée également sauf contre-indications.
Enfin, face à une thrombose non obstructive, la règle est d’essayer d’obtenir la lyse du thrombus sous
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%