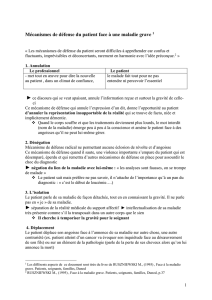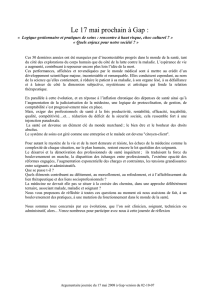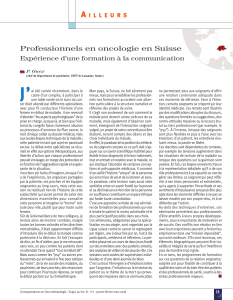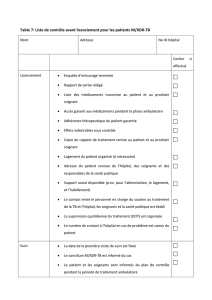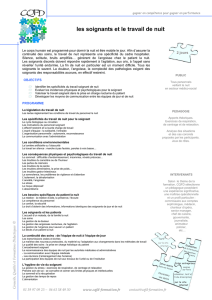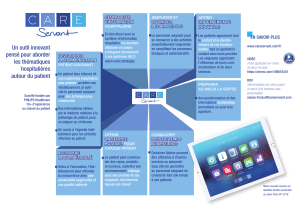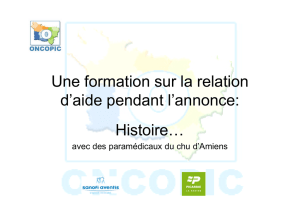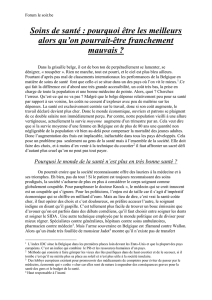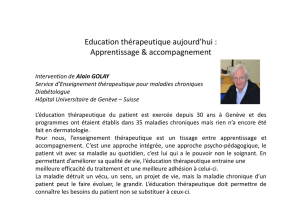Voir la restitution

« Soins palliatifs et différences culturelles »
Formation animée par
Madame Dozoul, psycho-ethnologue
La formation a eu lieu le 19 novembre 2008. Une quarantaine de professionnels
était présent.
La formation s’est déroulée en trois temps :
- une première partie de présentation sur :
o la relation soignant/soigné comme relation culturelle
o l’hôpital comme espace transitionnel
- un temps d’échanges et de questionnements relatifs à la première partie
- une troisième partie sur les différences culturelles, mise en place sous la
forme d’échanges entre les professionnels présents et Madame Dozoul.
Ci-après, le texte intégral de la première partie présentée par Madame Dozoul.
« Bonsoir
Suite à la demande du Docteur Clémentine Vaquin, rencontrée au congrès
national des soins palliatifs de Nantes en juin dernier, j’ai tenté de rassembler
un certain nombre de points de réflexion et d’attention concernant la conception
anthropologique des soins et de la mort dans notre culture et dans d’autres
cultures présentes sur le territoire hospitalier. Une façon de faire entrer la
dinde dans le marron dans le temps qui nous est imparti.
Je déclinerai cette réflexion en 3 temps :
Un premier temps portera sur la relation soignant/soigné comme relation
interculturelle.
Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à analyser l’hôpital comme
espace transitionnel.
Nous donnerons dans un troisième temps quelques points de repérage des
cultures juive et musulmane dans leur rapport au mourir.

I – LA RELATION SOIGNANT/SOIGNE COMME RELATION INTER-
CULTURELLE
Je tiens à rappeler d’emblée que la relation soignant/soigné est tout autant une
relation inter subjective qu’une relation inter-culturelle, autrement dit une
confrontation (front contre front, intelligence contre intelligence) de 2 cultures
en présence, sachant que chacun de nous n’est pas une duplication de sa propre
culture, mais participe d’emprunts, de bricolages singuliers qui font de cet
échange, une rencontre de 2 uniques, réclamant une acculturation réciproque.
« Le visage de l’autre est un impératif éthique » nous rappelle E. LEVINAS.
En effet, soigner est une démarche anthropologique tout autant qu’une épreuve
émotionnelle qui pose la question du rapport à l’autre, à la différence, à la
confrontation interculturelle de représentations, valeurs, codes, savoirs faire et
être, jusqu’à déconcerter parfois le soignant et lui imposer un questionnement
sur ses filtres et écrans culturels actifs dans la rencontre, lesquels vont
orienter familièrement ses procédures de soins et sont chargés d’affects
inconscients à savoir :
a) Les projections de valeurs : l’ethnocentrisme (tout ramener au centre de
sa culture)
b) Les projections de techniques : le techno centrisme
Qui sont autant de points aveugles, de sources de malentendus dans la relation
soignant/soigné.
a) L’ethnocentrisme :
Le système de défense qui consiste à juger à partir de son étalon culturel va
entraîner chez le soignant des projections et comparaisons qui risquent d’altérer
la relation et d’obérer l’écoute en réduisant l’autre à sa différence et en
l’entraînant dans une surenchère fonctionnelle, des formes de résistance aussi,
des ruptures de communication laissant au corps la mission de se plaindre.
Nous savons en effet que lorsque la communication est rompue, les plaintes
évoluent vers des spirales algiques, rebelles à tout traitement analgésique quand
le corps devient le seul territoire d’échange entre les deux parties, quand les
mots viennent à manquer.

Corps haut parleur, exposé au soignant, le seul langage qu’il est censé
comprendre quand il n’est pas tenté d’interpréter les plaintes de « syndrome
méditerranéen » alors même que cette surenchère fonctionnelle exprime
fréquemment une dépression masquée.
Qui plus est, selon le coran ; pour les patients musulmans.
« Dieu permet de mentir aux méchants »
(entendre, ceux qui ont le pouvoir)
Par ailleurs, certaines expressions de soignants révèlent leur désarroi ou leur
agacement devant certaines situations jugées peu conformes. L’usage de
l’adverbe « trop » en est une illustration. Nous reconnaissons à partir de ces
expressions les populations d’Afrique du Nord ou de l’Ouest.
Ils se plaignent trop !
Ils ont trop de visites !
Ils sont trop nombreux !
Ils mettent trop d’eau par terre
Les modèles et cadres de référence sont mis à l’épreuve. Le soignant ne s’y
retrouve pas puisqu’il ne peut ramener l’autre à son étalon. Il est à proprement
parler déconcerté. Le risque sera du côté du déni ou du repli technique. (une
fuite dans la boite à outils ou les protocoles).
b) Le techno centrisme
Les modèles médicaux savants scientifiques et techniques vont aussi faire écran
dans la rencontre avec patients et familles. Nos expertises médicales se sont
développées sur un certain nombre de convictions qui risquent de rendre sourd le
corps médical à d’autres savoirs relatifs au corps et à la maladie, auxquels auront
recours nombre de patients faisant appel aux médecines parallèles ou tradi-
praticiennes. Une façon de retrouver ses marques, mais aussi du sens, une forme
de confort.
• Nous pensons aux Africains atteints du sida qui n’acceptent de prendre leur
traitement que s’ils les conçoivent comme des rituels apaisant les esprits.
Le virus est pensé comme 1 esprit que l’on ne doit pas réveiller, sinon « il
risquerait de se venger ».
« Il risque de devenir méchant, si je le chasse »

Il faut donc des offrandes et des rituels aux esprits matin et soir pour les
apprivoiser, les apaiser, les laisser tranquilles dans un coin. Les traitements
deviennent donc «
des rituels sur ordonnance
» sorte de coexistence
pacifique de deux conceptions du soin, qui aboutit à la théorie des deux
gagnants, lorsque la médecine accepte le « sens » donné par le patient.
Selon C.L. STRAUSS : « On ne mange bien que ce que l’on pense bien »
La thérapie est donc avalable ! (Vous pouvez donc me faire avaler ça !)
Les procédures médicales ne sont pas des rites
Elles codifient des pratiques et relèvent du visible et l’énonçable, obligeant la
coupure : entre corps et âme
Entre visible et invisible
Entre vie et mort
Ne donnant pas de sens à l’existence, se saisissant plutôt du corps-objet, corps-
signe.
Les rites ont justement cette fonction expressive et symbolique qui favorisent
un sentiment d’appartenance dans un moment de haute turbulence qu’est la
maladie ou la fin de vie, en articulant : parole et corps/ passé et présent visible
et invisible.
C’est au corps-sujet, porteur d’identité narrative que s’adresse le rite qui va
pouvoir de ce fait, faire office de contenant symbolique.
• Rappelons par ailleurs certaines particularités propres à la médecine taoïste
dont les ressortissants asiatiques auront des difficultés à accepter une
riposte thérapeutique à base de spoliation, de retrait, de soustraction, à
savoir : l’acte chirurgical ou tout simplement des prises de sang.
Le fond structural de ces médecines étant basé sur l’ajout, l’addition, la
circulation des énergies à base de poncture dans les méridiens. Ne rien ôter,
mais plutôt ressusciter des marées énergétiques, ajouter des vitamines, de la
chaleur par la moxibustion, restaurer l’équilibre.
Les patients font en effet fréquemment appel à cette médecine des énergies
comme pratique adjuvante et apaisante au niveau de leur identité
particulièrement en situation migratoire.
• Les patients africains et maghrébins font eux-mêmes fréquemment recours
aux talebs ou marabouts pour déposer leurs souffrances.

Ce panseur de secrets et de douleurs écrira avec un calame et de l’encre de
sèche buvable, des versets du Coran sur une planchette sur laquelle il versera
de l’eau lustrale. Cette dilution sera récupérée dans une cuvette et
transvasée dans une bouteille avec laquelle le patient repartira pour
s’imprégner de cette eau sacrée ou comme boisson au moment des ablutions
et des prières au cours de la journée pendant une période prescrite.
Ces remèdes magico-religieux à base d’écriture coranique représentent une
forme de loyauté religieuse dans cette épreuve de la maladie qui réveille les
questions relatives au sens et à des paroles qui excèdent le sujet et sur
lesquelles il peut se reposer ou en tout cas se réunifier.
La possibilité de pouvoir s’en exprimer aux soignants sans avoir le sentiment
de leur être déloyal, évite le clivage et délivre le patient de la ruse, du silence
ou d’une position de double lien paradoxal, en l’autorisant du même coup à
exprimer son angoisse et sa quête de sens. Ce qui paradoxalement entraîne le
plus souvent une reconnaissance plus apaisée des soins médicaux.
• Nos modèles médicaux se basent aussi sur une conception individualiste de la
personne privilégiant l’individu sur la communauté.
Face au patient immigré se définissant comme membre d’un groupe, comme
« frère », il faut entendre par là, « frère statutaire », « frère lignagé »
attaché à un même ancêtre tutélaire, il ne sera pas rare qu’un des membres
du groupe réponde à la place du patient mettant parfois dans la gêne ou
l’agacement le soignant. Les rituels thérapeutiques en appellent aussi à un
questionnement et une riposte communautaire que traduisent les proverbes
Wolof du Sénégal :
« Tout homme est gardien de son frère »
« L’homme est le meilleur remède de l’homme »
Les visites en nombre sont une nécessaire réponse à l’isolement du patient à
l’hôpital. De même amener le repas dans la chambre et manger dans le même
plat est une autre manière de le réconforter, de rehausser son moral et de
les réintéger dans le groupe.
En effet, dans le modèle communautaire, le sentiment du NOUS prévaut sur
le MOI.
« Je suis parce que « nous » sommes » (fils-frère-oncle-neveux …)
L’individu est plutôt maillon d’une lignée, d’une ancestralité commune, et
pourra tomber malade au nom d’ancêtres persécuteurs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%