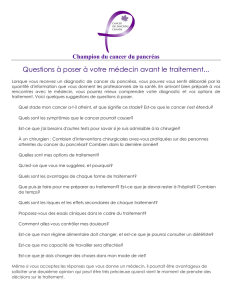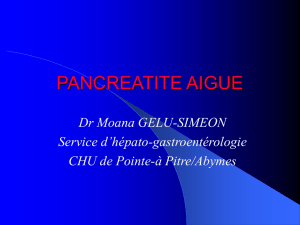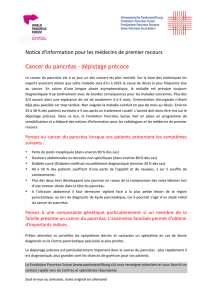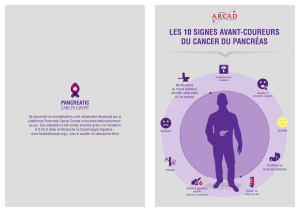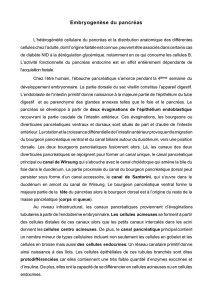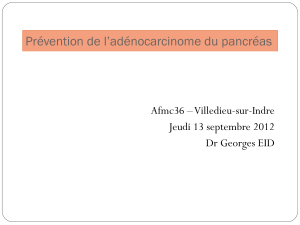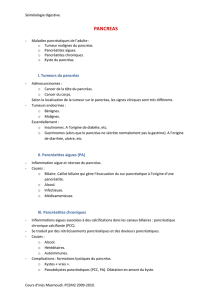Dernière parution du bulletin Pancréascopie

EDITORIAL
Voici donc le dernier numéro de
pancréascopie. A l’heure où le ministère
de la santé (pôle de gestion de soin)
et le ministère de l’enseignement
supérieur (cas cliniques transversaux
du nouvel internat qualifiant) prônent
la transversalité, la parution d’une
brochure monothématique sur le
pancréas pourrait sembler un défi
politique. En réalité, ce numéro
comporte de nombreuses lignes de
transversalité au sein de la pancréato-
logie : le parenchyme endocrine et exo-
crine, la prise en charge médicale et
chirurgicale avec les conséquences
fonctionnelles de la chirurgie
pancréatique, une revue de la littéra-
ture qui porte l’accent sur les aspects
endoscopiques et anatomopatholo-
giques, les principales communications
des journées francophones. On notera
l’investissement important de notre
ancien président du Club Français du
Pancréas, le Pr Alain Sauvanet, dans la
rédaction de ce numéro. Tout le bureau
actuel s’associe à moi pour le remercier
de l’énergie et de l’efficacité qu’il a
amené au sein de cette association
sans oublier la contagiosité de ses
éclats de rire. La maturité de ce club et
son activité scientifique va se traduire
par l’organisation d’un symposium sur
les TIPMP au cours des journées
Francophones de pathologie digestive
2005. Prenez-donc date pour ce rendez-
vous important mais aussi pour la
rencontre annuelle du Club Français du
Pancréas qui aura lieu à Monaco les
6-7 octobre 2005 grâce au travail de
Patrick Hastier et de tout le bureau du
Club Français du Pancréas...
Pr Marc Barthet
INTERVIEW
IMAGE COMMENTÉE 5
Pancréatite chronique et tumeur endocrine
(DRP. HASTIER)
MISE AU POINT
Peut-on réaliser des pancréatectomies
« atypiques »?
(DRR. KIANMANESH)
REVUE DE PRESSE 15
(DRH. BÉCHEUR)
CONGRÈS 11
Journées Francophones de Pathologie Digestive
(Paris, 3-7 avril 2004)
(DRH. BÉCHEUR)
Conséquences fonctionnelles de la chirurgie
pancréatique
(PRA. SAUVANET)2
6
SOLVAY DIGEST
DÉCEMBRE 2004 N°30
R
ÉDACTEUR EN CHEF
:
Pr Philippe Lévy, Hôpital Beaujon (Clichy)
C
OMITÉDE LECTURE
:
Pr Marc Barthet, Hôpital Nord (Marseille)
Pr Louis Buscail, CHU Rangueil (Toulouse)
Dr Patrick Hastier, CH Princesse Grace (Monaco)
Dr Marc Zins, Fondation Hôpital St Joseph (Paris)

-2-
Interview
CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES DE LA
CHIRURGIE PANCRÉATIQUE
Le Pr Alain
Sauvanet (Service
de chirurgie,
Hôpital Beaujon,
Clichy) fait le
point sur les
conséquences
endocrines et
exocrines de la
chirurgie
pancréatique, qu’il
s’agisse des
exérèses sur
pancréas sain ou
pour pancréatite
chronique, ou de la
chirurgie pour
pancréatite aiguë.
PANCRÉASCOPIE : LES INTERVENTIONS DE RÉSECTION
PANCRÉATIQUE SUR PANCRÉAS RESTANT SAIN S’ACCOMPAGNENT-
ELLES D’UN RISQUE DE DIABÈTE POST-OPÉRATOIRE ?
PRA. SAUVANET :Il existe deux principales
exérèses pancréatiques sur pancréas sain : la
duodénopancréatectomie céphalique et la
pancréatectomie gauche.
La duodénopancréatectomie céphalique s’as-
socie à un faible risque de diabète si on ne tient
compte que des patients ayant une fonction
endocrine normale avant l’intervention. Quatre
études chiffrent ce risque entre 0 et 7 %.
Il est d’usage d’annoncer au patient avant
l’intervention, en particulier si la duodéno-
pancréatectomie est réalisée pour une lésion
bénigne, un risque de 5 % en sachant que le
diabète peut survenir rapidement, dans les
quelques mois qui suivent l’intervention, mais
également à distance de l’intervention
(quelques années après celle-ci).
Le risque de diabète à distance de l’intervention
augmente lorsqu’on ne fait pas d’anastomose
pancréatico-digestive. En effet si, pour des
raisons essentiellement techniques, on ne fait
pas d’anastomose pancréatico-digestive, cela
entraîne plus fréquemment une atrophie
progressive du moignon pancréatique qui se
traduit par une augmentation du risque de
diabète à distance.
Ceci a été montré par une étude randomisée
(n = 160) qui avait pour objectif d’évaluer si,
après duodénopancréatectomie pour cancer, il
fallait faire une anastomose pancréatico-
jéjunale ou fermer le moignon pancréatique. Les
critères principaux d’évaluation étaient des
critères de morbidité péri-opératoire précoce.
Cette étude a analysé la survie des malades un
an après l’intervention. Parmi les 100 malades
vivants, 14 % étaient diabétiques dans le
groupe anastomose contre 34 % dans le groupe
sans anastomose. Cette étude a des limites
puisqu’il n’existe pas d’analyse par sous-groupe
(diabète préopératoire ou non).
En ce qui concerne la pancréatectomie gauche,
le risque de diabète est de l’ordre de 10 %,
même si cette intervention est faite sur
pancréas sain (pour lésion bénigne, pour
traumatisme ou encore pour dons d’organe
intrafamiliaux). Dans une étude chez 14
donneurs d’organe ayant un bilan pré-opératoire
de la fonction endocrine normal, 3 malades
ont développé des anomalies de la glycémie
(hyperglycémie, hémoglobine glycosylée
anormale, voire diabète nécessitant un
traitement).
Avec cette intervention, le risque de diabète
peut apparaitre dans les mois qui suivent
l’intervention, mais également de façon tardive.
PANCRÉASCOPIE : QU’EN EST-IL AU COURS DE LA
PANCRÉATITE CHRONIQUE ?
PRA. SAUVANET :On se pose les mêmes questions
au cours des interventions sur PC que sur
pancréas sain, et en particulier pour une
pancréatectomie gauche.
La pancréatectomie gauche accroît la dégra-
dation de la fonction endocrine au cours de la
PC. On sait que dans la PC, chez les patients non
opérés, environ 50 % des patients deviennent
Quand on programme une pancréatectomie
gauche chez un patient, même avec une
fonction endocrine normale, il est
nécessaire d’être un peu plus précis en ce
qui concerne l’information sur le diabète en
tenant compte de ce risque dans
l’indication et de se poser la question d’un
geste entraînant un plus faible risque de
diabète. Par exemple, dans certaines
tumeurs kystiques, une énucléation ou une
pancréatectomie plus limitée comme une
pancréatectomie médiane ont un risque
moindre voire nul de diabète post-
opératoire (1 à 2 % après pancréatectomie
médiane).

intervieW
-3-
diabétiques après 10 ans d’évolution de la maladie.
Si on fait une pancréatectomie gauche, ce risque
s’élève à 70-80 %. C’est un argument fort pour éviter
dans la mesure du possible la réalisation d’une
pancréatectomie gauche. Si elle est nécessaire, il
faut qu’elle soit la moins étendue possible. En effet,
un des facteurs qui conditionne le développement
d’un diabète après pancréatectomie gauche est
l’étendue de cette pancréatectomie : par exemple le
risque est plus faible après pancréatectomie caudale
qu’après pancréatectomie gauche avec section du
pancréas devant la veine porte (pancréatectomie
corporéo-caudale).
Pour ce qui est de la duodénopancréatectomie cépha-
lique, cette intervention ne semble pas majorer le
risque de diabète lié à l’évolution de la maladie. Cela
s’explique par le fait que les îlots de Langerhans sont
préférentiellement localisés dans le corps et la queue
du pancréas plutôt que dans la tête. Par exemple,
dans certaines séries de duodénopancréatectomie
céphalique pour tumeur, la conservation d’un court
moignon caudal (environ 5 cm) a permis, chez
plusieurs malades, de conserver pendant plusieurs
années une glycémie normale.
Il faut essayer de retarder au maximum ce risque de
diabète et assurer une surveillance bisannuelle.
PANCRÉASCOPIE : LADÉRIVATION WIRSUNGO-JÉJUNALE PROTÈGE-
T-ELLE DU RISQUE DE DIABÈTE INDUIT PAR LA PC ?
PRA SAUVANET :Un des débats actuels en chirurgie de
la pancréatite chronique est le suivant : selon deux
études, la décompression du canal de Wirsung
exercerait un effet bénéfique sur la détérioration de
la fonction endocrine dans la PC. Cependant, leur
niveau de preuve n’est pas excellent. La première,
randomisée, date d’il y a une dizaine d’année et a été
réalisée sur un très faible nombre de malades dans
chaque bras. Elle montrait que le diabète apparais-
sait un peu plus tard après dérivation qu’en l’absence
de dérivation. Cependant cette étude n’a pas fait
l’objet d’un suivi à plus long terme pour déterminer
le devenir à distance des patients.
Le second travail, réalisé à Beaujon en 2000, montre
que les malades ayant eu une dérivation du canal de
Wirsung avaient pendant quelques années un risque
de diabète plus faible que les patients non opérés,
mais après 10 ans de recul, le risque de diabète rede-
venait le même. Cela suggère que cette méthode ne
permet au mieux que de reculer l’apparition du dia-
bète. Un troisième travail (2004), rétrospectif et por-
tant encore sur de faibles effectifs, a également révélé
un plus faible risque de diabète après dérivation
qu’en l’absence d’intervention.
PANCRÉASCOPIE : IL EST CLASSIQUE DE DIRE QUE LA PANCRÉA-
TITE AIGUËSE TRADUIT PAR UNE RESTITUTION AD INTEGRUM DES
FONCTIONS PANCRÉATIQUES, QU'EN EST IL APRÈSNÉCROSECTOMIE
PLUS OU MOINS ÉTENDUE ?
PRA. SAUVANET : Ce n’est pas le cas après chirurgie pour
pancréatite nécrosante. Le diabète apparaît comme
pour la pancréatectomie pour PC, soit précocement,
soit à distance de la survenue de la pancréatite aiguë.
De plus, ce diabète, lorsqu’il survient, est définitif.
Ce n’est donc pas un problème de dysfonctionnement
transitoire lié à la survenue de la pancréatite aiguë.
Dans certaines séries, la prévalence du diabète peut
atteindre 30 %.
Après nécrosectomie, on note également l’apparition
d’un diabète, mais avec une incidence moindre.
Cependant, il est à noter que les chiffres d’incidence
que l’on a, proviennent surtout d’études chez des
malades issus de séries chirurgicales, avec nécrose
étendue, ce qui biaise les chiffres. En effet, l’incidence
de la survenue du diabète doit être exagérée car la
survenue du diabète est étudiée principalement chez
des patients avec une atteinte parenchymateuse allant
de 70 à 80 % de la glande. Toutes ces études sont
méthodologiquement assez mauvaises.
En revanche, ce qui est intéressant, c’est le parallèle
avec la chirurgie d’exérèse : il faut tout faire dans le
cadre de la PA pour ne pas faire de pancréatectomie.
On savait déjà qu’une pancréatectomie n’améliorait
pas les résultats précoces. Les résultats à distance en
termes de diabète constituent un argument de plus
pour ne pas en faire. Lorsqu’on fait une nécro-
sectomie, même si on a l’impression de laisser peu de
pancréas viable, il y a quand même moins de diabète
à distance qu’après pancréatectomie.
PANCRÉASCOPIE : LES INTERVENTIONS DE RÉSECTION PANCRÉATIQUE
SUR PANCRÉAS RESTANT SAIN S'ACCOMPAGNENT-ELLES D'UN RISQUE
D'INSUFFISANCE PANCRÉATIQUE EXOCRINE (IPE) POST-OPÉRATOIRE ?
PRA. SAUVANET :Après pancréatectomie gauche,
énucléation, ou pancréatectomie médiane sur pancréas
Chez un patient avec une symptomatologie
douloureuse qui nécessite un geste chirurgical, la
tendance est de privilégier la dérivation, si le
malade n’est pas déjà diabétique.

-4-
Interview
sain, il n’y a pas d’insuffisance exocrine.
En effet, le fait de garder la tête du pancréas
en continuité avec le circuit duodénal normal
sur pancréas sain n’entraîne pas d’insuffisance
exocrine.
En revanche, après duodénopancréatectomie
céphalique, le problème est différent puisque
l’on résèque la tête du pancréas, le duodénum
et on modifie le circuit avec une anastomose
pancréato-digestive soit sur le jéjunum, soit
sur l’estomac. Dans ce cas, on observe le
développement d’une insuffisance exocrine
chez 50 à 60 % des malades d’après un critère
clinique simple : troubles digestifs corrigés par
la prise d’extraits pancréatiques. Ces troubles
peuvent se manifester àdistance de
l’intervention.
PANCRÉASCOPIE : QU’EN EST-IL APRÈSRÉSECTION
PANCRÉATIQUE POUR PC ?
PRA. SAUVANET :La pancréatectomie gauche ne
semble pas majorer le risque d’insuffisance
pancréatique exocrine contrairement à la
duodénopancréatectomie céphalique (DPC)
qui majore ce risque de façon nette. Trois
quarts des patients ayant eu une DPC pour
pancréatite chronique développent tôt ou tard
une IPE.
PANCRÉASCOPIE : APRÈSDPC, LE TYPE D'ANASTOMOSE
DU MOIGNON MODIFIE-T-ELLE LE RISQUE D'IPE POST-
OPÉRATOIRE ?
PRA. SAUVANET :En théorie oui, mais seulement
en théorie. Le fait de faire une anastomose du
pancréas au jéjunum semble plus physiolo-
gique que l’anastomoser à l’estomac, car les
enzymes pancréatiques, lorsqu’elles traversent
l’estomac, peuvent être dégradées et inactivées
par l’acidité gastrique.
Quelques études ont utilisé des tests de
la fonction exocrine qui montraient une
différence qui ne se traduisait pas par une dif-
férence en termes de prescription d’extraits
pancréatiques. Il n’y a donc pas de raison de
privilégier l’un ou l’autre type de montage.
Après chaque type de montage, il y a 50 à
60 % des patients qui développent une
IPE nécessitant la prescription d’extraits
pancréatiques.
PANCRÉASCOPIE : DONNEZ-VOUS DES EXTRAITS
PANCRÉATIQUES SYSTÉMATIQUEMENT OU SEULEMENT EN
CAS D'IPE AVÉRÉE?
PRA. SAUVANET : Non, la prescription se fait à
la demande. J’informe les patients de ce que
peut être une stéatorrhée, notamment les
patients ayant eu une DPC. Lorsque les patients
décrivent des signes compatibles avec une IPE
au cours des consultations postopératoires, je
prescris des extraits pancréatiques. Je ne fais
pas d’exploration fonctionnelle systématique-
ment car il peut y exister des anomalies sans
traduction clinique. En revanche, j’explique au
patient et au médecin généraliste qui suit le
patient le risque à distance de développer une
IPE ou un diabète.
Propos recueillis par le Dr C. Mura
CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES DE LA CHIRURGIE PANCRÉATIQUE
(SUITE DE LA PAGE 3)
Après DPC le développement d’une insuffisance
pancréatique exocrine peut s’expliquer par :
• l’existence d’une sténose de l’anastomose
pancréatico-digestive
• un défaut de stimulation du parenchyme exocrine
du fait de la suppression des facteurs stimulants
(stimulation hormonale d’origine duodénale),
• une réduction de la masse parenchymateuse (tête
du pancréas = 40 % de la masse parenchyma-
teuse)
• à distance de l’intervention, une atrophie du
parenchyme corporéo-caudal contemporaine ou
non d’une sténose anastomotique, visible à
l’imagerie.

Un homme âgé de 48 ans, ayant une pancréatite
chronique calcifiée d'origine alcoolique depuis 1998,
était hospitalisé en avril 2003 pour amaigrissement,
anorexie, nausées, vomissements.
L'amaigrissement était estimé à 15 kg. Le patient
était sevré d'alcool. Il avait un diabète insulino-
dépendant bien équilibré et une stéatorrhée
compensée par les extraits pancréatiques. L'examen
clinique était normal.
La numération formule sanguine était normale. Il existait
une hypoprotidémie à 56 g/l associée à une hypo-
albuminémie à 30 g/l. Il n'existait pas de syndrome
inflammatoire. Le fer sérique, la ferritine étaient normaux
ainsi que les marqueurs tumoraux (ACE et CA 19-9).
La gastroscopie avec biopsies jéjunales était normale,
le scanner abdominal (photo) mettait en évidence une
volumineuse lésion tumorale de la queue du pancréas
sans adénopathie péri-tumorale, ni envahissement
artériel. Cette lésion était entourée d'un large réseau
variqueux splénique.
Le reste de l'examen montrait une dilatation majeure du
canal pancréatique principal avec atrophie pancréa-
tique et calcifications glandulaires. Le scanner thora-
cique était normal. Une spléno-pancréatectomie gauche
avec anastomose wirsungo-jéjunale était réalisée.
L'analyse histologique de la pièce opératoire concluait
à un carcinome endocrine bien différencié avec embol
néoplasique dans la veine splénique et métastases gan-
glionnaires péri-pancréatiques et au niveau du hile
splénique.
Le dosage des marqueurs sanguins (sérotonine, gastrine,
glucagon, polypeptide pancréatique, VIP, NSE) ne mon-
trait pas d'anomalie. La scintigraphie à l'octréotide était
négative. Après plus d'un an d'évolution, le patient
était en rémission complète.
EN CONCLUSION
L'association tumeur endocrine du pancréas et pan-
créatite aigüe/chronique est inconnue et reste fortuite.
Les tumeurs endocrines du pancréas sont rares ;
toutefois, leur pronostic est plus favorable que celui des
adénocarcinomes.
image commentéE
-5-
PANCRÉATITE CHRONIQUE
ET TUMEUR ENDOCRINE
DISCUSSION
Les tumeurs endocrines du pancréas sont rares. Leur
incidence varie de 1 sur 200 à 1 sur 100 000. On oppose
les tumeurs endocrines fonctionnelles, donnant des
symptômes par leur sécrétion hormonale, aux tumeurs non
fonctionnelles dont les symptômes résultent de l'effet de
masse. Pour les tumeurs non fonctionnelles, malgré le
développement des méthodes diagnostiques, un délai
supérieur à deux ans depuis le début des symptômes jusqu'au
diagnostic a été rapporté.
Les tumeurs endocrines du pancréas les plus fréquentes
incluent les insulinomes (40 %), les gastrinomes (25 %)-
suivis par les glucagonomes (1 %) et les vipomes (moins
de 2 %). Les autres tumeurs (somatostatinome et les
tumeurs sécrétants du polypeptide pancréatique) sont
encore plus rares. Environ 30 % des tumeurs endocrines du
pancréas sont non fonctionnelles. A l'exception des
insulinomes, plus de 60 % de ces tumeurs sont malignes.
Le diagnostic de malignité n'est pas fait sur l'histologie
mais sur la présence des métastases.
L'association pancréatite aiguë/chronique et adénocarcinome
pancréatique est bien connue. En revanche, l'association
tumeur endocrine/pancréatite aigüe ou chronique est
inhabituelle, seulement 4 observations ayant été rapportées
dans la littérature, sans aucune relation de cause à effet.
Dr Patrick Hastier
Scanner abdominal : Calcifications pandréatiques (têtes de flèches rouges)
rate (flèche blanche) - lésion tumorale (flèche jaune)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%