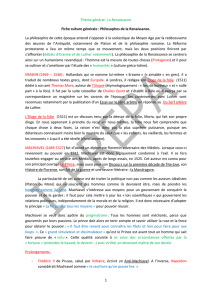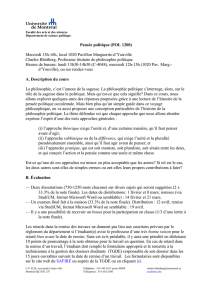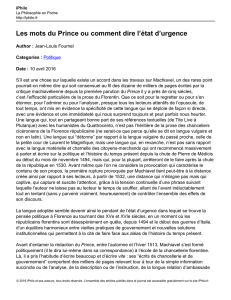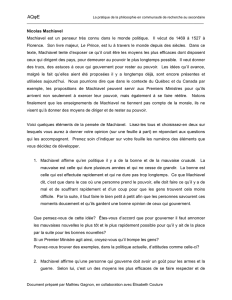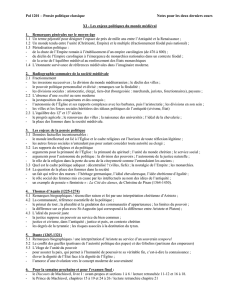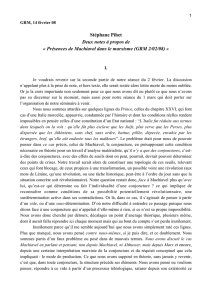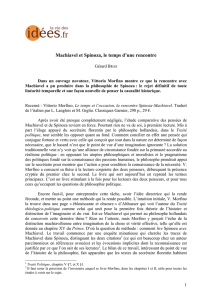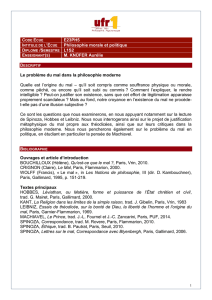Sophie Marcotte Chénard Lectures contemporaines

THÈSE DE MAÎTRISE
Université d’Ottawa
Département de philosophie
Présenté par
Sophie Marcotte Chénard
Lectures contemporaines de Machiavel : la question de l’interprétation
chez Leo Strauss, Quentin Skinner et Claude Lefort
Juin 2011
Directeur de thèse : Membres du comité :
M. Daniel Tanguay M. Gilles Labelle
Mme Isabelle Thomas-Fogiel
© Sophie Marcotte Chénard, Ottawa, Canada, 2011

!
2!
RÉSUMÉ
Dans cette thèse, nous cherchons à penser les enjeux philosophiques de l’application de
méthodes herméneutiques en histoire de la philosophie politique. À partir d’une étude
comparative des interprétations de l’œuvre de Nicolas Machiavel offertes par Leo Strauss,
Quentin Skinner et Claude Lefort, nous interrogeons le rapport que l’interprète institue avec
le texte qu’il étudie. Nous montrons qu’il y a dans les trois cas un écart entre l’exposition
théorique des principes herméneutiques et l’application effective de ces derniers. Nous
soutenons que les divergences fondamentales entre les trois lectures des écrits
machiavéliens ne trouvent pas leur fondement dans la différence des méthodes employées,
mais proviennent en dernier lieu de la compréhension particulière qu’ils ont du rôle et du
statut de la pensée de Machiavel. Autrement dit, nous cherchons à montrer que l’intérêt
pour la signification de l’œuvre machiavélienne dépasse la simple analyse des écrits d’un
auteur du passé; les trois interprètes entretiennent un rapport singulier à la pensée du
secrétaire florentin. En ce sens, l’étude des herméneutiques de Strauss, Skinner et Lefort
appliquées à Machiavel est indissociable d’une interrogation sur l’articulation entre
interprétation et politique.

!
3!
Comment le comprendrait-on ? Il écrit contre
les bons sentiments en politique, mais il est
aussi contre la violence. Il déconcerte les
croyants du Droit comme ceux de la Raison
d’État, puisqu’il a l’audace de parler de vertu
au moment où il blesse durement la morale
ordinaire. C’est qu’il décrit ce nœud de la vie
collective où la morale pure peut être cruelle et
où la politique pure exige quelque chose
comme une morale. On s’accommoderait d’un
cynique qui nie les valeurs ou d’un naïf qui
sacrifie l’action. On n’aime pas ce penseur
difficile et sans idole.
- Maurice Merleau-Ponty, « Note sur
Machiavel », Signes, p. 343.

!
4!
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION 6!
CHAPITRE 1. UN MACHIAVEL PHILOSOPHE ? L’INTERPRÉTATION
STRAUSSIENNE DE L’ENSEIGNEMENT MACHIAVÉLIEN 15!
1.1.!Introduction!:!Leo!Strauss!et!les!Pensées&sur&Machiavel!15!
1.2.!La!question!du!dessein!de!Machiavel!17!
1.2.1.!Le!point!de!départ!:!la!relation!entre!opinion!et!connaissance!17!
1.2.2.!Machiavel!et!l’avènement!de!la!modernité!21!
1.3.!La!redécouverte!de!l’art!d’écrire!ésotérique!23!
1.4.!L’analyse!straussienne!du!Prince!et!des!Discours!sur!la!première!décade!de!TiteFLive!29!
1.4.1.!L’organisation!des!chapitres!dans!les!Pensées&sur&Machiavel!30!
1.4.2.!La!surface!et!le!contenu!ou!le!rapport!entre!exotérique!et!ésotérique!32!
1.4.3.!L’ambiguïté!des!concepts!de!Fortune!et!de!virtù!35!
1.5.!La!question!du!rapport!de!Machiavel!à!la!philosophie!43!
CHAPITRE 2. QUENTIN SKINNER ET L’APPROCHE CONTEXTUALISTE :
UNE LECTURE « HISTORIQUE » DE LA PENSÉE MACHIAVÉLIENNE 52!
2.1.!Introduction!:!Quentin!Skinner!et!la!fondation!de!l’École!de!Cambridge!52!
2.2.!Les!principes!de!l’herméneutique!skinnérienne!56!
2.2.1.!La!critique!des!«!mythologies!»!historiques!56!
2.2.2.!Les!influences!majeures!:!Wittgenstein!et!Collingwood!64!
2.2.3.!Le!concept!d’intentionnalité!et!la!tâche!de!l’interprète!69!
2.3.!Machiavel!:!l’acteur!politique!et!le!penseur!de!la!liberté!75!
2.3.1.!L’héritage!humaniste!de!Machiavel!et!la!conception!de!la!Fortune!:!une!lecture!contextualiste!
de!l’œuvre!76!
2.3.2.!Divergences!entre!méthode!et!interprétation!:!l’analyse!du!concept!de!virtù!81!
2.3.3.!L’interprèteThistorien!et!le!rapport!au!passé!:!Machiavel!et!le!républicanisme!85!
2.4.!Conclusions!:!la!posture!intellectuelle!de!Skinner!entre!théorie!et!politique!94!
CHAPITRE 3. LE STATUT DE LA PAROLE INTERPRÉTATIVE CHEZ CLAUDE
LEFORT : DE L’ŒUVRE À LA POLITIQUE 97!
3.1.!Introduction!:!interprétation!et!politique!dans!la!pensée!de!Claude!Lefort!97!
3.2.!Une!triple!énigme!:!l’!«!espace!»!de!l’œuvre,!la!présence!de!l’auteur!et!la!position!de!
l’interprète!100!
3.2.1.!La!critique!lefortienne!des!leurres!de!l’interprétation!100!
3.2.2.!La!question!de!l’œuvre!103!
3.2.3.!La!position!de!l’interprète!:!l’interrogation!comme!mode!d’être!110!

!
5!
3.3.!Interprétation!et!politique!:!réversibilité!et!entrecroisement!115!
3.4.!L’analyse!de!l’œuvre!de!Machiavel!:!la!division!entre!les!Grands!et!le!peuple!et!la!nécessité!
de!la!représentation!118!
3.4.1.!La!division!originaire!et!le!désir!du!peuple!comme!fondement!de!la!loi!118!
3.4.2.!L’image!du!Prince!:!le!lieu!du!pouvoir!comme!représentation!symbolique!125!
3.4.3.!La!relation!entre!le!travail!de!l’œuvre!et!la!tâche!politique!:!entre!analogie!et!identité!131!
3.5.!Claude!Lefort,!lecteur!de!Strauss!136!
CONCLUSION 146!
BIBLIOGRAPHIE 157!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
1
/
164
100%