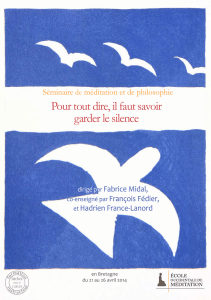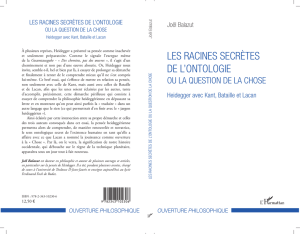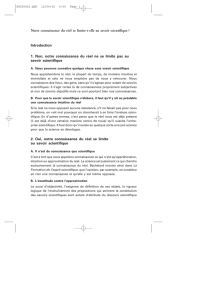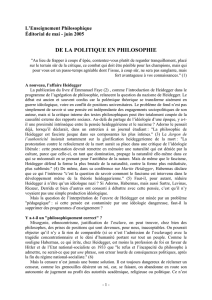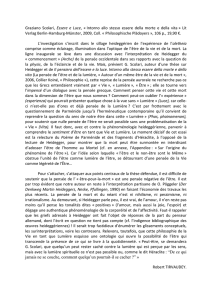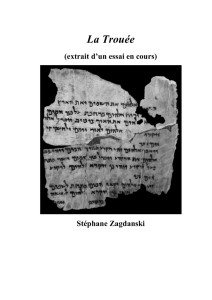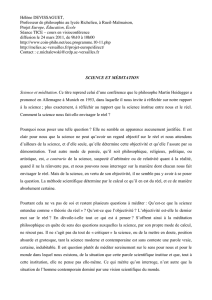Questions sur le jinen et l`ontologie heideggerienne et l`ontologie

344
Troisième partie
Troisième partieTroisième partie
Troisième partie
:
::
:
Questions sur le
Questions sur le Questions sur le
Questions sur le
jinen
jinenjinen
jinen
et l’ontologie heideggerienne
et l’ontologie heideggerienneet l’ontologie heideggerienne
et l’ontologie heideggerienne
Chapitre I Problèmes du soi
Chapitre I Problèmes du soiChapitre I Problèmes du soi
Chapitre I Problèmes du soi
1.
1.1.
1.
Mizukara
MizukaraMizukara
Mizukara
et
et et
et
Onozukara
OnozukaraOnozukara
Onozukara
-
--
-
Du soi
Du soiDu soi
Du soi-
--
-même subjectif et du soi
même subjectif et du soimême subjectif et du soi
même subjectif et du soi-
--
-même naturel
même naturel même naturel
même naturel -
--
-
Dans cette dernière partie, nous essaierons de greffer la notion de
jinen
,
provenant du taoïsme et du bouddhisme, sur la philosophie actuelle. Notre but n’est pas
de déterminer cette notion dans le cadre des recherches sur la pensée orientale ni de
l’inclure dans la philosophie occidentale. Mais c’est afin de dépasser l’idéologie mondiale
contemporaine comme métaphysique, technocratie et antropocentrisme, que nous
essayons de développer la notion de
jinen
. Nous pensons que la philosophie de
Heidegger s’approche de la pensée de la nature en tant que
physis
. Mais à travers la
notion de la
physis
, Heidegger croise la pensée du
jinen
, bien que Heidegger lui-même
ait eu peu de connaissances sur la pensée orientale. Pour Heidegger lui-même, sa
philosophie ne s’épanouit que sur le terreau de l’histoire et de la tradition de la
philosophie occidentale, néanmoins il ne faut plus négliger le lien de la philosophie
heideggerienne ou plutôt de la philosophie de la Grèce antique avec la pensée orientale,
comme en témoigne Nietzsche qui a eu évidement conscience des éléments orientaux
présents dans la culture grecque. Dans cette thèse, nous ne pouvons pas aborder la
totalité de la pensée de Heidegger. Il va sans dire qu’il est difficile d’analyser
suffisamment tous les textes nombreux et abondants de Heidegger, dans le cadre limité
de notre thèse. Ainsi ce que nous pouvons faire n’est que proposer une interprétation
limitée. Mais de toute façon, notre sujet n’est pas de l’ordre des recherches spécialisées
sur Heidegger ni sur Merleau-Ponty ni sur la pensée orientale mais il consiste à
approfondir les questions sur la
nature
en tant que
jinen
.
Jusqu’ici dans cette thèse, nous n’avons pas posé fondamentalement la
question du soi, bien que la problématique du soi constitue l’essentiel de la pensée du
bouddhisme. Nos interrogations sur le
jinen
lui-même provoquent des questions sur le
rapport entre la nature et le soi, qui concerne la question de la position de l’homme dans
l’univers, mais d’après les mots occidentaux signifiant la
nature
en tant qu’objet, il est
difficile de saisir ce rapport ontologique entre l’homme et la nature. Il faut approfondir
le sens de
jinen
. A propos de ce thème, Bin Kimura propose un schéma très intéressant

345
en utilisant les mots japonais :
mizukara
et
onozukara
. Nous aborderons ce thème selon
la proposition de Kimura.
Kimura comprend que le bouddhisme zen approfondit le problème du soi,
toutefois la pensée bouddhique sur le soi est complètement différente de la pensée
substantialiste sur l’ego ou la subjectivité dans la philosophie occidentale.
« La quête du soi-même ou du moi authentique constitue le but ultime de la
plupart des religions du Japon. C’est particulièrement vrai dans le cas du
bouddhisme zen. Un grand nombre de kôans que les maîtres zen proposent à
leurs disciples posent clairement ou implicitement cette question :
Qu’est-ce
que le soi ? Où peut-on le découvrir ?
»1
Par exemple, comme nous l’avons mentionné, un des enseignements les plus
connus de Dôgen concernant la voie bouddhique est strictement lié à la problématique
du soi.
« Apprendre la Voie de l’Éveillé c’est s’apprendre soi-même. S’apprendre
soi-même c’est s’oublier soi-même. S’oublier soi-même c’est se laisser attester
par les dix mille existants. Se laisser attester par les dix mille existants c’est se
dépouiller de son corps et de son cœur ainsi que du corps et du cœur de
l’autre. »2
Dans la phrase : « S’apprendre soi-même c’est s’oublier soi-même », Dôgen
suppose deux dimensions différentes du soi, mais Kimura analyse ces deux dimensions
en utilisant les mots usuels :
mizukara
et
onozukara
.
« Traditionnellement, en japonais, on nomme
mizukara
le soi-même ou le
moi-même. Ce terme signifie littéralement « s’originant de (
kara
) mon propre
corps, ou de ma propre chair (
mi
) ». Avec l’introduction du système d’écriture
chinois, les Japonais adoptèrent le caractère
ji
(qui se prononce
zi
en chinois)
pour traduire le mot
mizukara
. Ils réalisèrent alors que le même idéogramme
pouvait aussi exprimer un autre terme japonais
onozukara
, qui littéralement
signifie « de (
kara
) soi-même (
ono
) » dans le sens impersonnel d’un mouvement
1 Bin Kimura,
Entre onozukara et mizukara
, in
Ecrits de psychopathologie
phénoménologique
, traduit du japonais par Joël Bouderlique, Présentation de l’édition
française par Yves Pélicier, P. U. F., Paris, 1992. p.35.
2 Yoko Orimo, op.cit.p.67.

346
spontané, d’un changement des choses. Le japonais utilisa par la suite des mots
composés pour différencier ces deux notions :
ji-ko
ou
ji-bun
pour « moi-même »
(
mizukara
) et
ji-nen
pour « de soi-même » (
onozukara
).
Littéralement
ji-ko
veut dire le
ji
qui m’est propre et
ji-bun
ma part propre du
ji
,
tandis que
ji-nen
a pour sens « être en tant que
ji
est à l’origine » (le
nen
ayant
aussi la connotation de « ce qui est ainsi de soi-même »). Il y a une centaine
d’années le japonais moderne a choisi ce terme de
ji-nen
pour son sens de « ce
qui est ainsi par soi-même », afin de traduire le concept européen de « nature ».
Dans ce dernier cas ces idéogrammes se prononcent
shi-zen
. »3
Kimura explique exactement que notre thème (
jinen
) se rapporte à
onozukara
et en même temps il indique que les Japonais ont conçu le phénomène naturel selon la
fonction de
onozukara
.
Mizukara
, par contre, concerne le soi-même selon la distinction
du soi et des autres au niveau de l’humain, c’est-à-dire au niveau existentiel, tandis que
onozukara
concerne le soi-même au niveau essentiel et ontologique. Dans la phrase de
Dôgen, le soi-même que les bouddhistes apprennent est le soi-même essentiel au sens
d’
onozukara
et donc il faut commencer par oublier le soi-même existentiel au sens de
mizukara
. Mais
mizukara
concerne l’établissement du sujet comme
ji-ko
ou
ji-bun
,
tandis que
onozukara
comme fonction du
ji-nen
oppose la notion du sujet indépendant.
Pourquoi peut-on utiliser deux mots dont le sens est opposé pour traduire un mot :
soi-même ? Kimura l’explique d’après la signification de
ji
.
« Le secret réside dans l’étymologie originelle du caractère
ji
. En effet celui-ci
signifie « émaner de », « commencement » ou « origine », avec le sens
supplémentaire de « mouvement spontané à partir d’un point d’origine ».
Ji-ko,
ji-nen
(ou
shi-zen
)
, mizukara
et
onozukara
sont autrement dit les différents
modes de l’auto-articulation ou de l’automanifestation du mouvement spontané
universel à partir d’un point originaire. Quand la spontanéité impersonnelle du
ji
se manifeste dans mon corps, dans ma chair (
mi
), ici et maintenant – quand
elle est reconnue en tant que mon activité propre – on la nomme
mizukara
, « ce
qui s’origine dans mon propre corps, ma propre chair », et elle se révèle alors en
tant que
ji-ko
, « mon
ji
propre », ou bien
ji-bun
, « ma part propre du
ji
» (
bun
signifiant « morceau », « partie » ou « portion »). D’autre part, quand le
ji
est
perçu dans le monde extérieur de la nature, il manifeste sa spontanéité
caractéristique et devient
onozukara
« de soi-même », ou
ji-nen
« être en tant
3 Bin Kimura,
Entre onozukara et mizukara
, op.cit.p.37-38.

347
que le
ji
est à l’origine », ou encore
shizen
, la nature, dans le sens de « ce qui est
ainsi par soi-même ». »4
Pour comprendre exactement l’explication de Kimura, il faut se souvenir de la
spécificité du japonais. En japonais, il y a trois caractères principaux :
kanji, hiragana
et
katakana
. Le caractère
kanji
est un idéogramme d’origine chinoise et les
hiragana
et
katakana
sont des caractères phonétiques inventés au Japon. On écrit
mizukara
et
onozukara
en
hiragana
comme suit : みずから (
mizukara
) et おのずから (
onozukara
).
Mais si on utilise le
kanji
(caractère sino-japonais), on écrit les deux mots par le même
caractère : « 自ら ». Selon les contextes, les Japonais distinguent les lectures :
mizukara
et
onozukara
. Le caractère 自 est un mot d’origine chinoise et donc les Japonais ont
adopté le mot chinois
ji
(lecture imitée du chinois
zi
) selon les mots proprement
japonais :
mizukara
et
onozukara
. Certains mots japonais sont dérivés de cette
compréhension du sens de
ji
, par exemple
jiko
,
jibun
et
jiyû
, etc. Kimura explique le
caractère
ji
, par les exemples de
jiko, jibun
et
jinen
. Écrivons ces mots en
kanji
: 自己
(
jiko
), 自分 (
jibun
), 自然 (
jinen
ou
shizen
). Les mots
jiko
et
jibun
n’existent pas en
chinois. Ce sont les Japonais qui ont inventé ces mots, en adoptant le sinogramme
ji
.
L’important, c’est que le sens de
ji
oriente les significations des mots sino-japonais qui
sont composés avec le caractère
ji
.
« Par conséquent, pour le mode de pensée japonais, le concept du « soi »
embrasse presque la même gamme de significations que le concept de nature,
et contrairement au concept du « soi » des langues européennes (
self, Selbst
), il
ne comporte pas de connotation d’identité à soi-même. Dans ce sens le « soi » ne
peut être un soi authentique qu’en vertu de sa propre participation au
mouvement spontané global originaire de la nature. Le « soi » est, si l’on peut
dire, de la « nature intériorisée » et la nature en quelque sorte du « soi
extériorisé ».5
Cette distinction, exprimée chez Kimura, par les termes « intériorisé » et
« extériorisé » correspond à la distinction entre « subjectif » et « objectif » chez Kitarô
Nishida (1870-1945) qui est un des premiers philosophes japonais procédant selon le
style de la philosophie occidentale (néanmoins la base de sa pensée est constituée par
son expérience du bouddhisme zen). Kimura cite les termes de Nishida.
4 Ibid.p.39.
5 Ibid.p.39.

348
« La force d’intégration subjective en nous et la force d’intégration objective de
la nature sont originairement la même. Vue objectivement elle est manifeste
comme force intégrante de la nature, vue subjectivement elle est manifeste
comme intégration des différents actes de la conscience dans le sujet. »6
Nous ne pouvons pas examiner la philosophie de Nishida exhaustivement,
mais la distinction entre la force
subjective
et la force
objective
n’est pas une distinction
fondamentale chez Nishida. La force subjective de l’homme et la force objective de la
nature s’identifient mais cette identification doit être saisie selon la notion du
lieu
(
basho
en japonais). En un sens, Kimura développe la pensée du
lieu
de Nishida par le
biais la notion de l’
entre
(
aida
qui se lit
aïda
en japonais). Nous pensons que ces notions
de
lieu
et d’
entre
concernent la notion bouddhique de l’
engi
(co-production conditionnée),
mais nous ne pouvons pas les aborder dans le détail ici. Ce qui importe, c’est que ‘’pour
la pensée japonaise traditionnelle, le soi et la nature,
mizukara
et
onozukara
ont la
même origine.’’7 Nous devons expliquer plus exactement ce que les anciens Japonais
ont essayé de saisir d’après les mots
mizukara
et
onozukara
qui sont d’origine propre à
la langue japonaise. En fait, le
jinen
était un mot chinois et donc pour les anciens
Japonais, ce mot indiquait originairement une nouvelle notion. Avant de développer la
proposition qui est donnée par
mizukara
et
onozukara
, il faut comprendre plus
exactement ce que Kimura explique selon ces termes. La distinction entre l’
intériorisé
et
l’
extériorisé
n’est pas suffisante pour expliquer le rapport entre
mizukara
et
onozukara
.
Kimura reprend encore la problématique d’après ces termes, dans la dernière section de
son ouvrage
L’Entre
, dans laquelle il ne pose plus la distinction entre ‘’l’intérieur’’ et
‘’l’extérieur’’.
« En Occident, le soi est posé au dedans en tant qu’ « intériorité », par rapport à
la nature, « ce qui est dehors ». Mais en Orient,
jinen
comme naturel n’a jamais
été pensé comme extérieur et en opposition avec l’intérieur. Si l’on considère
avec Rôshi (Lao-tseu) que « les hommes se règlent sur la terre, la terre se règle
sur le ciel, le ciel se règle sur la Voie et la Voie sur
jinen
», alors
jinen
est
l’élément fondamental de toutes choses et ne saurait en aucun cas être situé au
dehors. Le concept de
jinen
, dans le sens de Lao-tseu fut traduit par le célèbre
sinologue Waley par « the self-so », « the what-is-so-of-itself », c’est-à-dire « ce
6 Ibid.p.39.
7 Ibid.p.39.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
1
/
183
100%