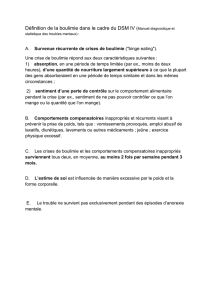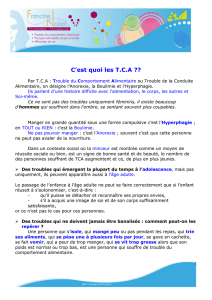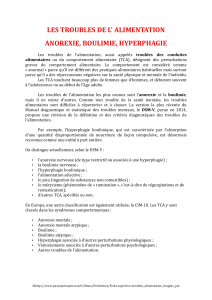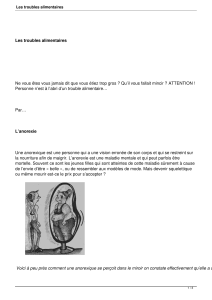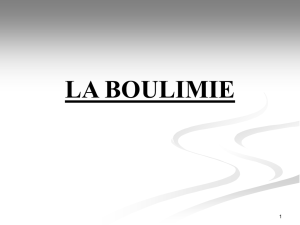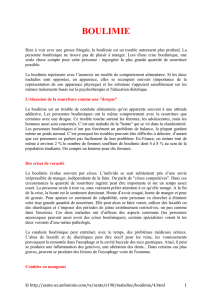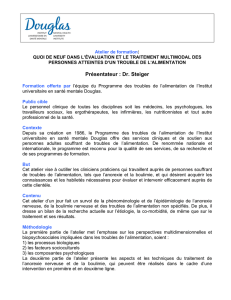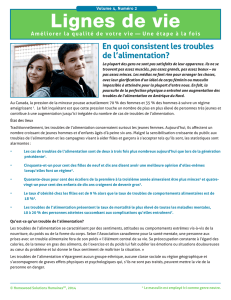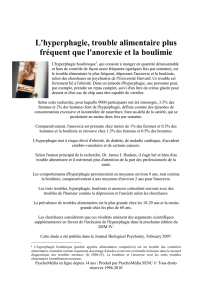Les progrès récents dans la gestion du trouble de l`hyperphagie

Les progrès récents dans la geson du trouble
de l’hyperphagie boulimique
Comprendre le trouble de l’hyperphagie boulimique : De la physiopathologie au diagnostic
Symptômes et critères diagnostiques
L’Association américaine de psychiatrie (American Psychiatric Association, ou APA) a reconnu le trouble de l’hyperphagie
boulimique (HB) comme un trouble de l’alimentation distinct dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth
Edition (DSM-5) [1] (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition). Avant cette édition, l’HB faisait
partie de la catégorie des «troubles de l’alimentation non spéciés (EDNOS)» selon la nosologie du Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV)[2] (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, quatrième
édition).
Les crises de boulimie récurrentes sont la caractéristique clinique type de l’HB. Reconnue pour la première fois en 1959 par
Stunkard[3] dans un sous-ensemble de personnes obèses, la crise de boulimie est dénie comme «manger, dans un intervalle de
temps déni (p.ex., sur une période de 2heures), une quantité de nourriture qui est certainement plus importante que ce que la
plupart des gens mangent dans une période de temps similaire dans des circonstances similaires».[1] Ce qui distingue les crises de
boulimie de la suralimentation régulière, c’est le sentiment de manque de contrôle au cours de l’épisode, qui peut se manifester
comme un sentiment qu’on ne peut pas arrêter de manger une fois qu’on a commencé ou qu’on ne peut pas contrôler la quantité
que l’on mange. L’HB est distincte de la boulimie mentale dans la mesure où les personnes diagnostiquées comme sourant d’HB
n’ont pas de comportements compensatoires inappropriés récurrents tels que les vomissements provoqués, l’abus de laxatifs ou
l’exercice excessif.
Selon les critères DSM-5 d’HB, les crises de boulimie doivent avoir lieu, en moyenne, une fois par semaine sur une période de
3mois. Il s’agit d’un écart important par rapport aux critères DSM-IV, lesquels nécessitaient une moyenne de 2épisodes de crises
de boulimie par semaine sur une période de 6mois, et qui fait concorder les critères de fréquence et de durée de l’HB avec ceux
de la boulimie.
En plus de la caractéristique comportementale centrale des crises de boulimie, et an de répondre aux critères de diagnostic
de l’HB, les crises de boulimie doivent conduire à une détresse intense et présenter au moins 3des caractéristiques suivantes:
manger rapidement, manger jusqu’à ressentir de l’inconfort d’avoir trop mangé, des crises de boulimie sans avoir faim, manger
seul en raison de sa gêne et un sentiment de dégoût, de dépression ou de culpabilité après avoir mangé. Il est à noter que ces
caractéristiques supplémentaires ne sont pas obligatoires pour un diagnostic de boulimie mentale.
Contrairement à l’anorexie mentale et la boulimie mentale, il n’y a pas de critères diagnostiques pour l’HB liés à l’image corporelle
ou à l’inuence du poids et de la forme sur l’auto-évaluation. Bien que de nombreuses personnes atteintes d’HB sourent d’une
mauvaise image corporelle, ce critère n’est pas requis pour un diagnostic. En outre, il n’existe pas de critère d’indice de masse
corporelle (IMC) pour l’HB. Il est important de noter que l’HB peut se produire chez toutes les personnes, peu importe leur IMC,
mais elle est souvent associée à un excès de poids ou à l’obésité.
Prévalence
Aux États-Unis, la prévalence de l’HB a été estimée à 3,5% chez les femmes et à 2,0% chez les hommes. [4] Des enquêtes
communautaires dans 12pays estiment la prévalence à vie pour les deux sexes à 1,9%. [5]
Dans une étude basée sur une population de jumelles, 37% des femmes obèses (IMC de 30kg/m2 ou plus) ont déclaré avoir eu
des crises de boulimie, [6] ce qui représente 2,7% de la population féminine étudiée. La répartition par sexe pour l’HB est plus égale
que pour l’anorexie mentale ou la boulimie mentale, pour lesquelles il y a une prépondérance chez les femmes. [4] Il y a peu de
diérences en termes de prévalence parmi les groupes raciaux ou ethniques. [7,8]
Facteurs de risque
Les facteurs associés au développement de l’HB dans des études rétrospectives comprennent les expériences négatives de
l’enfance; la dépression parentale; la vulnérabilité personnelle à la dépression; l’exposition à des commentaires négatifs sur le
poids, la forme et l’alimentation; l’obésité infantile; les mauvais traitements, y compris les taquineries et l’intimidation; et le stress
perçu.[9-11] Bien que le seuil d’HB soit rarement atteint chez les enfants, ces derniers font état d’épisodes de perte de contrôle de
l’alimentation (une incapacité à arrêter de manger ou à contrôler la quantité ou le type de nourriture consommée), ce qui peut
être un précurseur de l’HB adulte.[12]

Les progrès récents dans la geson du trouble
de l’hyperphagie boulimique
Comorbidités
L’HB est associée à des morbidités médicales importantes, notamment l’obésité, le diabète de type2 et l’hypertension. L’HB
peut conférer un risque pour les composants du syndrome métabolique (déni comme plusieurs facteurs associés aux maladies
cardiovasculaires, y compris l’obésité abdominale, la dyslipidémie, l’hypertension et le métabolisme anormal du glucose), au-
delà du risque attribuable à l’obésité seule.[13] Les crises de boulimie sont également associées au reux gastro-œsophagien
pathologique, au syndrome du côlon irritable[14,15] et aux troubles menstruels.[16] L’association entre les crises de boulimie et
certains problèmes de santé semble être indépendante de l’obésité.[6] Il est essentiel de se rappeler que toutes les personnes
sourant d’HB ne sont pas en surpoids ou obèses. Il n’existe pas encore de données susantes pour déterminer si l’incidence de
l’HB sur la santé chez les personnes de poids normal est le même que chez les personnes en surpoids ou obèses.
L’HB coexiste aussi avec d’autres troubles psychiatriques, le plus souvent les troubles de l’humeur, l’anxiété et la toxicomanie. [17] Le risque
de suicide est élevé chez les personnes sourant d’HB. [18] Les personnes sourant d’HB ressentent une altération signicative du
fonctionnement psychosocial. Les données de l’étude nationale réitérée sur la comorbidité indiquent que l’HB est une maladie
chronique associée à un handicap signicatif.[4] L’HB à début précoce prédit des chances réduites de se marier chez les femmes
et des chances réduites de trouver un emploi chez les hommes. L’HB a été associée à une augmentation signicative du nombre
de jours où la personne éprouve de la diculté à assumer un rôle, bien que cela s’explique en grande partie par la présence de
comorbidités.[19] Le fonctionnement conjugal chez les femmes sourant d’HB est comparable ou pire au fonctionnement conjugal
des femmes avec d’autres troubles psychiatriques importants.[20] Nous ne savons rien au sujet du fonctionnement relationnel chez
les hommes sourant d’HB.
Les personnes obèses sourant d’HB signalent un fonctionnement psychologique sensiblement plus pauvre que les personnes
obèses sans HB, [21] et les personnes de poids normal et en surpoids sourant d’HB signalent des caractéristiques psychologiques
équivalentes à celles des troubles de l’alimentation et de la dépression. [22]
Causes
Les causes de tous les troubles de l’alimentation sont multifactorielles et comprennent à la fois les facteurs génétiques [23] et
environnementaux. [24] Parce que l’HB a été dénie plus récemment que l’anorexie ou la boulimie, il existe moins de recherche
sur la génétique de l’HB. La recherche sur la famille, les jumeaux et la génétique moléculaire suggère que les facteurs familiaux
et génétiques inuencent le risque d’HB. Un petit nombre d’études de la famille ont été menées et, avec une seule exception,
révèlent que l’HB est familiale. [25-27]
Cette observation a été renforcée par les résultats des études sur les jumeaux, qui estiment l’héritabilité de 39% à 45%. [28,29]
Les études sur la neurobiologie de l’HB mettent l’accent sur le fait que l’HB est souvent associée à des comportements dérégulés
supplémentaires, y compris les addictions comportementales et liées à des substances. Surtout lorsqu’elle s’ajoute au surpoids
ou à l’obésité, l’HB peut être provoquée et maintenue par certaines des mêmes anomalies physiopathologiques que l’on retrouve
dans la toxicomanie, y compris la valeur de renforcement de l’alimentation (c.-à-d. les voies biochimiques de récompense du
cerveau dopaminergiques et opioïdergiques). [30] Les voies biochimiques de récompense naturelles du cerveau sont activées à la
fois par les aliments au goût agréable et l’abus des drogues. [31]
Jennings et ses collègues [32] ont utilisé des techniques optogénétiques pour stimuler les neurones de l’acide γ-aminobutyrique
(GABA) dans le noyau du lit de la strie terminale (BNST, pour l’anglais «bed nucleus of the stria terminalis»). Le BNST est un
aeurement de l’amygdale, une partie du cerveau associée aux émotions qui relie également l’amygdale et l’hypothalamus
latéral, qui entraîne les fonctions primaires comme manger, le comportement sexuel et l’agression. La stimulation de celui-ci a
entraîné une frénésie alimentaire et l’arrêt de la stimulation a entraîné une indiérence pour les aliments très agréables au goût.
Les auteurs suggèrent que le dysfonctionnement dans cette région pourrait interférer avec les déclencheurs de la faim ou de la
satiété, et contribuer à des troubles de l’alimentation humains tels que l’HB. Une élucidation plus poussée de la neurobiologie
des crises de boulimie peut aider à identier et à aner des interventions pharmacologiques et non pharmacologiques visant à
perturber l’alimentation non contrôlée.

Les progrès récents dans la geson du trouble
de l’hyperphagie boulimique
Approches diagnostiques
Entretiens cliniques
Pour les enquêteurs sans formation, les 2principaux instruments sont le Diagnostic Interview Schedule [33] (grille d’entretien pour
le diagnostic) et le Composite International Diagnostic Interview [34] (entretien composite international pour le diagnostic).
L’HB peut aussi être évaluée grâce au «Structured Clinical Interview for DSM-IV» [35] (entretien clinique structuré pour le
DSM-IV) par des personnes ayant reçu une formation à ce sujet. Le «Eating Disorder Examination» [36] (examen du trouble de
l’alimentation) est un instrument bien établi et largement utilisé pour recueillir des informations détaillées sur la pathologie de
l’alimentation; toutefois, une formation est requise. L’échelle d’obsession-compulsion de Yale-Brown pour les crises de boulimie
(Y-BOCS-BE) est un entretien ecace eectué par les cliniciens qui permet d’établir les scores pour l’obsession, la compulsion et
totaux pour les crises de boulimie. [37]
Auto-évaluations
Deux brefs questionnaires d’auto-évaluation permettent de capturer le phénomène des crises de boulimie: Le «Binge Eating
Scale» [38] (échelle des crises de boulimie) et le «Questionnaire for Eating and Weight Patterns-Revised» [39] (questionnaire révisé
sur les habitudes alimentaires et le poids).
Le SCOFF est un bref examen préalable développé d’abord au Royaume-Uni. La version américaine du SCOFF comprend
5questions qui permettent de déterminer si une évaluation plus approfondie est nécessaire. [40]
Voici les questions du SCOFF:
• Vous rendez-vous malade (vomissements induits) parce que vous ressentez de l’inconfort d’avoir trop mangé?
• Vous inquiétez-vous d’avoir perdu le contrôle de la quantité que vous mangez?
• Avez-vous récemment perdu plus de 14kilos sur une période de 3mois?
• Vous croyez-vous gros/grosse quand d’autres disent que vous êtes trop mince?
• Diriez-vous que la nourriture domine votre vie?
L’utilisation généralisée de cet instrument de dépistage serait très utile dans la pratique générale. Alors qu’on demande de plus en
plus aux médecins de travailler avec les patients pour réduire l’IMC, [41] la détection de troubles de l’alimentation est essentielle et
les médecins ont peu de chances d’aider les patients à gérer leur poids si les troubles de l’alimentation sous-jacents ne sont pas
détectés et demeurent non traités.
Conclusion: C’est une maladie, et non un choix
Les troubles de l’alimentation continuent à faire l’objet de beaucoup de honte et de stigmatisation. De nombreuses personnes
sourent d’HB pendant des décennies sans divulguer leurs symptômes à leurs professionnels de santé et plusieurs ne sont pas
conscientes que leur alimentation non contrôlée est un syndrome reconnu et traitable. Deux dés importants sont de sensibiliser
sur la nature et la traitabilité de la maladie, et de réduire la stigmatisation et la honte qui y sont rattachées. Les personnes qui
sont en surpoids ou obèses sont stigmatisées partout dans le monde, même au sein de la profession médicale, et les personnes
en surpoids ou obèses présentant un diagnostic d’HB sont doublement stigmatisées. Comprendre que les causes de l’HB sont
multiples et qu’elles comprennent à la fois des facteurs génétiques et environnementaux peut aider à reconnaître que l’HB est une
maladie, et non un choix.

Les progrès récents dans la geson du trouble
de l’hyperphagie boulimique
Charles P.Vega, MD: Bonjour. Je suis le DrCharles Vega, professeur clinicien de médecine familiale à l’Université de Californie à
l’Irvine School of Medicine. Je suis également le directeur général du Programme Irvine de l’UC pour l’éducation médicale de la
communauté latino-américaine à Irvine, en Californie. Aujourd’hui, nous allons discuter de l’HB.
Communication patient-clinicien dans l’HB

Les progrès récents dans la geson du trouble
de l’hyperphagie boulimique
Je suis accompagné du DrSusan McElroy, directrice de recherche au Centre Linder de HOPE à Mason, en Ohio, et professeur de
psychiatrie et de neuroscience comportementale au College of Medicine de l’Université de Cincinnati, à Cincinnati, dans l’Ohio.
Soyez la bienvenue, DrMcElroy.
Susan L.McElroy, MD: Bienvenue, je vous remercie.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%