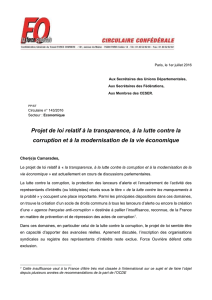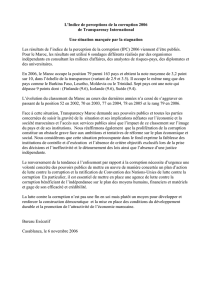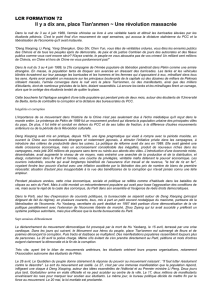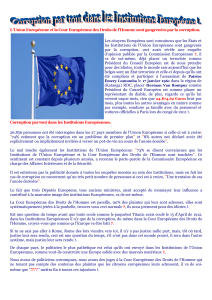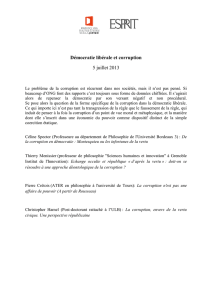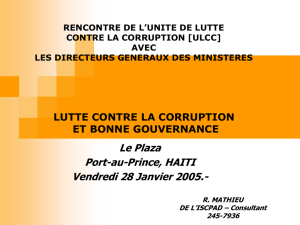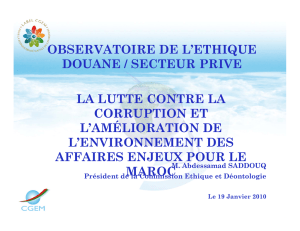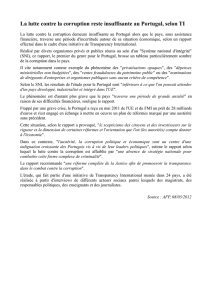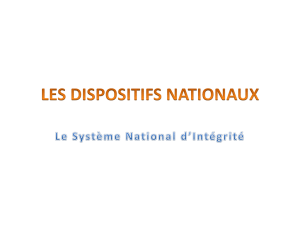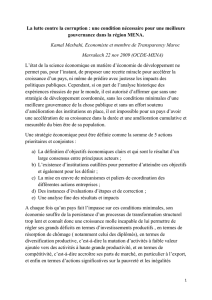Société civile » : est-ce un gros mot en chinois

TOPIC
novembre 2005
« Société civile » : est-ce un gros mot en chinois ?
Décentralisation,..
… et système
juridique en
construction…
… laissent libre
cours à une zone
grise élargie…
… dans laquelle
l’élite dirigeante
navigue avec
aisance.
Depuis octobre dernier, on ne dit plus « Plan » mais « Programme »
pour qualifier les grandes orientations données par Pékin à l’économie
chinoise. Ce changement de vocabulaire est édifiant à plus d’un titre. Il
témoigne à tout le moins d’une décentralisation qui a pris, ces dernières années
une ampleur considérable. Le transfert du pouvoir de décision sur les choix de
politique économique au niveau des provinces et districts a créé une immense
zone grise dans laquelle se meuvent avec souplesse les cadres locaux dans la
plus grande opacité.
On l’oublie parfois mais la Chine demeure une économie en
transition. Un statut qui implique un système juridique nécessairement bancal
d’autant que la Chine excelle à coucher sur le papier des lois dont elle fait peu
usage. Résultat, la façade juridique qu’elle a édifiée depuis son entrée à
l’OMC cache un écheveau de règles et réglementations bien difficile à
démêler.
Décentralisation, corruption et pratique du juridique incertaine, le tout
en l’absence de contre-pouvoirs conduisent l’économie chinoise sur des
chemins de plus en plus tortueux.
L’organisation même de cette « économie socialiste de marché »
impliquait dès l’origine que l’Etat soit un acteur clé des réformes. La
séparation entre la sphère politique d’un côté et la sphère économique de
l’autre n’a jamais été à l’ordre du jour. D’autant que leur intrication plonge ses
racines dans le fonctionnement même du PCC. Les hiérarques du Parti ont
depuis longtemps consolidé leur assise - surtout depuis l’arrivée au pouvoir de
Deng Xiaoping - en choisissant les candidats à leur succession. Ceux qu’on
appellent les taizi, fils et petit-fils d’anciens hauts dignitaires tiennent
aujourd’hui fermement les rênes du pays. La carte maîtresse de ce mélange
détonnant entre l’ouverture économique et le système politique socialiste
chinois est celle de la collusion qui permet de naviguer avec aisance entre le
business et les petites affaires d’ordre privé. Toutefois, ce capitalisme rouge,
résultat de réseaux de privilèges complexes et obscures pour le non initié,
freine la bonne marche de l’économie par une allocation des ressources
souvent hasardeuse.
La décentralisation en cours depuis 25 ans, n’a rien arrangé. De fait,
Pékin en a profité pour se désengager progressivement du financement des

La corruption :
alternative au
retrait financier
de Pékin ?…
… ou réponse à
la course aux
taux de croissance
élevés ?
Le phénomène
devenu collectif
est de plus en
plus visible,…
… attise le
mécontentement
des ruraux qui
le font savoir,…
… creuse les
inégalités
sociales,…
… et pénalise la
qualité de la
croissance.
provinces. Les resserrements de budget a amené les dirigeants locaux à
chercher de nouvelles sources de financement en empruntant implicitement les
chemins de la corruption.
D’autre part, cette autonomie financière accrue des provinces
chinoises s’est accompagnée d’une dépendance non moins forte vis-à-vis des
taux de croissance. Elle explique sans doute pour une bonne part pourquoi le
monde politique et les milieux d’affaires locaux sont devenus si imbriqués
faisant de la corruption rampante un acteur clé de l’activité économique locale.
Les bons résultats de la fin d’année en matière de croissance économique
constituent avant tout, un véritable sésame pour grimper dans l’échelle du
Parti. Les cadres, quelle que soit leur position dans la hiérarchie, sont prêts à
tout pour l’acquérir.
Annexement, la course à l’accumulation engagée entre les provinces a
laissé peu de place aux systèmes redistributifs, aux préoccupations
environnementales ou à l’efficacité énergétique, sujets pourtant au cœur du
programme qui sera présenté par Hu Jintao lors du Congrès National du Parti
en mars 2006. Il sera intéressant de suivre dans quelle mesure les directives
fixées dans le programme 2006-2010 seront appliquées par les autorités
locales.
En attendant, le slogan « Il est glorieux de s’enrichir » de 1992 se
solde treize ans plus tard par une distribution de la richesse des plus inégales.
La corruption rampante n’y est pas étrangère. Malgré tous les efforts déployés
par Hu Jintao depuis 2002, le jeu économique apparaît durablement biaisé aux
dépens d’une fraction toujours plus large de la population chinoise. Dans les
années 80, la corruption restait encore relativement marginale car individuelle.
Depuis le milieu des années 90, elle concerne des collectivités entières ce qui
amplifie à la fois le phénomène et sa visibilité.
En dépit du filtre de la censure, les exemples de corruption affluent et
sont abondamment commentés sur Internet et dans la presse écrite - Le
Quotidien du Peuple, organe de presse officiel incontournable, s’en fait même
parfois l’écho, c’est dire ! La stratégie de contournement des autorités
centrales qui revient à attiser le souffle du nationalisme n’y peut rien. La
capacité à produire de la croissance qui était devenue le nouvel étendard
brandit par Pékin non plus. Pour un nombre grandissant de Chinois qui n’ont
plus confiance dans les autorités locales, cela ne suffit pas. Un paysan dont les
terres viennent d’être spoliées pour y construire une usine ou pour les besoins
des spéculateurs immobiliers, cherche avant tout à essayer de faire valoir un
droit qu’il considère légitime. La croissance vient désormais après.
L’amalgame entre inégalités sociales et corruption dans l’esprit des
paysans et des citadins chinois est amplifiée par le sentiment que les cadres
locaux du Parti corrompus bénéficient de la plus grande impunité, autrement
dit, de l’appui de leurs supérieurs provinciaux voire même de Pékin. Ils n’ont
sans doute pas tort. En juin 2004, un rapport officiel notait que 41 ministères
avaient détourné au bas mot 170 millions de dollars en 2003 pour spéculer
dans l’immobilier et offrir des logements à leurs employés. Dans les zones
rurales, tout un arsenal de droits d’utilisation, payants bien entendu, ont fleuri
un peu partout sur le concept du péage - vous utilisez, vous payez - dans la
plus parfaite illégalité - les paysans se sont vu imposé des impôts agricoles de
toute sorte, des taxes pour la réparation des bâtiments scolaires, d’autres pour
les travaux d’irrigation… Les autorités centrales avaient pourtant affirmé en

La lutte déclarée
au plus haut
niveau contre ce
fléau ne serait-elle
qu’une façade ?
Elle est en tout
cas bien utile
dans les luttes
de faction.
La corruption :
menace pour la
stabilité sociale
et l’assise du
PCC ?
1991 que l’impôt ne devait pas dépasser 5% du revenu total des paysans. Rien
n’y fait.
A première vue, la lutte de Pékin contre ce fléau semble n’avoir
jamais été aussi virulente. Tous les moyens sont bons. En 2003, le vice-
gouverneur de la province de l’Anhui, convaincu de corruption avait été
condamné à mort. Fin 2004, dans le cadre d’une vaste campagne d’audit au
niveau des provinces et districts, 750 officiels avaient été arrêtés pour le même
motif. En mars dernier, la Chine énonçait de nouvelles règles incitant les
employés de banque à dénoncer des affaires de corruption dont ils auraient eu
vent - il faut dire que le système bancaire est gangrené par des scandales à
répétition.
Et pourtant… Les mesures anti-corruption sont souvent détournées et
utilisées par le pouvoir central lui-même contre des personnalités devenues
gênantes ou lors de luttes de factions au sein du Parti. Le cas de Zhu Xiaohua
est très représentatif de ces évolutions. Ancien président du groupe financier
China Everbright et directeur de l'Administration nationale des changes
(ANC), il était surtout connu pour faire partie des protégés de l’ancien Premier
Ministre Zhu Rongji. Arrêté en 1999 après avoir été dénoncé par des officiels
de haut rangs, membres eux du clan du Président d’alors Jiang Zemin, il a été
condamné trois ans plus tard à quinze ans de prison. La peine de mort lui a été
évitée grâce à l’intermédiation de Zhu Rongji qui avait menacé Jiang Zemin de
lancer une procédure d’investigation contre son fils Jiang Mianhen.
La lutte contre la corruption vise aussi à empêcher toute velléité de la
part des membres les plus influents du Parti de s’opposer à quelque niveau que
ce soit aux choix de Pékin. Cette stratégie obéit finalement aux mêmes
objectifs que le mouvement d’intégration des entrepreneurs privés au sein du
PCC.
Au final, les signaux que Pékin envoie sont pour le moins brouillés.
La distorsion générée par l’éloignement plus ou moins important avec la
capitale, amplifie le phénomène. La décentralisation, on l’a noté, n’y est pas
étrangère. Bref, le statut d’économie en transition n’explique pas tout.
Ce dossier est en tout cas dès plus brûlant et le ressentiment que la
corruption suscite auprès des Chinois laisse présager d’un avenir social pour le
moins assombri. De la capacité à répartir les fruits de l’expansion et
désormais, à lutter activement contre la corruption, dépendront de plus en plus
la légitimité du PCC à diriger le pays et une paix sociale qui n’est déjà plus
que très relative. Les vœux pieux du 11ème Plan - Programme - quinquennal
seront-ils entendus ? Rien n’est moins sûr. L.B
A noter : notre prochain colloque « L’Asie en 2006 » qui se tiendra à Paris, le 2 février 2006
Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez contactez Mme Ghislaine Rouger : [email protected]

Mensonge et corruption : des secrets de polichinelles
bien néfastes pour l’image de la Chine
La prise conscience de la part de Pékin des risques encourus par le pays du fait de la pollutio
n
remonte aux années 1970. Mais les autorités n’ont jamais véritablement fait preuve d’un fol
enthousiasme en la matière. La Loi sur la Protection de l’environnement de 1989 qui déléguai
t
aux provinces le soin de mettre en œuvre la politique environnementale en témoigne. Sans
objectif précis de la part du Centre, cette décentralisation ne pouvait mener la politique
environnementale que dans le mur. On y est ! Question de budget, question de volonté aussi,
question d’exposition à l’international et, question de collusion surtout, entre les élites
p
olitiques et économiques locales.
Les antennes locales de la SEPA ne disposent que de budgets réduits à la portion congrue e
t
n’ont aucun pouvoir coercitif. L’existence de la plupart d’entre elles dépendent du bon vouloi
r
des dirigeants provinciaux. Or ces derniers en plus des liens plus qu’étroits qu’ils entretiennen
t
avec le milieu des affaires local sont même, parfois, les détenteurs des usines polluantes. Il est,
on le comprend, bien difficile de contrôler efficacement une usine dont le capital appartient aux
élites locales et dont la production leur permet de s’enrichir grassement.
Au niveau central, ce sont les Ministères de la Construction ou de la Communication qui pa
r
tous les moyens s’essayent à mettre les bâtons dans les roues de la SEPA.
Le cas de la pollution de la rivière Songhua (qui déjà en 2003 appartenait au clan des rivières
de niveau IV, ce qui signifiait qu’un plus d’être impropre à la consommation, la touche
r
p
résentait des risques sanitaires majeurs) qui fait aujourd’hui la une de nos journaux, illustre
à
souhait ces incohérences et la corruption qui gangrène la gouvernance chinoise en matière
d’environnement. Il n’est malheureusement qu’un cas parmi d’autres.
Ce qui est moins habituel, c’est la verve dont les journaux chinois font preuve. Malgré l
a
reprise en main des media par Hu Jintao depuis son arrivée au pouvoir, la culture du secret es
t
une pilule qui passe de moins en moins bien auprès de la population. Ses porte-parole
j
ournalistiques s’en font l’écho et n’ont eu de cesse depuis le 23 novembre de multiplier les
critiques envers les autorités de la province du Jilin et les responsables de l’entreprise d’Eta
t
Petrochina qu’ils soupçonnent à juste titre d’être de mèche.
Cette relative liberté de ton ne doit pas être appréhendée toutefois comme l’émergence d’u
n
contre-pouvoir qui serait susceptible de demander des compte aux autorités centrales.
Mensonge et corruption ne sont pas prêts de céder leur place dans le système de gouvernance
chinois. Ils constituent néanmoins des failles dans un régime incapable de gérer des crises
majeures. Le SRAS en 2003, la grippe aviaire en 2005 et maintenant cette crise
environnementale en sont l’expression cinglante. La prochaine affaire de ce genre n’est sans
doute malheureusement pas loin.
1
/
4
100%