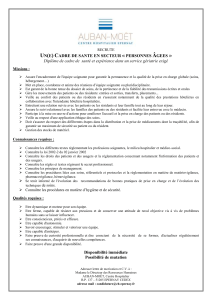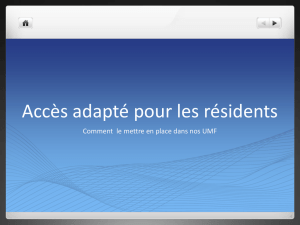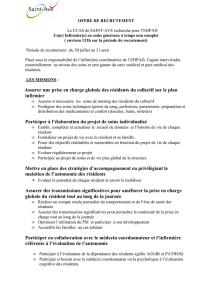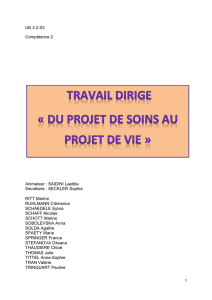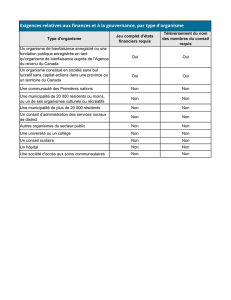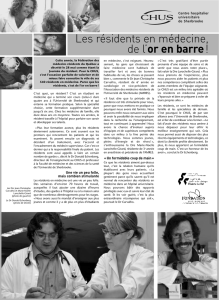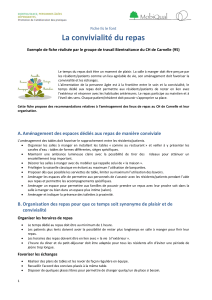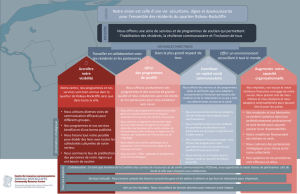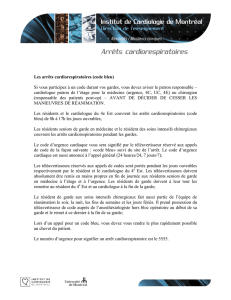les résidents auront des gardes de 16 heures

Le « passage obligé » que représentent les
gardes de 24 heures en établissement
n’est donc plus. « Pour les justifier, cer-
tains disaient : “Ce n’est pas si pire, je l’ai
fait, donc fais le toi aussi”, se souvient M.
Dussault. Comme il y a déjà des services
qui le font, ça montre qu’il y a déjà du sou-
tien de certains patrons. La majorité
saluera le changement. »
Le Dr Louis Godin, président de la
Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec, voit d’un bon œil la nou-
veauté : « C’est une question de sécurité
des patients et de qualité de travail. On
se réjouit pour les résidents, d’autant
plus que la décision a eu des échos posi-
tifs du gouvernement. » Notant que « les
choses changent », ce dernier admet que
même si travailler 24 heures a « déjà été
régulier pour bien des médecins », il faut
aujourd’hui « s’adapter » et « être capa-
ble d’être à l’avant-garde ».
Cette « bonne nouvelle », comme l’a
qualifiée l’avocate spécialisée en droit
médical Christine Clark, aura un impact
sur tous les médecins résidents du
Québec, dont l’entente collective est
échue depuis le 31 mars 2010. « La dé-
cision sera nécessairement insérée dans
les modalités de la nouvelle convention.
Comme la sentence est arbitrale, il n’y a
pas de possibilité d’interjeter en appel.
Ce n’est jamais exclu de remettre en
question la décision devant un tribunal
spécialisé, mais c’est très rare dans ce
type de situation », explique-t-elle. Selon
MeClark, comme la décision ordonne à
l’employeur de modifier les horaires de
garde et que l’arbitre accorde un délai
maximum de six mois, un non-respect
de celle-ci serait considéré comme un
outrage au tribunal, entrainant des
amendes pouvant atteindre 50 000 $.
De son côté, le ministère de la Santé a ac-
cepté favorablement la décision de l’arbi-
tre et l’intègrera dans la négociation de la
nouvelle convention, assure la porte-pa-
role du ministre Yves Bolduc.
DDÉÉJJÀÀ 1166 HHEEUURREESS
Le délai d’application du nouvel horaire de
six mois est tout à fait raisonnable, selon le
Dr Dussault, d’autant plus que certains
départements dans plusieurs établisse-
ments de soins de la province fonctionnent
déjà avec des gardes de 16 heures, no-
tamment au Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CHUS). Quatre grands
secteurs fonctionnent de la sorte : pédia-
trie, soins intensifs, anesthésiologie et
médecine interne. Les résidents de la
pédiatrie ont adopté cette formule il y a 10
ans, indique le directeur des services pro-
fessionnels du CHUS, le Dr Stéphane Trem-
blay. « Le modèle n’est pas identique pour
les quatre secteurs, la structure est flexible,
explique-t-il. Ça ne prend pas beaucoup de
temps à mettre en place, mais la première
année est complexe à coordonner. La struc-
ture des stages influence tout. »
Ce dernier a instauré des stages de jour, de
8 h à 17 h, et de nuit, de 22 h à 8 h. La fin
de semaine, la façon de faire diffère selon
le département. « Le fil conducteur, c’est le
patient », affirme le Dr Tremblay.
3322SSaannttéé iinncc.. juillet / août 2011 juillet / août 2011 SSaannttéé iinncc.. 3333
EEnn pplleeiinnee nnééggoocciiaattiioonn ddee ccoonnvveennttiioonn ccooll--
lleeccttiivvee,, lleess mmééddeecciinnss rrééssiiddeennttss dduu
QQuuéébbeecc oonntt oobbtteennuu ccee qquuee llaa pplluuppaarrtt aatt--
tteennddaaiieenntt ddeeppuuiiss ttrrooiiss aannss :: cceesssseerr ddee
ffaaiirree ddeess ggaarrddeess ddee 2244 hheeuurreess eenn ééttaa--
bblliisssseemmeennttss eett aaccccééddeerr aauuxx ggaarrddeess ddee 1166
hheeuurreess.. DD’’iiccii ssiixx mmooiiss,, ttoouuss lleess ééttaabblliissssee--
mmeennttss ddee ssaannttéé ddee llaa pprroovviinnccee aauurroonntt
ddoonncc rrééoorrggaanniisséé lleeuurrss qquuaarrttss ddee ttrraavvaaiill.. SSii
lleess mmééddeecciinnss nn’’eenntteennddeenntt ppaass ssee llaanncceerr
ddaannss uunn tteell pprroocceessssuuss ééttaanntt ddoonnnnéé qquuee llee
ccoonntteexxttee qquuii lleess ccoonncceerrnnee ddiiffffèèrree,, cceerr--
ttaaiinnss yy vvooiieenntt uunnee oouuvveerrttuurree ppoouurr rreevveennddii--
qquueerr ddee mmeeiilllleeuurrss hhoorraaiirreess..
Le 7 juin, les résidents criaient victoire. L’ar-
bitre Jean-Pierre Lussier a déposé sa sen-
tence fondée sur une preuve qui
« démontre une atteinte à l’intégrité et à la
sécurité des résidents comme celle des pa-
tients ». Pour ces raisons, il y avait violation
de l’article 7 de la Charte canadienne des
droits et libertés et de l’article 1 de la Charte
des droits et libertés de la personne.
Dans sa décision, M. Lussier fait référence
aux recherches du docteur en médecine
et professeur de « sleep medecine » au
Harvard Medicine School de Boston,
Charles A. Czeisler, qui démontrent claire-
ment le danger relié aux longues gardes
qui empêchent de dormir suffisamment.
Non seulement les risques d’accident de
voiture suivant un quart de travail de 24
heures augmentent de 168 %, mais les
risques de quasi-accident augmentent
quant à eux de 468 %. Une autre étude
comparant le risque d’erreurs auprès des
patients, selon qu’un résident est soumis
à un quart de 24 heures ou de 16 heures,
démontre également qu’il y a 36 % de
plus de fautes majeures commises par le
premier que le second et 5,6 fois plus
d’erreurs diagnostiques.
En moyenne, aux soins intensifs, il y a
109 % d’erreurs d’inattention de plus et
36 % de fautes médicales importantes de
plus. Données à l’appui, l’étude établit à
464 % de plus les probabilités d’erreurs dia-
gnostiques de la part d’un résident travaillant
30 heures d’affilée qu’un autre travaillant 16
heures. Selon une autre recherche, un rési-
dent sur cinq a reconnu avoir commis une
erreur liée à la fatigue ayant causé du mal à
un patient lorsqu’il travaillait 24 heures ou
plus. Parallèlement, un résident sur 20 a re-
connu avoir commis une erreur causée par
la fatigue ayant entraîné la mort d’un patient.
Si 30 % des résidents ont voté contre le
grief déposé en 2009 parce qu’ils craig-
naient de voir leurs apprentissages en
souffrir, les recherches de M. Czeisler ont
encore une fois démontré que le manque
de sommeil pouvait affecter les notions ac-
quises. « Le sommeil a pour fonction, entre
autres, de consolider les apprentissages,
et la privation de sommeil a donc un im-
pact sur la rétention de nouvelles connais-
sances », peut-on lire dans la décision.
On y fait également une comparaison avec
différents pays. En Europe, depuis 2004,
les résidents ne peuvent travailler plus de
13 heures. En Nouvelle-Zélande, la limite
est de 16 heures. Aux États-Unis, il n’y a
pas de limite légale, mais l’ACGME fixe
celle-ci à un maximum de deux quarts de
30 heures et de 80 heures par semaine.
ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN AATTTTEENNDDUUEE
Le président de la Fédération des
médecins résidents du Québec (FMRQ),
le Dr Charles Dussault, déplore que le li-
tige déclaré par l’Association des médecins
résidents de McGill contre le Centre uni-
versitaire de santé McGill (CUSM) ait pris
trois ans à aboutir. « Ça aurait dû se régler
beaucoup plus tôt, mais c’est un bel ac-
complissement et une excellente nouvelle
pour les médecins et les patients. C’est
une évolution, du progrès », s’est-il réjoui.
RÉSIDENTS
LES MÉDECINS SUIVRONT-ILS LEUR EXEMPLE?
PAR STÉPHANIE SAUCIER
STEPHANIE_SAUCIER@LIVE.CA
LES RÉSIDENTS
AURONT DES GARDES
DE 16 HEURES

Pour le Dr Dussault, il existe en effet
plusieurs modèles possibles, dont un sys-
tème par quart basé sur les besoins et les
services. Certains feront quelques se-
maines ou des mois répartis sur des
quarts de nuit afin de pouvoir inverser leur
cycle de sommeil. « L’avantage, dit-il en
citant la décision, est que les résidents
seront là tous les jours de la semaine au
lieu d’être absents le lendemain. » Ce
dernier point représente un gain en ter-
mes de suivi des patients. Une résidente
en quatrième année de résidence en
médecine interne au CUSM, a elle-même
vécu un changement de garde de 24 h à
16 h : « D’une part, elle se sentait plus
éveillée et mieux habilitée à faire son tra-
vail de nuit. D’autre part, ce nouveau sys-
tème enlevait l’obligation d’être en congé
le lendemain d’une garde, de sorte qu’elle
connaissait mieux les patients dont elle
s’occupait », est-il écrit dans la décision.
MMÉÉDDEECCIINNSS «« PPRRÉÉOOCCCCUUPPÉÉSS »»
Si les médecins ont, quant à eux, des
gardes de 24 heures à la maison, il ar-
rive régulièrement qu’ils passent une
majorité de ce temps en établissement.
« Nous sommes préoccupés par ces
longues heures de travail. On essaie
d’aménager l’horaire le mieux possible
pour qu’il soit vivable et sécuritaire, mais
c’est un travail de longue haleine »,
souligne le Dr Louis Godin.
Il indique que certaines situations retien-
nent les médecins pendant 24 heures à
l’hôpital et qu’il faut s’assurer que le ser-
vice soit bien rendu. « Il faut tenir compte
de la réalité locale, ça dépend des
secteurs, des situations, de l’intensité de
la tâche », indique celui qui écarte toute-
fois un projet de loi qui plafonnerait à 16
heures la durée des gardes.
Le Dr Stéphane Tremblay, du CHUS, af-
firme que la différence entre une garde sur
place et une garde à domicile est trop dif-
férente pour envisager une démarche
similaire à celle des résidents. L’organisa-
tion du travail de ces derniers, qui ont une
obligation de formation, constitue égale-
ment un aspect distinct entre les deux situa-
tions. « Je ne dis pas que la question ne
se pose pas. La décision est un argument
de plus dans le dossier, mais un médecin
est responsable du patient et doit assurer
une continuité des soins », soutient-il.
Mis côte à côte, le contrat de travail d’un
médecin et la convention d’un médecin
résident ont une différence majeure. « Les
modalités permanentes obligent un
médecin à faire des gardes, même si, sou-
vent, elles ne se font pas sur place, indique
Christine Clark. Il a des droits et des obliga-
tions, mais aussi des privilèges. En onze ans
de pratique, je n’ai, de toute façon, jamais
vu un règlement qui oblige les médecins à
faire des gardes de 24 heures. »
Concédant qu’il existe des conflits en mi-
lieu hospitalier par rapport aux modalités
de garde, Christine Clark affirme que les
médecins ont accès à des recours. Si un
centre hospitalier oblige à faire des gardes
de 24 heures, le médecin peut se désister
en invoquant certaines clauses du code
déontologique. L’une d’entre elles stipule
qu’il doit « agir selon ses capacités et les
méthodes dont il dispose dans le respect
de ses limites ». L’autre, qu’il doit « s’abs-
tenir d’exercer sa profession dans des cir-
constances qui pourraient compromettre
la qualité des soins ».
La décision de l’arbitre Jean-Pierre Lussier
devient également une possibilité de faire
valoir les mêmes motifs pour un médecin
qui se présente devant un tribunal ad-
ministratif ou de droits communs. « Il a de
bonnes chances d’avoir les mêmes gains
de cause que les résidents, en évoquant
les mêmes articles des chartes des droits
et libertés », ajoute Mme Clark. ⌧
juillet / août 2011 SSaannttéé iinncc.. 3355
Le Dr Charles Dussault
1
/
2
100%