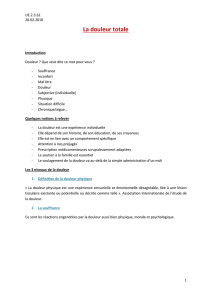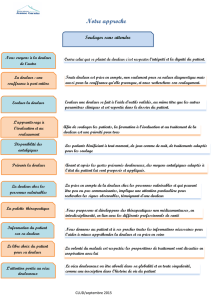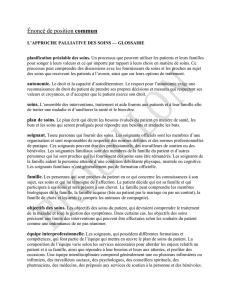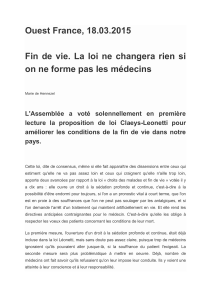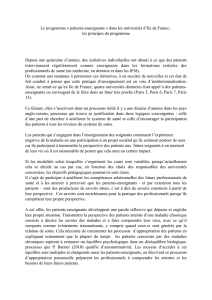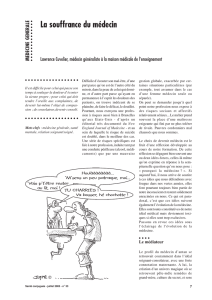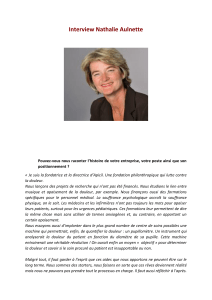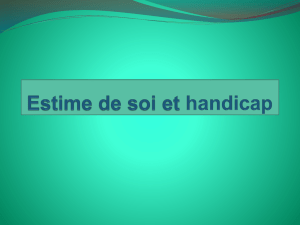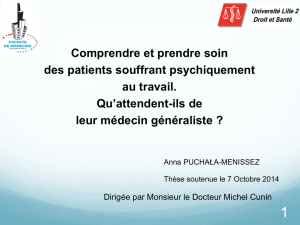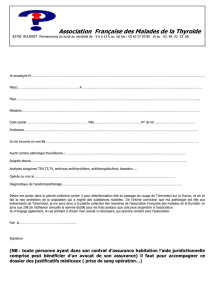DOULEUR ET SOINS INFIRMIERS

i-2,
/=
>i
=.
_
avec David LE BRETON
(1)
8_
:
:**
"
i,,,,.
Sociologue, Professeur à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg II.
DOULEUR ET SOINS INFIRMIERS
L’hospitalisation est, en principe, une expérience rare
à laquelle nul n’est préparé. Pour la plupart des indivi-
dus elle est l’équivalent de l’entrée en une terre étran-
gère dont ils ne parlent pas la langue et ignorent les
usages. Même l’anthropologue est contraint, en son
propre pays, à un effort d’appropriation, à une longue
patience avant de démêler quelques fils. Celui qui
franchit le seuil de l’hôpital se voit dépouillé de ses
valeurs propres, de son rapport intime à soi et de ses
manières traditionnelles d’être avec les autres. II entre
dans une parenthèse de son histoire. Mis à nu, en
position horizontale, privé de toute autonomie, dépen-
dant d’une volonté extérieure, souffrant ou angoissé
par ses maux, il est contraint à un compromis avec son
sentiment d’identité.
II s’en remet en effet à une institution qui le transforme
dans l’ensemble de ses faits et gestes, en
«
patient »,
modifie son statut social, lui impose un emploi du
temps et des interactions dont il n’a pas la maîtrise. La
conduite de son existence lui échappe et le confronte
parfois à des situations invraisemblables dans la vie
quotidienne : qu’on ne réponde pas à ses questions
angoissées, qu’on le traite comme un enfant capri-
cieux, ou trop exigeant, etc. L’hospitalisation ne signi-
fie pas seulement une diminution considérable de
l’autonomie personnelle de la conduite ou le dé-
pouillement des rôles successifs qui jalonnent d’ordi-
naire sa vie quotidienne, elle implique surtout un mode
de gestion totale de l’individu pendant la durée de son
séjour.
Les règles et les usages s’imposent à l’usager à la
manière d’une culture hermétique dont les éléments se
dévoilent un à un, jalousement gardés, malgré les ef-
forts du patient qui doit conquérir parfois de haute lutte
le droit pourtant élémentaire d’être informé de façon
intelligible sur son état et le contenu de la médication
reçue ou de l’examen réalisé. Une succession de pro-
fessionnels se relaient à son chevet dont il peine à
identifier la fonction ; il est amené à décrire plusieurs
(1)
David LE BRETON est sociologue, professeur à l’université des
sciences humaines de Strasbourg II. Auteur notamment de Anthro-
pologie du corps et modernité
(PUF),
Des visages : essai d’anthro-
pologie, (Métailié), fassions du risque (Métailié), Anthropologie de
la douleur (Métailié).
-i
.-
1
fois ses symptômes à des interlocuteurs différents, à
subir les mêmes examens parfois pénibles, avec un
irritant manque de coordination. Les ritualités de I’hô-
pital confrontent l’usager à un apprivoisement malaisé
de son organisation et de son langage. La langue est
imprégnée d’un jargon qui lui échappe, elle est ésoté-
rique, inquiétante, elle se dérobe à tout effort de com-
préhension, une langue définitivement étrangère pour
qui n’a pas la chance de trouver sur son chemin un
interprète obligeant.
L’hospitalisation introduit l’ensemble des patients, in-
dépendamment de leur origine ou de leurs références
sociales et culturelles, à un lieu et à une durée hors de
toute familiarité. La médecine est une culture savante
fortement éloignée des significations que vivent ou que
peuvent s’approprier une majorité des usagers. L’hôpi-
tal est une sorte de huis-clos structuré autour de la
logique médicale, et fonctionnant avec ses repères
propres qui ne sont pas ceux des profanes. Indifférent
aux références sociales, culturelles, religieuses ou per-
sonnelles des patients, l’hôpital tend à uniformiser les
soins, à négliger ou à sous-estimer les singularités liées
à l’histoire ou à l’origine du malade.
Le savoir médical est un savoir sur l’organisme, il fait
de l’individu un double sans importance. La médecine
repose sur une étude rigoureuse du corps et de sa
biologie, mais en détachant celui-ci d’un homme sou-
vent perçu comme un intrus avec lequel le médecin
doit composer (le rituel de la visite médicale en est
parfois un exemple sinistre). La maladie n’est pas tou-
jours perçue ou traitée comme la souffrance propre
d’un individu inscrit dans une société et en un temps
donné, mais plutôt comme la faille anonyme d’une
fonction ou d’un organe. L’homme lui même est atteint
par ricochet sans être directement en cause. Pour
mieux agir sur la maladie (et souvent avec efficacité) la
médecine
«
dépersonnalise
»
la maladie. La médecine
hospitalière néglige souvent l’épaisseur de l’homme, sa
condition sociale et culturelle, son cheminement per-
sonnel, son contexte familial ou relationnel, son an-
goisse, pour considérer essentiellement le
«
méca-
nisme corporel
»
qu’il donne à voir à l’examen du
médecin ou à celui des techniques d’imagerie. Cette
conception conduit d’ailleurs le malade à se déposer
passivement entre les mains du médecin et à attendre
Recherche en soins infirmiers
No
53
-
Juin 1998

ENCONTRE
DOULEUR ET SOINS INFIRMIERS
que le traitement reçu fasse son effet. Sa pathologie est
autre chose que lui, son effort pour guérir, sa collabo-
ration active ne sont pas toujours considérés comme
essentiels. On lui demande justement d’être patient,
c’est-à-dire passif et docile, confiant dans le mécani-
cien qui le soigne et non d’être partie prenante dans le
processus de la cure.
L’attention au malade est donc secondaire mais peut-
on le soulager de sa souffrance de façon purement
technique, en le mettant entre parenthèses pour ne
s’occuper que de l’organe malade
(2).
Selon son ori-
gine sociale et culturelle, sa singularité propre, tout
patient possède de surcroît un savoir profane sur sa
maladie, sur la manière dont celle-ci est apparue, son
évolution, les manières efficaces de la traiter ou d’en
soulager les symptômes, l’efficacité comparée des trai-
tements, etc. II possède une représentation de son
corps, de sa pathologie, des astuces qui le libèrent, etc.
II recourt peut-être simultanément à d’autres formes
thérapeutiques (traditionnelles ou médecines douces),
parallèlement au traitement médical, dont il parle ou
non aux infirmières selon le degré de confiance qu’il
leur accorde. Sa maladie le renvoie à une signification
intime qu’il cherche ou qu’il connaît déjà, une interpré-
tation profane de son mal avec laquelle il vit le quoti-
dien de sa souffrance. En méconnaissant ces données
la médecine soigne sans doute plus ou moins bien un
organe ou une fonction altérés, mais si elle passe à côté
de l’homme vivant, elle se prive d’un vecteur thérapeu-
tique fondamental qui consisterait à soigner un homme
souffrant dans la reconnaissance de ce qu’il est, et des
valeurs qui fondent son rapport au monde. L’exemple
de la douleur, abordé ici de manière très générale,
montrera l’impératif de prendre en considération le
malade dans toutes ses composantes pour le soulager
efficacement.
La douleur n’est pas un fait physiologique, mais
d’abord un fait d’existence. Ce n’est pas le corps qui
souffre mais l’individu en son entier. En éprouvant sa
douleur le sujet n’est pas le réceptacle passif d’un
organe spécialisé obéissant à des modulations imper-
sonnelles dont seule la physiologie pourrait rendre
compte. D’une condition sociale et culturelle à une
autre, et selon leur histoire personnelle, les hommes ne
réagissent pas de la même manière à une blessure ou à
une affection identique. Leur expressivité n’est pas la
même, ni sans doute leur seuil de sensibilité. Toutes les
sociétés définissent implicitement une légitimité de la
douleur qui anticipe sur des circonstances réputées
(2)
Sur l’ensemble des points esquissés ci-dessus, cf. D. LE BRE-
TON, Anthropologie du corps et modernité, PUF,
3e
éd. 1995.
physiquement pénibles. Une expérience cumulée du
groupe amène d’emblée à une attente de la souffrance
coutumière imputable à l’événement. Une intervention
chirurgicale ou dentaire, un accouchement, une bles-
sure suscite les commentaires avertis de ceux qui sont
déjà passés par là ou connaissent
«
quelqu’un qui...
»
Chaque expérience, chaque maladie, chaque lésion est
associée à une marge diffuse de souffrance. L’expres-
sion individuelle de la souffrance se coule au sein de
formes ritualisées. Quand une souffrance affichée pa-
rait hors de proportion avec la cause et déborde le
cadre traditionnel, on soupçonne la complaisance ou
la duplicité. Là où il est de rigueur d’endurer sa peine
en silence, l’homme submergé qui donne libre cours à
la plainte encourt la réprobation. Cette entorse à la
discrétion habituelle suscite des attitudes opposées à
celles souhaitées par le malade : la compassion cède le
pas à la gêne. A l’inverse, là où la ritualisation de la
douleur appelle la dramatisation, on comprend mal
celui qui intériorise sa peine et ne souffle mot à per-
sonne. La plainte, en même temps qu’elle traduit la
souffrance, a aussi valeur de langage qui confirme
l’entourage dans le bien fondé de sa présence. La
capacité du malade à affronter seul son épreuve, sans
montrer sa peine, tranche avec les pleurs ou l’anxiété
habituellement de rigueur. L’entourage est frustré dans
son souci de prodiguer consolation et soutien. La dou-
leur a ses rites d’expression que l’on ne transgresse pas
sans le risque d’indisposer les bonnes volontés
(3).
La culture modèle les comportements jusqu’à un cer-
tain point mais il ne faut pas la transformer en stéréo-
type venant briser la singularité du malade. Une en-
quête pionnière de Mark ZBOROWSKI, au début des
années cinquante, montre clairement la ritualisation
culturelle de la douleur
(4).
Ses résultats sont au-
jourd’hui dépassés, mais sa valeur de démonstration
demeure. Dans un hôpital du Bronx, à New York, il
interroge 242 sujets, parmi lesquels 146 malades. Es-,
sentiellement des hommes. II distingue quatre popula-
tions : les malades d’origine italienne (du sud), juive,
irlandaise et de
«
vieille souche américaine
»
(c’est son
expression). Les malades italiens sont davantage con-
cernés par l’immédiateté de la douleur que par le
trouble organique qu’elle manifeste. Lorsque celle-ci
est calmée par les analgésiques, leurs plaintes cessent,
et ils retrouvent vite leur bonne humeur. Au contraire,
pour les malades de tradition culturelle juive ces anal-
gésiques soulagent en surface une douleur qui vaut
pour la pathologie dont elle est le signe : vers celle-ci
(3) Cf. D. LE BRETON, Anthropologie de
/a
douleur, Paris, Métai-
lié, 1995.
(4) M. ZBOROWSKI,
People
in pain, Jossey-Bass, 1969.
Recherche en soins infirmiers
N”
53 -Juin 1998

DOULEUR ET SOINS INFIRMIERS
vont leur appréhension. Le malade d’origine italienne
vit dans le présent et appelle le soulagement d’une
douleur qui tend, à ses yeux, à devenir le tout de la
maladie. Le malade de tradition juive, orienté vers
l’avenir, craint pour le recouvrement de sa santé.
L’apaisement de sa douleur n’est à ses yeux qu’un
épisode dans la lutte contre la maladie, et sans doute
pas le plus important. Ces deux cultures favorisent la
libre expression des sentiments par la parole ou le
geste, les malades italiens et juifs se sentent libres de se
plaindre. Manière de solliciter l’attention et de se ras-
surer, et mode de renforcement de la présence des
proches qui ne quittent guère le malade. La souffrance
se dit car elle est écoutée et justifie l’entourage de son
affection. Les malades américains observent avec dé-
dain ces manifestations. Ce ne sont pas là à leurs yeux
des manières d’hommes. Avant d’interroger le médecin
sur les raisons de leur douleur, ils attendent et ne se
résolvent à consulter qu’en dernier recours. Ils ne se
plaignent pas, s’efforcent d’être coopératifs et de déran-
ger le moins possible. Toute émotivité est perçue
comme gênante, diminuant l’estime de soi. Selon eux
«
il ne sert à rien de gémir ou de se lamenter sur son
sort
».
Le patient irlandais, catholique, témoigne de la
même retenue, d’une égale capacité de résistance. II
préfère l’isolement quand la souffrance le taraude : la
famille n’est pas, dans ce contexte, une communauté
de protection et de reconnaissance de soi. II ne sollicite
guère des soignants des moyens de soulagement. La
douleur est son affaire. Ce qu’il ne supporte pas, ce sont
les conséquences d’une maladie qui le prive de ses
activités habituelles.
ZBOROWSKI rappelle comment le conditionnement
familial, l’influence notamment de la mère, amène les
individus à des comportements relativement prévisi-
bles au sein de groupes culturellement homogènes. Ces
travaux doivent aujourd’hui être nuancés, ils donnent
l’image d’une époque, et non le témoignage de I’éter-
nité.
Ils tendent à gommer les disparités de classe, et
même de culture (le rapport à la douleur est nettement
différent dans le nord de l’Italie) homogénéisant trop les
attitudes collectives. Ils valent surtout comme exem-
ples significatifs à une période de l’histoire de la dimen-
sion sociale et culturelle de la douleur. Le paysage
social d’aujourd’hui diffère de celui des années cin-
quante avec ses populations récemment migrantes et
toujours attachées à un certain nombre de valeurs et de
comportements. Si les traits décrits par ZBOROWSKI
n’ont sans doute pas entièrement disparus, ils s’estom-
pent au fur et à mesure de l’intégration sociale et
culturelle de ces populations et ne demeurent plus
guère que pour les sujets les plus âgés. Des travaux
menés par d’autres chercheurs, aux USA ou ailleurs,
montrent également la dimension culturelle de
I’ex-
pressivité et du ressenti de la douleur (5).
ASPECTS SOCIOLOGIQUES
Les conditions sociales d’existence influencent égale-
ment le rapport à la douleur. Pour les sans abri, les
jeunes en errance, le désinvestissement de soi, la perte
de toute ressource, l’absence de domicile où recons-
truire son identité, le sentiment de rejet et d’abandon,
amènent au mépris du corps, ou à l’indifférence. Les
écorchures, les plaies, les caries, les infections, ne sont
pas soignées, la douleur n’étant qu’un ajout à une
déroute personnelle déjà consommée. Les médecins et
les infirmières qui leurs prodiguent des soins sont sou-
vent effarés des maux qu’ils découvrent. La souffrance
morale anesthésie parfois la douleur physique. Mais
dans la déroute d’une existence il suffit parfois d’un
mot, d’un geste, d’un soin, d’un sourire pour restaurer
une dignité qui ne se tisse que que dans les yeux de
l’autre. Que le malade ne se plaigne pas ne signifie pas
qu’il ne souffre pas. Une détresse personnelle imprègne
chaque parcelle de son corps et paraît le rendre inac-
cessible. Mais ces soins ingrats sont le lieu quelquefois
de retrouvailles avec le sens, avec la reconnaissance de
soi portée par une parole amicale et attentive du soi-
gnant, des gestes qui rétablissent le confort de la rela-
tion au corps.
Dans les milieux sociaux les plus démunis, par une
nécessité sociale devenue seconde nature,
«
on est dur
au mal
».
Nécessité fait loi et s’impose comme une
forme de valorisation de soi et d’affirmation de dignité
devant l’adversité. Le sentiment d’impuissance éprouvé
devant une société où l’on peine à trouver sa place, est
relayé ici par une forme de revanche prise sur son
propre corps devenu lieu de souveraineté personnelle.
Les blessures, les pathologies internes sont assumées
comme un désagrément dont on s’accommode selon
une morale culturelle qui se transforme parfois en dé-
monstration d’excellence. II faut que l’intensité de la
(5)
1.
ZOLA, Culture and symptoms. An analysis of patients presen-
ting complaints, American Sociological Review,
no
31, 1966 ;
C. KOOPMAN et a/., Ethnicity in the reported pain, emotional dis-
tress and requests of
medical
outpatients, Social Science and Medi-
cine,
vol 18,
no
6, 1984. Une discussion de ces textes inauguraux
et un.élargissement dans un cadre plus contemporain in P. AiACH,
D. CEBE, Expression des symptomes et conduites de maladie. Fac-
teurs socio-culturels et méthodoiogiques de différenciation, Doin,
1991.
,i
<jCL_
*+;
;pmi
* * 2 *.-i
ii
=
a
-.
_
--
:
19
-.j_---
i
1
i
<
i
.<-
.-.-
if.,.
/....
i
<e,‘”
/>
I
Recherche en soins infirmiers
N”
53
-
Juin 1998

douleur entrave péniblement l’exercice de la vie quo-
tidienne pour mériter l’attention. L’appréciation des
maux est référée aux tâches habituelles du jour, elle
n’englobe pas la longue durée qui pourrait associer au
symptôme éprouvé un signe néfaste.
Dans les milieux ouvriers on vit souvent avec la gêne
tant qu’elle n’altère pas en profondeur la relation au
monde.
«
Ça finira bien par passer
».
II n’est pas
Iégi-
time de
«
trop s’écouter
».
On
«
prend sur soi
»
plutôt
que de perdre une journée de travail et de consulter le
médecin. Longtemps le fait de ne jamais demander
d’arrêt de travail fût une fierté du monde ouvrier, un
signe de résistance et de force. Mais l’avancée des
valeurs de la modernité amène à une moindre tolé-
rance au mal. Les généralistes sont maintenant saisis de
demandes d’arrêt de travail plus fréquentes au regard
de symptômes qui n’auraient pas empêché l’ouvrier
des années soixante de se rendre à sa tâche. La trans-
formation du travail, de valeur relativement unanime
en obligation sociale, même si cette mutation n’est pas
absolue, a affaibli les anciennes valeurs ouvrières de
résistance à la fatigue, d’endurance à la peine, et de
négligence face à sa santé. La distance entre la culture
ouvrière et le recours médical est également bien moin-
dre aujourd’hui.
Dans les milieux ruraux populaires la dureté au mal
s’appuie sur des impératifs économiques et surtout sur
une organisation exigeante du labeur quotidien. Les
travaux de la ferme n’autorisent guère le loisir ou la
complaisance au mal quand il faut traire les vaches,
donner à manger aux animaux, et gérer le temps des
semailles ou des récoltes. Laurence WYLIE parle d’atti-
tude
«
spartiate
»
des habitants d’un village du Vau-
cluse. Là, plutôt que de maladie on parle de
«
fatigue
».
Propos révélateur :
«
on est
«
fatigué
»
quand on n’a
plus la force de travailler et qu’on doit se mettre au
lit
»
(6).
Dans les couches sociales moyennes, et surtout privilé-
giées, la distinction entre santé et maladie n’a pas ce
caractère tranché. La relation au corps est faite d’une
attention aiguisée, en prise sur les conseils dispensés
par la médecine. La maladie jette des signes avant
coureurs qu’une perception du corps accoutumée re-
connaît d’emblée, favorisant l’adoption d’une attitude
préventive. Toute douleur est traitée à son émergence.
L’attention aux affections morbides montre un seuil
nettement inférieur à celui des autres milieux sociaux.
(6) Laurence WYLIE, Un village du Vaucluse, Gallimard, 1979,
p.
224.
CONTRE LES STÉRÉOTYPES CULTURELS
On ne peut cependant verser la douleur et ses manifes-
tations au seul crédit de la culture ou de la condition
sociale. Celles-ci n’existent qu’à travers les hommes
qui les vivent
(7).
La culture ne s’impose pas comme
une structure massive à des acteurs conditionnés. D’au-
tres influences introduisent des ruptures et des conti-
nuités : cultures régionales et locales, rurales et urbai-
nes, différences de génération, de sexe, etc. Chaque
homme s’approprie les données de sa culture ambiante
selon son histoire personnelle et les rejoue selon son
style. La relation intime à la douleur ne met pas face-à-
face une culture et une lésion, mais immerge dans une
situation douloureuse particulière un homme dont
l’histoire est unique même si la connaissance de son
origine de classe, de son appartenance culturelle, de sa
confession, donnent des indications précieuses sur le
style de ses réactions. Dans la pratique soignante l’in-
différence aux origines sociales et culturelles du ma-
lade n’est pas une erreur moindre que celle de le
réduire à un stéréotype de sa culture ou de sa classe :
manière commode et brutale d’élaguer la complexité
des choses en une poignée de recettes, en un répertoire
de prêt-à-penser et à agir. En éprouvant sa douleur le
sujet n’est pas le réceptacle passif d’un organe spécia-
lisé obéissant à des modulations impersonnelles dont
seule la physiologie pourrait rendre compte. La ma-
nière dont l’homme intériorise sa culture, les valeurs
qui sont les siennes, le style de son rapport au monde,
les circonstances particulières où il est plongé, compo-
sent un filtre spécifique dans son appréhension de la
douleur. Face à la douleur, les différences rencontrées
au sein d’une même culture sont parfois plus marquées
que celles qui distinguent les cultures entre elles sous
ce même rapport. Les soins doivent en tenir compte
sans réduire l’usager à un stéréotype, prendre en charge
l’usager en étant attentif à sa plainte sans lésiner sur les
moyens de le soulager.
L’infirmière ne doit évidemment pas juger de ces com-
portements, mais les accueillir dans leur différence, et
veiller seulement à ce qu’ils n’entravent pas la démar-
che de soins. De même que le médecin sa tâche est de
répondre à la plainte sans présumer de son intensité,
sans projeter ses propres valeurs et ses propres
compor-
(7) La signification que l’individu confère à sa douleur est égale-
ment une donnée essentielle du conditionnement de son ressenti,
cf HK. BEECHER, Relationship of significance of wound to the pain
experienced, /oufna/ of American Medical Association,
no
161,
1956 ; D. LE BRETON, Anthropologie de
/a
douleur, Paris, Métai-
lié, 1995, 139 sq.
20
Recherche en soins infirmiers
N”
53 -Juin 1998

DOULEUR ET SOINS INFIRMIERS
tements pour juger de l’attitude de l’autre. En ce qui
concerne la douleur, elle contribue avec l’équipe soi-
gnante au soulagement du patient sans prétendre savoir
mieux que lui ce qu’il doit ressentir. De nombreux
travaux pointent à cet égard une fréquente sous-évalua-
tion de la douleur des patients chez les soignants.
L’homme en bonne santé et actif est mal placé pour
juger de la souffrance de l’autre, il risque la projection
de sa psychologie propre au détriment du patient. II
convient de soigner l’homme en tant qu’homme, dans
sa singularité. La qualité des soins ne saurait être dimi-
nuée sous prétexte que certaines catégories sociales
seraient plus endurantes que les autres. Tous les usa-
gers doivent bénéficier des recours antalgiques appro-
priés, selon l’intensité et la nature de leurs maux. Le
stéréotype culturel empêche parfois d’entendre et de
soulager la douleur. La tendance des soignants à
sous-
évaluer la douleur de leurs patients et à minorer les
traitements antalgiques, s’appuie parfois sur ces préju-
gés (le
«
syndrome méditerranéen
»,
par exemple). Or,
ce ne sont pas seulement les malades qui intègrent leur
douleur dans leur vision du monde, mais également les
médecins ou les infirmières qui projettent leurs valeurs,
et souvent leurs préjugés, sur ce que vivent les patients
dont ils ont la charge. Une expérience classique à ce
propos : 554 infirmières de même spécialité, homogè-
nes en expérience, en âge, des Etats-Unis, du Japon, de
Taiwan, de Thaïlande, de Corée et de Puerto-Rico,
évaluent la somme de douleur et de détresse psycholo-
gique associée à une même série de symptômes ou de
lésions connues. Les moyennes obtenues par les grou-
pes respectifs varient considérablement. Chacun, con-
vaincu pourtant de se référer à un savoir objectif, a
réagi à son insu selon ses traditions culturelles. Les
infirmières japonaises et coréennes voient une forte
souffrance là où, à l’inverse, pour les mêmes maux, les
infirmières américaines notent de bien moindres dou-
leurs. L’évaluation des symptômes, la compassion, et
les soins prodigués, s’enracinent dans des visions du
monde distinctes les unes des autres
(8).
Déjà ZBO-
ROWSKI dénonçait les propos des médecins considé-
rant comme
«
exagérées
»
les attitudes face à la souf-
france des malades italiens ou juifs sans comprendre la
violence de leur jugement de valeur. Le milieu médi-
cal, écrit ZBOROWSKI,
«
tend vraiment à minimiser la
douleur effective du malade italien et juif sans se sou-
cier de savoir s’il détient les critères objectifs pour
évaluer le degré réel de la souffrance. II semble que les
réactions de ces malades provoquent méfiance et non
(8)
L.J. DAVITZ, Y. SAMESHIMA,
J.
DAVITZ, Suffering as viewed
in six different cultures, American journal of
nursing,
vol. 76, 1976,
1296-7.
compassion dans la civilisation américaine
»
(9).
La
douleur ne se prouve pas, elle s’éprouve. Seule est
souveraine la parole du patient sur son ressenti. S’il dit
qu’il souffre, nul n’est en position d’en douter ou de
minimiser sa peine, et il doit recevoir le soulagement
qu’il réclame. Comme le souligne René
LERICHE
«
la
seule douleur supportable, c’est la douleur des au-
tres
».
SPÉCIFICITÉ DES SOINS
AUX PERSONNES TRAUMATISÉES
Pour la personne qui survit à un traumatisme : agres-
sion, attentat, torture, etc., tout rappel de l’événement
éveille la douleur subie, l’effraction identitaire, la honte
d’avoir été soumis à un tel traitement. La culpabilité
d’avoir survécu tandis que d’autres mouraient est éga-
lement une plaie qui peine à se refermer comme le
montre par ailleurs les survivants des camps de la mort.
Longtemps le survivant ne supporte pas les situations
associées au drame : nudité, contacts corporels, sons,
odeurs, etc. Les soins impliquent une prise en charge
globale et un aménagement constant de leur mise en
œuvre selon ses réactions. Tout examen médical qui
rappelle la situation traumatisante provoque l’angoisse
et le refus. L’appréhension l’emporte sur la conscience
d’une sécurité morale et affective, et même d’une atten-
tion chaleureuse. Un exemple : une femme souffre de
terribles maux de tête consécutifs aux coups reçus.
Torturée, elle a été isolée plusieurs mois dans un réduit.
Une
scanographie
exige qu’elle soit couchée sur un
chariot dans une salle de radiographie. La jeune femme
est longuement préparée, mais le moment venu, à
l’approche de la salle son anxiété grandit et un violent
mal de tête s’empare d’elle. Elle ne peut aller au bout
malgré les raisonnements qu’elle se fait. Après une
psychothérapie de plusieurs mois, elle se laisse enfin
examiner sans souffrance. Les explorations médicales
des orifices corporels rappellent les violences sexuelles
subies :
otoscopies, rectoscopies, gastroscopies, exa-
mens gynécologiques, etc. Les examens dentaires sou-
lèvent les mêmes appréhensions chez ceux qui ont
souffert de sévices liées à la bouche ou aux dents. La
vue du sang, lors d’un prélèvement sanguin, par exem-
ple, amène parfois des réactions violentes, des éva-
(9)
M. ZBOROWSKI, feople in pain, op. cif., p. 133. D. LE BRE-
TON, Anthropologie de /a douleur, op. cit., p. 136 sq. ; voir aussi
P.-J. CATHÉBRAS, Douleur et cultures : au-delà des stéréotypes,
Santé, Culture,
/-/ea/th,
vol. X, 1993-l 994.
21
Recherche en soins infirmiers
No
53
-
Juin 1998
 6
6
 7
7
1
/
7
100%