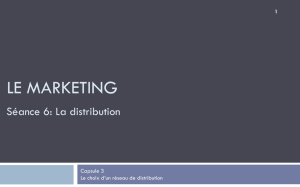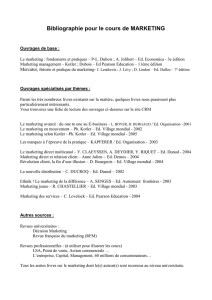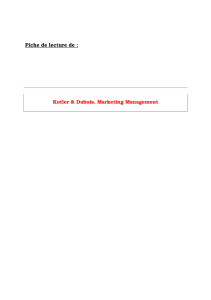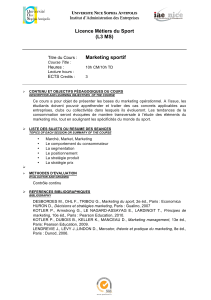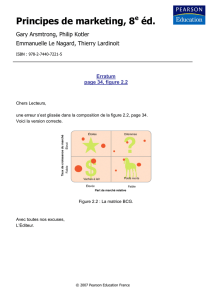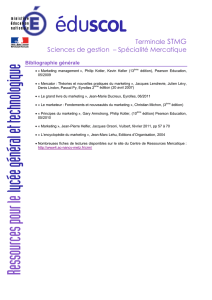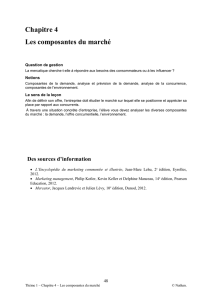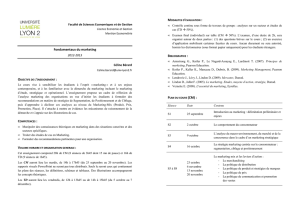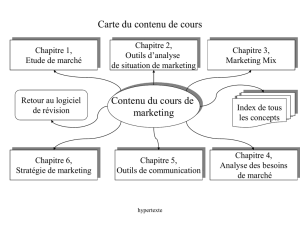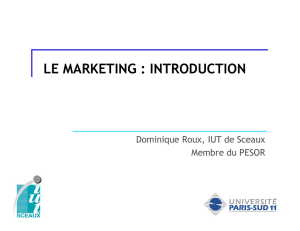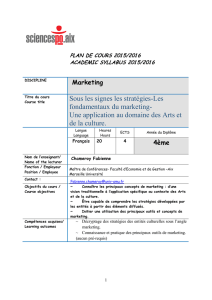Le marketing public

Le marketing public Page 5
Marine Le Gall-Ely pour e-theque
Introduction - L’extension du champ d’application de la démarche
marketing au domaine public
Si le commerce est très ancien, le MARKETING est un concept
beaucoup plus récent. Il s’est développé dans la première partie du
20ème siècle en tant que pratique et en tant que théorie.
Littéralement, ce terme anglo-saxon signifie mise en marché. Sa
traduction française, la mercatique, est assez peu utilisée. La démarche
de marketing consiste :
• à étudier le marché et à s’y adapter, ceci par l’étude des
comportements des consommateurs et par le choix d’une stratégie
adaptée (segmentation, positionnement, ciblage),
• et à définir des moyens d’action sur le marché, les politiques de
produit, prix, distribution et communication.
Initialement, c’est dans les entreprises produisant des biens de grande
consommation (détergents, alimentation, cosmétiques) que la conception
moderne du marketing est apparue et s’est imposée [COCHOY, 1999 ;
MEULEAU, 1988].
Très rapidement, dans la pratique, le champ d’application du marketing
s’est élargi, franchissant les limites de son domaine d’élection. Il s’est
progressivement étendu au secteur des biens semi-durables
(automobile, électroménager, meubles) et à celui des services destinés
au grand public : banque, voyages et tourisme, biens culturels (disques,
livres, spectacles, etc.) et entreprises de distribution (grands magasins,
hypermarchés, chaînes de magasins à succursales, etc.). Les
producteurs de biens industriels (équipement, machines, informatique,
etc.) se sont ouverts plus tardivement à la conception du marketing,
mais sont désormais de plus en plus nombreux à le pratiquer. On parle
alors de marketing interorganisationnel, industriel ou Business to
Business (BtoB).
Théoriquement, le marketing a longtemps semblé ne pas pouvoir
d’appliquer aux organisations n’ayant pas une vocation commerciale ou
lucrative [BARTELS, 1968]. Pourtant, beaucoup d’organisations de ce
type ont adopté très tôt les méthodes du marketing.
Dès le lendemain de la seconde guerre mondiale, les partis politiques ont
pratiqué le marketing électoral ou politique. Puis les organisations
sociales, philanthropiques, caritatives et religieuses ont également fait
appel aux outils du marketing pour tenter de changer des habitudes du
A l’origine, le
marketing semble
ne pas pouvoir être
appliqué dans les
organisations non-
marchandes…

Page 6 Le marketing public
Marine LE GALL-ELY pour e-theque
public (organisations contre l’alcoolisme ou le tabagisme), pour obtenir
des dons (Unicef, La Croix Rouge) ou pour attirer des fidèles (églises).
Enfin, les pouvoirs publics, les collectivités locales et les
administrations se sont mises, elles aussi, à l’heure du marketing tout
d’abord par le biais de la communication dans les années 70 : campagnes
gouvernementales pour les économies d’énergie, pour la sécurité
routière ou pour l’emploi des jeunes, actions menées par des
municipalités pour attirer des industriels.
Parallèlement au développement des pratiques marketing, les
chercheurs se sont efforcés de concevoir une théorie du marketing
[LICHTENTHAL et BEIK, 1984 ; COCHOY, 1999 ; HUNT, 2002, 2003].
A partir de débats qui ont lieu en 1965 à l’Université de l’Ohio
(rapportés par HUNT en 1976), des articles fondateurs de KOTLER et
LEVY [1969a] et de LAZER [1969] et de la controverse qui s’ensuit
[LUCK, 1969 ; KOTLER et LEVY, 1969b ; KOTLER, 1972 ; TUCKER,
1974]1, l’extension du champ d’application du marketing au domaine non
marchand est tenue pour acquise.
…mais rapidement
l’extension du
champ
d’application de la
démarche est
tenue pour
acquise par les
praticiens et les
chercheurs.
Se développent alors des réflexions théoriques sur le marketing
politique ou électoral [PIOTET, 1974 ; LINDON et WEIL, 1974], sur le
marketing social [KOTLER et ZALTMAN, 1971 ; SERRAF, 1976 ;
KOTLER et FOX, 1980 ; MOLINA, 1984], sur le marketing des
organisations à but non lucratif [FLIPO, 1985], sur le marketing des
églises [FLIPO, 1984] et enfin sur le marketing des services publics
[LAUFER, 1976 ; BON, LOUPPE et MENGUY, 1978 ; KOTLER, 1979]. IL
existe également une littérature abondante sur le marketing des
institutions culturelles, privées comme publiques [COLBERT, 1993 ;
EVRARD, 1993 ; BOURGEON, 1994 ; BERGADAA et NYECK, 1995 ;
MCLEAN, 1997 ; KOTLER et KOTLER, 1998 ; KOLB, 2000].
Dans le secteur public, comme le souligne GREFFE [1999], au premier
abord, il ne devrait pas y avoir de problèmes d’identification des
besoins et de marketing. Le vote légitime les choix politiques et fixe la
demande adressée aux administrations. Cet auteur précise cependant
que les choix politiques portent sur des principes et des objectifs peu
précis. Les discussions législatives n’arrivent jamais aux degrés de
précision requis par le fonctionnement courant de l’administration, des
collectivités locales ou des entreprises publiques. Cette détermination
politique des services collectifs, associée à une concurrence et une
pression budgétaire accrue sur les services publics [LAMARCHE, 1998],
appelle donc une réflexion sur la manière de les définir et de les
préciser, compte tenu des besoins, attentes et comportements des
usagers.
1
/
2
100%