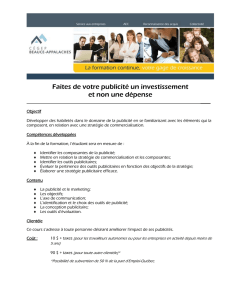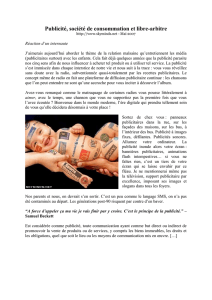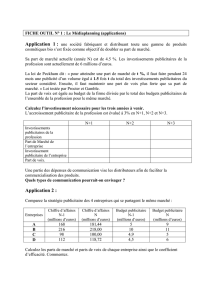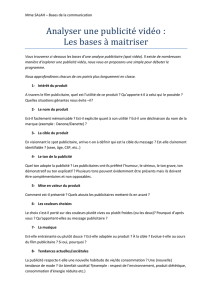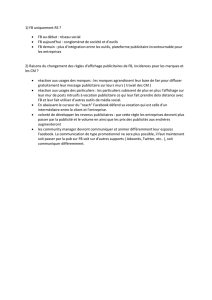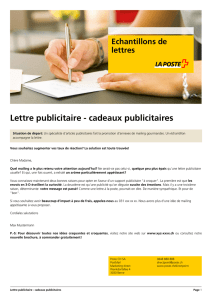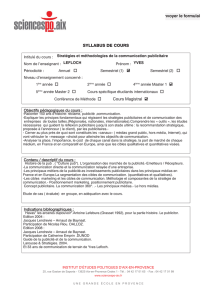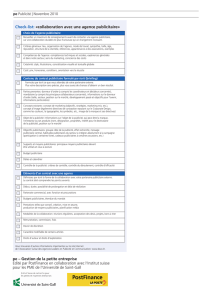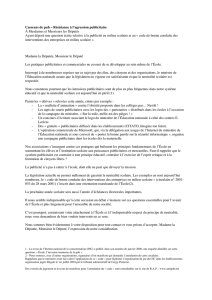La publicité, la culture de masse et la gauche

La publicité, la
culture de masse et
la gauche
Par François Delapierre
- 15

e récent procès des militants antipublicitaires poursuivis par la RATP et Métrobus,
sa filiale chargée de l’affichage dans le métro et les bus parisiens, a connu un
retentissement médiatique très important
1
. Les réactions politiques ont en revanche été
inexistantes. La gauche politique est restée dans l’ensemble silencieuse. Son mutisme
montre que la publicité est parvenue, à mesure qu’elle envahissait l’espace public, à se
faire passer pour une question relevant de la seule sphère privée. «La publicité, chacun
a le droit d’aimer ou de ne pas aimer, c’est une question de goût individuel, ça ne nous
regarde pas» : telle est sans doute l’opinion de beaucoup de responsables politiques à
gauche.
Il paraît impossible pour des militants républicains et socialistes de partager un tel point
de vue. Car l’impérialisme publicitaire s’oppose à la constitution d’un espace public
échappant à la logique marchande et invite à traiter à tout instant le citoyen en
consommateur. Faut-il rappeler par ailleurs que les messages dont les publicitaires nous
abreuvent en tout lieu ne sont pas neutres ? La publicité constitue un des principaux
vecteurs de diffusion et d’imposition de l’idéologie dominante de notre époque. Or l’on
ne peut pas transformer l’ordre du monde sans analyser et affronter les représentations
culturelles qui lui assurent l’adhésion du plus grand nombre. La méconnaissance du
combat antipublicitaire renvoie donc à une négligence plus fondamentale de la
gauche politique. En désertant le combat culturel -qui se mène pour l’essentiel en
dehors d’eux- contre la domination du capitalisme de notre époque, les partis de
gauche manquent à un de leurs principaux devoirs.
Le mouvement antipublicitaire nous amène donc à revenir sur le rôle de l’idéologie
dominante et les mécanismes du consentement à l’autorité, sur la fonction et le contenu
de la culture de masse de notre époque, et sur les implications qui en découlent pour
une gauche soucieuse de dépasser vraiment le sytème global du capitalisme de notre
époque.

La pieuvre publicitaire
La publicité fait partie de notre quotidien. Nous ne réalisons donc pas toujours à quel
point elle est devenue tentaculaire, atteignant une extension qu’aucune société n’a
connue jusqu’ici et continuant à se répandre dans des dimensions sans cesse plus
nombreuses de notre vie sociale.
Fait notable, on la retrouve partout où la logique et l’idéologie du capitalisme de notre
époque sont en train de s’imposer. Elle apparaît dans les services publics lorsque ceux-ci
se plient à la logique privée. Elle gagne ses lettres de noblesse en politique lorsque cette
dernière se donne à l’idéologie libérale. Elle s’étend dans de nouvelles régions du
monde à mesure que celles-ci se soumettent au modèle économique dominant. Quel
est le pays où les dépenses publicitaires par habitant sont les plus élevées ? Les Etats-Unis,
qui sont aussi le cœur du nouvel âge du capitalisme. Même en matière publicitaire, il y a
une exception française ! Notre pays dépense deux fois moins que les Etats-Unis en la
matière et se situe, malgré son niveau de développement, en deçà de la moyenne
européenne.
Est-ce une série de coïncidences ? Non, bien sûr. La publicité constitue en quelque sorte
l’ombre portée de la mise aux normes néo-libérales de nos sociétés. C’est pourquoi il
serait illusoire de combattre l’invasion publicitaire sans affronter l’ordre économique qui
la nourrit. Il n’y a pas de militant antipub conséquent qui ne soit également un militant
anticapitaliste. Mais l’inverse aussi est vrai. Car la publicité est en fait un agent actif de
l’offensive libérale. Pour que tout soit matière à publicité, il faut que tout devienne
marchandise. La publicité y travaille.Avec l’arme qui est la sienne: sa capacité
d’influence. Celle-ci est multiple. Car les publicitaires savent parler au plus grand nombre
mais ne dédaignent pas non plus la pratique du lobbying et l’entretien de leurs réseaux.
C’est qu’il lui faut pour se répandre changer à la fois les mentalités et les lois.Même
aujourd’hui, celles-ci limitent encore sa toute-puissance. En effet, la pub est interdite à
l’école dans de nombreux pays, très contrôlée dans le domaine des médica-
ments,souvent encadrée dans l’audiovisuel,parfois prohibée en politique.Les publicitaires
s’acharnent donc à faire sauter ces verrous (et y parviennent en partie), même si ceux-ci
protègent la laïcité scolaire, la santé publique, l’indépendance de la presse, ou la
République face au pouvoir de l’argent. La publicité et le capitalisme néo-libéral
avancent donc de concert, en se préparant mutuellement le terrain.

Le nouvel âge de la pub
La progression des dépenses publicitaires mondiales est ininterrompue depuis 1945. Mais
cette tendance lourde ne doit pas masquer les ruptures auxquelles nous assistons depuis
une vingtaine d’années. Quantitativement d’abord : la croissance soutenue du marché
publicitaire a fait place à une véritable explosion (les dépenses publicitaires mondiales
ont été multipliées par plus de quatre depuis 1980, bien plus que la croissance de la
production). Qualitativement aussi, avec le phénomène des marques et
l’autonomisation du langage publicitaire, qui se présente de plus en plus comme une
culture propre, détachée des produits, avec ses grands créateurs, ses amateurs éclairés,
et même ses festivals !
Le monde publicitaire dans lequel nous vivons a donc changé. Le nouvel âge du
capitalisme a accouché d’un nouvel âge de la pub. La publicité a accompagné l’essor
des firmes transnationales qui règnent désormais sur le marché mondial. La surenchère
publicitaire a permis d’accélérer la concentration de l’économie en laminant les
entreprises qui n’étaient pas capables de suivre. C’est un déversement inouï de publicité
qui a permis par exemple à Coca-Cola de conquérir sa position dominante et de la tenir
face à son dernier concurrent Pepsi. Qu’on en juge : lorsque la firme de soda fit don à la
bibliothèque du Congrès américain de l’intégralité des films publicitaires qu’elle avait
produits dans le monde depuis un demi-siècle, on découvrit qu’il y en avait plus de
20000. Soit plus d’un film publicitaire conçu en moyenne chaque jour depuis cinquante
ans pour vanter les mérites d’une simple boisson gazeuse ! Le matraquage publicitaire
contribue également à l’uniformisation des goûts et des attentes indispensable à la
constitution d’un marché mondial de masse. Enfin, la publicité impose les normes de
consommation rendues nécessaires par la mise sur le marché continuelle de nouveaux
produits.
Comparé à son prédécesseur, ce nouveau capitalisme présente plusieurs
caractéristiques monstrueuses. L’hypertrophie de la finance en est la plus importante,
bien sûr. La boulimie publicitaire en est une autre. On assiste en effet à une surenchère
permanente afin de résister à la concurrence et de maintenir l’attention d’un public sans
cesse plus sollicité. La publicité tend alors à envahir tout l’espace social. Son expansion
paraît sans limite. Hier maintenue dans les coupures publicitaires, elle envahit aujourd’hui
le contenu des films. James Bond choisit sa marque de bière ou le modèle de sa voiture
en fonction des versements publicitaires qu’on lui propose. La pratique du parrainage
devient systématique : 85% des événements sportifs et culturels aux Etats-Unis y ont
recours, contre 25% il y a seulement quinze ans. Rien ne paraît devoir y échapper :
même des mariages commencent à être sponsorisés dans ce pays !

La question qui nous est posée aux citoyens n’est donc plus d’être «pour ou contre la
pub» mais de savoir si nous laissons la publicité nous envahir chaque jour davantage.
Les mille fronts du combat antipub
2
C’est donc dans des secteurs de plus en plus nombreux que le combat contre l’invasion
publicitaire trouve matière à se déployer. Il est ainsi amené à entrer de plus en plus
fréquemment en résonance avec les préoccupations et les actions des syndicats, des
défenseurs des services publics, des militants des droits de l’homme et des libertés, de la
laïcité, de la santé publique… et à constituer alors un engagement partagé par de
nombreux militants de gauche. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner concrètement
quelques-uns de ces nouveaux fronts du combat antipub.
Prenons l’exemple de la santé. Les dépenses publicitaires de l’industrie pharmaceutique
sont souvent limitées par des législations nationales qui interdisent la publicité pour des
médicaments disponibles uniquement sur prescription médicale
3
. Elles représentent
pourtant déjà le double des investissements en recherche et développement du
secteur. Lobbying, création de fausses associations «indépendantes» qui font la
promotion de certains traitements, séduction des étudiants les plus brillants dès
l’Université par le biais du financement de leurs papiers et recherches, multiplication des
«colloques» promotionnels… tout les moyens sont bons pour convaincre les médecins de
prescrire tel ou tel produit. Ces dépenses de publicité et de promotion représentent aux
Etats-Unis une moyenne de 13000 dollars par an et par médecin. Ces sommes
contribuent plus à la surconsommation médicale qu’à l’information et la formation des
médecins laissés entre les mains des visiteurs médicaux.
Quant à la publicité en direction du public, les cas autorisés sont exceptionnels dans
notre pays. Mais ces rares dérogations donnent déjà une idée des dégâts sanitaires
auxquelles la publicité pourrait conduire si elle était demain plus largement autorisée. On
lui doit en effet quelques scandales mémorables comme la campagne pour la
vaccination contre l’hépatite B menée en France à partir de 1994. Soutenue par le
ministre de la Santé de l’époque, Philippe Douste-Blazy, et financée par quelques gros
labos, elle a réussi à convaincre à coup de spots télévisés et d’encarts dans la presse
plus de trente millions de Français de recourir soudainement à ce vaccin jusqu’alors peu
utilisé. On les avait même incité à vacciner les nourrissons. Pour quels résultats ? Dix ans
après, une seule chose est sure : les profits engrangés à cette occasion ont été
considérables. L’utilité sanitaire d’une telle opération dans notre pays n’a en revanche
jamais été démontrée. Plus grave, plusieurs études suggèrent que ces vaccinations
précoces contre l’hépatite B sont responsables d’une augmentation tragique des cas
de sclérose en plaques. Sur la même question, l’Angleterre a été moins crédule. Les
autorités publiques n’ont pas suivi les publicitaires stipendiés par les labos. Le British
Medical Journal (revue de l’association des médecins britanniques, une des cinq revues
les plus lues au monde) s’en amuse encore : «L’agence de communication Shire Hall
Communication réalisa un travail remarquable. Même si l’immunisation universelle des
enfants anglais pour une maladie qui ne s’attrape que dans certains pays tropicaux, ou
lors d’injection de drogue par intraveineuse, ou encore en cas de fréquentations
sexuelles multiples, a mis un sourire sur de nombreux visages.»
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%