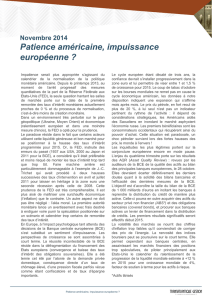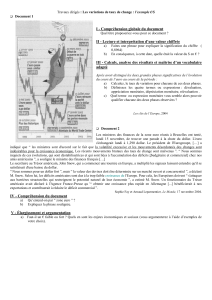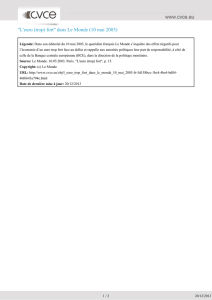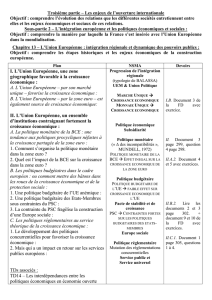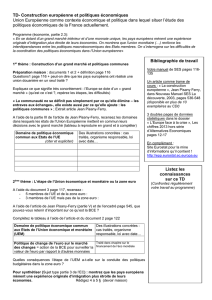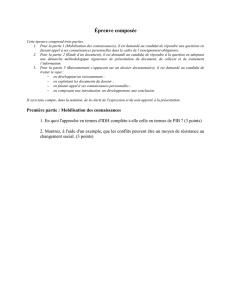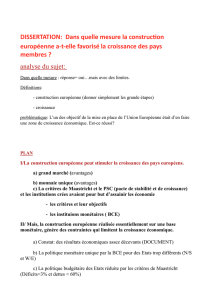économie, monnaie, finances : l`heure de la cohérence ?

36 • Sociétal n°60
Dossier : Présidence française de l’Union européenne
Économie, monnaie,
finances : l’heure de
la cohérence ?
Jacques MIstral
Directeur des études économiques de l’Ifri et
membre du Conseil d’analyse économique
L’incompréhension qui s’est développée au sein du couple franco-allemand depuis un
an handicape l’Europe.
Le couple franco-allemand connaît des turbulences. En particulier, le projet
d’Union méditerranéenne a suscité de très vives objections outre-Rhin. Le
compromis élaboré à Hanovre et adopté mi-mars a certes sorti le dossier
de l’ornière en recadrant, comme cela s’imposait, l’initiative française dans
la logique de l’Union européenne. Ce qui est le plus préoccupant parmi les sujets de
friction, c’est la conduite des politiques économiques. Nos partenaires regardent avec
suspicion notre incapacité depuis quinze ans à régler notre problème de finances
publiques et à clore un débat vieux d’un quart de siècle sur la politique monétaire.
De là découle inévitablement une perte d’influence de notre pays dans les affaires
européennes. Il n’est pas trop tard pour corriger le tir, mais il faut très vite nous met-
tre en mesure d’organiser la coopération internationale dont l’Europe va avoir besoin
en matière de changes, et pour cela réaffirmer notre confiance dans la conduite de la
monnaie par la BCE et prendre à bras-le-corps notre propre problème financier. Ce
sont les trois thèmes successivement abordés dans cet article.
Pour une coopération internationale
sur le taux de change
À la veille de sa présidence, on sait d’ores et déjà que la France sera confrontée à une
situation économique et monétaire internationale tendue : il va falloir répondre aux

2ème trimestre 2008 • 37
menaces que font naître les développements de la crise financière. Les conditions
d’une bulle sur l’euro paraissant en effet réunies, la question des taux de change
pourrait s’imposer au premier plan.
La force de l’euro tient bien sûr à ce que les « fondamentaux » de l’économie euro-
péenne sont sains, que la gestion de cette monnaie inspire confiance. Mais si l’euro
monte, c’est pour des raisons infiniment plus puissantes. Le danger de la situation
actuelle provient de ce que la planète financière est depuis des années soumise à
des forces tectoniques longtemps restées latentes mais libérées depuis peu. La toile
de fond, c’est la relation commerciale et financière dans le bassin Pacifique : une
croissance exagérément tirée par l’exportation en Chine, une croissance exagérément
poussée par la contraction de l’épargne aux États-Unis et des changes rigides, le
mélange ne pouvait que se révéler toxique à terme. Ces tendances étaient dans l’inté-
rêt des deux parties (au moins à court terme), ce qui explique qu’elles aient pu durer
aussi longtemps. Mais le jeu a trop duré, sa signification profonde a été camouflée
ou caricaturée par la formule fallacieuse selon laquelle « le déficit américain éponge
l’épargne excédentaire du reste du monde » (formule dont l’auteur n’est autre que l’ac-
tuel président de la Réserve fédérale). Là est l’origine du problème monétaire inter-
national actuel : les plaidoyers d’experts en faveur de la réévaluation des monnaies
asiatiques sont restés lettre morte ; les efforts entrepris, conformément à ses statuts,
par le FMI pour corriger des parités manifestement inappropriées du yen et du yuan
sont restés sans effet. Faute d’ajustement mené en temps utile, et dans un univers
où la flexibilité des changes est en pratique plutôt restreinte, l’euro apparaît comme
la seule alternative crédible au moment où s’effrite la confiance dans le dollar : c’est
sur la monnaie européenne que se reporte en masse la liquidité mondiale après être
passée d’une classe d’actifs à une autre. Ce recul du dollar, clairement amplifié après
le déclenchement de la crise financière, a toutes chances de se poursuivre parce que
toutes les forces supposées influencer les mouvements de parité poussent désormais
dans la même direction :
• Sur le plan structurel, les déterminants des flux de capitaux se sont profon-
dément transformés depuis l’époque où le dollar roi attirait à la fois les inves-
tissements directs et les investissements de portefeuille à long terme ; depuis
2001, le financement de la balance des paiements est progressivement devenu
beaucoup plus fragile, dépendant de placements privés à court terme et, en
dernière instance, de décisions politiques concernant l’augmentation des réser-
ves de change des pays émergents excédentaires. Cette transformation de la
structure de la balance des paiements révèle on ne peut plus clairement une
situation d’offre excédentaire de dollars (les besoins de financement quotidiens
de l’économie américaine restent supérieurs à 2 milliards de dollars) dont on ne
voit pas la fin.
Économie, monnaie, finances : l’heure de la cohérence ?

Dossier : Présidence française de l’Union européenne
38 • Sociétal n°60
• À court terme, l’écart de croissance est un paramètre très important, comme
on l’a vu pendant des années, dans une période où la croissance et les gains de
productivité résumaient la force et l’ « attractivité » de l’économie américaine.
Aujourd’hui, les tendances se sont inversées, les anticipations sur la croissance
sont peu favorables outre-Atlantique du fait de la crise immobilière et du
ralentissement inévitable de la consommation, les États-Unis sont peut-être
même d’ores et déjà en récession, et cela pèse clairement sur le dollar depuis
l’automne 2007.
• Les taux d’intérêt, enfin, sont gouvernés par des principes politiques différents
de part et d’autre de l’Atlantique. Pour la Fed, la baisse des taux est le moyen de
répondre aux difficultés des emprunteurs (en atténuant les charges d’emprunt
pour les ménages endettés à taux variables) et plus encore à celles du système
bancaire (en favorisant la reconstitution des fonds propres). En Europe, le sys-
tème financier est moins exposé alors que les pressions inflationnistes sont plus
manifestes, et la BCE a peu de raisons de suivre la Fed dans cette direction.
L’écart de taux joue également en défaveur du dollar.
Il faut, dans un tel contexte, poser la question théoriquement jugée incorrecte par
beaucoup d’économistes mais incontournable sur le plan politique : la déviation
excessive des taux de change par rapport à une parité « d’équilibre » (avec toute l’im-
précision de cette qualification) ne constitue-t-elle pas un grave danger pour le com-
merce international ? Comme on l’entend dire de plus en plus fréquemment, l’euro
à 1,20 dollar est à peu de choses près à l’équilibre, à 1,35 les exportateurs français
commencent à se plaindre, à 1,50 leurs homologues allemands aussi, mais au-dessus
de ce seuil, on entre clairement dans le champ des « dévaluations compétitives », un
terme introduit dans les années 1930 et de sinistre mémoire. Ce sont des niveaux où
les conflits d’intérêts en matière de commerce et d’emploi deviennent aigus et peu-
vent prendre une tournure politique mal contrôlée aux conséquences imprévisibles.
Il faut évidemment tout faire pour éviter de tels enchaînements.
La solution réside dans une meilleure coopération internationale entre les princi-
pales zones monétaires, les États-Unis, l’Asie, l’Europe. Pour l’instant, les autori-
tés américaines ne sont pas encore convaincues que nous entrons dans une zone
de danger, l’affirmation rituelle qu’un « dollar fort est dans l’intérêt de l’économie
américaine » est bien comprise par les marchés pour ce qu’elle vaut : le camouflage
d’une position qui, fondamentalement, trouve dans la stimulation des exportations
une planche de salut en matière d’emploi. Mais poussé trop loin, comme on le voit
aujourd’hui, ce réflexe de « benign neglect » est dangereux pour l’Amérique elle-
même : que ferait-elle si l’accélération de l’inflation s’accélérait ? Comment réagi-

2ème trimestre 2008 • 39
Économie, monnaie, finances : l’heure de la cohérence ?
rait-elle à une défiance accrue des investisseurs internationaux vis-à-vis du dollar ?
Bref, le dollar faible est un atout pour l’Amérique, un dollar trop faible risque de se
retourner contre elle. Face à une telle situation, en tout cas, un objectif prioritaire
pour les Européens sera de convaincre leurs partenaires américains et asiatiques en
élaborant le diagnostic et les préconisations nécessaires. C’est l’affaire des gouverne-
ments et des banques centrales.
La BCE est la banque centrale dont l’Europe a besoin
Dans un tel contexte, notre capacité d’initiative est gravement polluée parce que
nous cultivons en France depuis des années (plus précisément depuis la « paren-
thèse » de 1983) un débat provincial sur la conduite des affaires monétaires. Il n’y a
pas un gouvernement étranger, pas même un organe de presse reconnu en Europe,
qui reprenne nos polémiques à son compte. Le recours récurrent à ce thème fait
évidemment partie d’un débat de politique intérieure que nous avons été incapables
de régler depuis vingt-cinq ans ! Et ce débat est loin de s’estomper puisque la reva-
lorisation récente de l’euro a ravivé l’activisme de tous les « nonistes », ceux hostiles
à Maastricht et ceux opposés au projet constitutionnel. Les signaux trop généreuse-
ment donnés à ce courant ont clairement introduit une contradiction au cœur de la
politique européenne de notre pays. Ainsi, de même qu’en 1983 François Mitterrand
avait tranché, après bien des circonvolutions, dans un sens qui allait le replacer au
centre du projet européen, de même aujourd’hui faut-il donner un signe comparable,
il faut réaffirmer notre attachement à l’Union monétaire et à l’institution qui en est
l’expression, la BCE. Ce n’est pas seulement souhaitable, c’est parfaitement justifié.
Pour qui compare la BCE avec d’autres banques centrales, par exemple la Fed, il est
en effet frappant de constater que si le régime « constitutionnel » des deux institu-
tions (leur indépendance, leur mission) est différent, leur pratique institutionnelle
est proche vis-à-vis des représentants élus – le gouverneur de la BCE rend compte
au Parlement européen de la situation et de la politique monétaires comme le fait
son homologue de la Fed devant les commissions du Congrès ; et vis-à-vis de l’exé-
cutif – il n’y a pas de grande différence entre le dialogue régulier du gouverneur de la
Fed avec le secrétaire au Trésor, et celui du patron de la BCE avec les ministres des
Finances de l’Eurogroupe. Dans l’un comme dans l’autre cas, ce qui caractérise ce
dialogue avec l’exécutif, par contraste avec des auditions parlementaires, c’est que la
confidentialité s’impose : personne, par exemple, n’a en mémoire une querelle entre
la Maison Blanche et la Fed. S’il est en effet deux ingrédients malvenus dans toute
question monétaire, c’est bien l’agressivité et l’appel aux médias. Les éviter, c’est le
seul secret d’un dialogue confiant et de ce fait fructueux.

Dossier : Présidence française de l’Union européenne
40 • Sociétal n°60
Conclusion naïve, objecteront immédiatement certains ; il ne pourrait en être ainsi
que dans un univers où les maîtres de la monnaie n’auraient pas, depuis longtemps,
perdu tout sens commun et cédé aux mirages de la « pensée unique ». On ne peut,
pour trancher cette question, que se référer aux faits, au comportement de la BCE
qui semble parfois, en effet, si différent de celui de la Fed. « La Fed baisse ses taux
et tout repart, je dis à la BCE ‘‘regardez ce que font les autres” », avait commenté le
président Sarkozy l’automne dernier.
En fait, en regardant bien, on aboutit à une conclusion très différente. Si l’on observe
en effet les décisions de la BCE depuis ses origines et les commentaires qui accom-
pagnent son action, on est au contraire frappé par sa capacité à suivre une voie
médiane. Contrairement aux reproches qui lui étaient faits dès avant sa création, elle
n’a jamais cédé à un penchant rigoriste. En 1999, elle a accepté, sans s’en réjouir pro-
bablement, mais sans relever ses taux, une dévalorisation presque honteuse de l’euro
qui était tellement éloignée des espoirs que l’on avait placés en elle ; par la suite, elle
n’a jamais réagi avec excès à une évolution des prix qui a toujours été dans l’eurozone
supérieure à son objectif, contrairement aux États-Unis où les risques déflationnistes
ont été réels, avec une inflation reculant jusqu’à 1 % en termes annuels.
En matière de stabilité monétaire et financière, la BCE, avec d’autres banques cen-
trales, a toujours été plus vigilante que la Fed sur l’explosion des prix d’actifs. Et elle
en a été bien inspirée puisque l’Europe a échappé aux délires du marché subprime.
Depuis l’été dernier, alors que ses mises en garde répétées s’avèrent justifiées, elle
fait face rapidement et avec pragmatisme, refusant et le rigorisme bien mal inspiré
du gouverneur de la Banque centrale d’Angleterre (rigorisme qui n’a duré qu’une
semaine) et l’esprit de facilité auquel cède (trop) rapidement la Fed. Qui ne voit
qu’en réagissant avec précipitation aux alarmes bruyantes de la place financière, le
comportement de la Fed en vient à dédouaner les excès d’un « capitalisme de spé-
culateurs » et à prendre sans sourciller le risque de la prochaine vague spéculative ?
Certes, c’est cela que le marché attend, mais est-ce là notre ambition politique de ce
côté de l’Atlantique ?
À regarder de près les faits, on doit admettre que la BCE a prouvé qu’elle était la
banque centrale dont nous avions besoin dans la passe difficile que nous traversons.
Dès lors, faute de pouvoir prendre la BCE comme bouc émissaire, nous voilà, nous
Français, renvoyés à certaines de nos faiblesses bien connues.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%