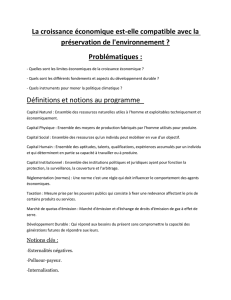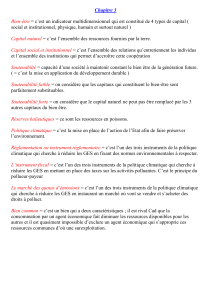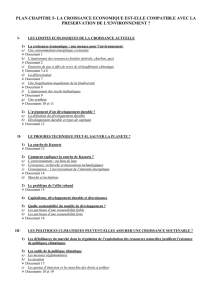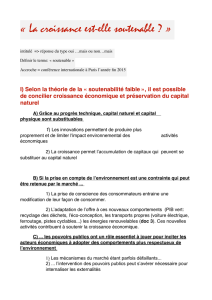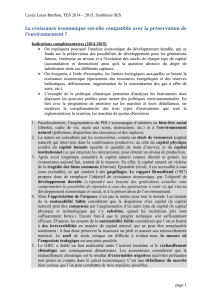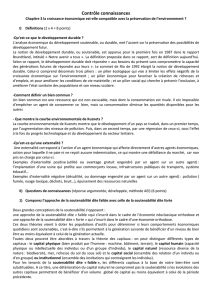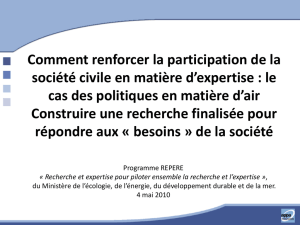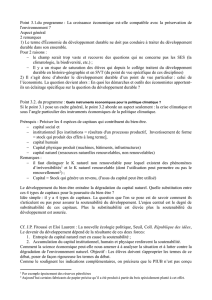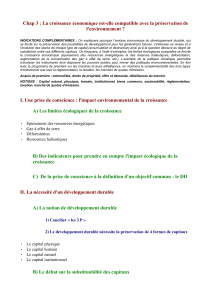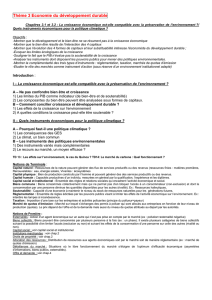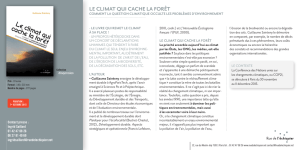Chapitre 3 Croissance et préservation de l - socio

TERMINALE ES – CSI - STRATAKIS
1
CHAPITRE 3 LA CROISSANCE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA PRESERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT ?
★ Questions centrales du chapitre 3 :
- A quelles limites écologiques la croissance se heurte-t-elle ?
- Qu’est-ce qu’une croissance soutenable ?
- Quelles solutions sont envisagées par les économistes ?
Objectifs du chapitre 13 :
- Acquérir des savoirs :
- Savoir définir les notions essentielles du programme de terminale : capital naturel, physique,
humain, institutionnel, biens communs, soutenabilité, réglementation, taxation, marché de quotas
d’émission.
- Savoir définir les notions de première : externalités, défaillances du marché, droits de propriétés,
offre et demande.
- Savoir définir les notions complémentaires : développement durable, substituabilité, empreinte
écologique.
Etre capable :
- d’énumérer les différents aspects de l’épuisement des ressources naturelles et de la pollution.
- de montrer le lien entre croissance démographique, croissance économique et problèmes
environnementaux actuels.
- d’expliquer la situation actuelle environnementale avec les notions d’externalités et de défaillance des
marchés.
- d’expliquer les caractéristiques des biens environnementaux, en utilisant les notions de biens communs et
droits de propriétés.
- de caractériser la notion de développement durable et de montrer l’historique de la prise de conscience
autour de cette notion.
- d’illustrer la complémentarité entre capital naturel, humain, institutionnel et physique.
- de distinguer les notions de soutenabilité forte et de soutenabilité faible
- de présenter les trois instruments dont disposent les pouvoirs publics pour agir sur le bien commun
climat : taxe, norme, marché de quotas d’émission.
– de présenter les intérêts et les limites de ces trois instruments.
– d’ en montrer la complémentarité
- Acquérir des savoir-faire :
- Savoir lire et interpréter les tableaux à double entrée
- Savoir lire et interpréter, utiliser les taux de répartition, taux de croissance, taux de croissance
moyen, indice simple (de base 100), pour établir des comparaisons dans le temps et l’espace.
- Savoir distinguer les évolutions en valeur et en volume
- Savoir lire et interpréter les diverses représentations graphiques.
Plan du chapitre
Introduction Chronique d’une mort annoncée : les limites écologiques de la croissance
I. Effets externes et biens communs : les défaillances du marché pour protéger l’environnement
A. Les effets externes de la croissance
B. Les biens communs sont mal gérés par le marché
Transition : la prise de conscience planétaire et la recherche d’un développement durable
II. Les réponses des économistes au problème de la soutenabilité
A. Les différents capitaux sont-ils substituables ou non ?
B. Divers instruments pour sauver un bien commun : le climat.
Introduction
Activité de sensibilisation
A. Sur une île déserte pour comprendre les notions de biocapacité et d’empreinte écologique
Quelle devrait être la taille d’une île déserte (terre, lagon et mer accessible compris) pour
permettre à un naufrage de répondre durablement à ses besoins en nourriture, chauffage,
matériaux de construction, air pur, eau potable, absorption des déchets ? Cette surface mesurée en
hectare globaux représente l’empreinte écologique e notre Robinson Crusoe. La capacité de l’île à
répondre à cette demande dépend notamment de la richesse et de la diversité des sols. La
biocapacité de l’île, convertie en surface biologiquement utile, est donc également mesurée en
hectares globaux. On comprend que si le mode de vie de notre naufragé exerce une pression trop
forte sur son île (s’il fait par exemple un feu de camp tous les soirs pour tromper sa solitude),

TERMINALE ES – CSI - STRATAKIS
2
c’est-à-dire si son empreinte écologique est supérieure à la biocapacité de l’île, sa survie risque
d’être compromise à plus ou moins long terme…
D’après WWF France, ONG, Nathan 2012.
Voici comment se répartit la biocapacité de l’île fictive :
Surface en m2
Champs cultivés
1300
Pâturages
2800
Forêts
3300
Pêcheries
2400
Terrains construits
200
Surface totale de l’île
50000
.
2. Calcul individuel de son empreinte écologique sur le site de Global Footprint Network : combien
de planètes consommerions-nous si tout le monde avait votre mode de vie ?
.
La biocapacité de la planète est sa capacité à ….
L’empreinte écologique indique ce que l’homme utilise …
3. L’empreinte écologique à l’échelle mondiale : des pays débiteurs, des pays créditeurs
Document : voir la carte sur le site de Global Footprint Network, Ecological Footprint Atlas 2010 (cliquer dans
Footprint science puis data- p 35).
4. A partir des documents du Bordas (dossier étudié à la maison p 142 à 171) : listez les différents
problèmes écologiques auxquels le monde entier est aujourd’hui confronté.
5. Quelles sont les causes de ces problèmes ?
I Effets externes et biens communs : les défaillances du marché pour protéger
l’environnement
A/ Les effets externes de la croissance
Rappels de première : Qu’est-ce qu’une externalité ?
Externalités : conséquences indirecte positives ou négatives que l’activité de tel acteur économique
(producteur ou consommateur) entraîne pour un autre acteur ou toute la société, sans qu’il y ait compensation
monétaire. Ces conséquences sont donc externes au marché car elles ne participent pas à la définition de sprix
sur les marchés concernés.
Dans le cas d’externalités positives, les acteurs créent un avantage social, le profit privé est inférieur au profit
social. Les pouvoirs publics peuvent intervenir pour soutenir ces agents. Exemple : l’activité des apiculteurs
permet la pollinisation, favorable aux producteurs de fruits et légume.
Dans le cas d’externalités négatives, les acteurs font supporter un coût à d’autres acteurs (coût social). Ce coût
social est supérieur au coût privé. Les pouvoirs publics peuvent alors intervenir pour faire internaliser par les
acteurs responsables le coût social. Par exemple, un producteur pollueur pollue l’eau d’une rivière qui devient
impropre à toute activité de pêche, de baignade etc…
Exercice :
1. Quels besoins chaque surface listée permet-elle de satisfaire ?
2. A quoi correspond ‘offre de capital naturel, la demande de
capital naturel ?
3. Si l’empreinte écologique de Robinson est de 1 hectare global
(10 000 m2), la biocapacité de l’île est-elle suffisante ?
4. Quelle peut être la conséquence de la hausse de la quantité de
feux réalisés par Robinson ?
5. faites le lien entre cet exemple ficitf et les Sumériens Bordas
doc 1 p 142.

TERMINALE ES – CSI - STRATAKIS
3
Synthèse du I. B: Le bien-être des populations repose sur cinq capitaux. Tous ces capitaux peuvent
contribuer au bien-être en permettant des externalités positives, qui par définition, profitent au plus grand
nombre.
Type de capital
Définition
Exemples
Effets sur le bien être
Capital physique ou
technique
ensemble des moyens de
production fabriqués par
l’homme utilisés pour
produire.
machines, bâtiments,
infrastructures,
ordinateurs, ...
Amélioration des
conditions matérielles
d’existence.
Capital naturel
Ensemble des ressources
naturelles utiles à l’homme
et exploitables
techniquement et
économiquement.
Energies fossiles,
ressources halieutiques,
forestières, l’air pur, ...
Amélioration du cadre de
vie
Capital social
Ensemble des ressources
(relations, informations,
amitiés,...) qu’un individu
peut mobiliser en vue d’un
objectif (par exemple pour
trouver un emploi).
Carnet d’adresses
important, réseaux
mobilisables, ..
Amélioration du mode vie
(d’un point due vue
relationnel)
Capital humain
Ensemble des aptitudes,
talents, qualifications,
expériences accumulés par
un individu et qui
déterminent en partie sa
capacité à travailler ou à
produire.
Taux d’alphabétisation,
niveau de diplômés du
supérieur,...
Amélioration du mode de
vie.
Capital institutionnel
Ensemble des institutions
politiques et juridiques
ayant pour fonction la
protection (de la propriété,
des contrats,...), la
surveillance (de la
concurrence),la couverture
(protection sociale) et
l’arbitrage( des conflits
sociaux).
Etat garant du droit,
confiance entre les
individus, ...
Amélioration du cadre
institutionnel.
II POURQUOI ET COMMENT RENDRE LA CROISSANCE SOUTENABLE ?
A. Les limites écologiques de la croissance économique
1. Des exemples de limites environnementales de la croissance économique...
Les quatre grands défis du 21ème siècle : le changement climatique, lié aux émissions de gaz à effet de serre, la
préservation de la biodiversité, les ressources en eau douce, la pollution et la santé. Cf Documents Bordas.
Document 4 un exemple : l’épuisement d’une ressource commune, les réserves halieutiques doc ci-après
Q1. Quelle(s) limites environnementale(s) ce texte met-il en évidence? Comment en est-on arrivé là ?
Q2. Quelles sont les conséquences de la surexploitation des réserves halieutiques sur le bien-être des
populations? Comment peut-on l’éviter?

TERMINALE ES – CSI - STRATAKIS
4
2. ... qui s’expliquent par les caractéristiques économiques particulières de l’environnement
Document 5 : Différents types de biens
Q1. A l’aide de vos cours de première et du document, expliquez la différence entre un bien commun et un bien
collectif pur.
Document 6 : l’environnement un bien commun
Q1. Pourquoi peut-on considérer que l’environnement est un bien commun ?
Q2. Que peut-on en conclure quant à sa préservation?
★ Synthèse du II A
La croissance provoque des dégâts environnementaux
➡La croissance économique génère des externalités négatives sur l’environnement. Elle a été jusqu’ici
essentiellement basée sur l’utilisation d’énergies fossiles dont la combustion émet des gaz à effet de serre. Ces
émissions sont actuellement plus importantes dans les pays industrialisés que dans les pays émergents, mais la
croissance soutenue de ces derniers rend les scientifiques inquiets quant au réchauffement climatique.

TERMINALE ES – CSI - STRATAKIS
5
➡La croissance économique peut entraîner des catastrophes écologiques et génère beaucoup de déchets
(ménagers, industriels,...) qu’il faut collecter puis traiter de différentes manières (incinération, mise en
déchetteries,..).. Tout cela a un coût très important pour la collectivité
La croissance épuise les ressources naturelles.
➡Les activité humaines sont également à l’origine de l’épuisement des ressources naturelles. La biocapacité
mondiale est largement dépassée: l’empreinte écologique montre en effet qu’il faut 2,5 hectares pour satisfaire
la demande d’un individu. L’épuisement d’une ressource non renouvelable comme le pétrole a engendré une
hausse de son prix mais aussi des tensions politique, ce qui oblige à trouver d’autres sources
d’énergie.
➡Les ressources naturelles renouvelables cette fois, à très long terme, ont également en danger, ce qui illustre
un conflit entre intérêts individuels et biens communs. C’est le cas des surfaces forestières permettant de
stocker le carbone, qui continuent de diminuer pour satisfaire la demande de bois ou d’huile de palme. La
notion de tragédie des biens communs peut être utilisée pour caractériser cette situation.
Définitions:
Biens communs: biens qui n’appartiennent à personne et qu’il est donc possible d’utiliser sans payer.
★Biens collectifs (purs): produits qui présentent la caractéristique d’être à la fois non excluable (on peu les
consommer sans en payer le prix) et non rivaux (la consommation du produit par un agent économique
n’empêche pas celle d’un autre agent.
B. Le développement durable ou la question de la soutenabilité de la croissance
1. Les principes du développement durable
Document 7 : le rapport Brundtland et le développement durable Bordas
Q1. Rappelez la définition du développement durable selon le rapport Brundtland.
Q2. Quels types de « capital » sont pris en compte dans l’évaluation du développement durable ?
2. La soutenabilité : faible ou forte?
Soutenabilité faible : Les capitaux sont substituables (cf G. Bush -senior: «notre niveau de vie n’est pas
négociable»)
Soutenabilité forte: Les capitaux ne sont donc pas substituables. On considère alors que notre modèle de
développement qui conduit à la destruction des ressources naturelles n’est pas viable.
Document 8 : «La déforestation au brésil» http://videos.tf1.fr/jt-we/le-bresil-face-a-la-deforestation-sauvage-
7381381.html Q1. Quelle conception de la soutenabilité est sous-jacente dans ce document ?
Exemple de soutenabilité faible : à mesure que les réserves de pétrole conventionnel s’épuisent, le prix du baril
augmente. Cette augmentation rentabilise l’exploitation de pétrole non conventionnel comme les sables
bitumineux de l’Alberta qui coûtent plus chers à extraire. Ainsi le progrès technique apporte une solution à
l’épuisement d’une matière première.
Exemple de soutenabilité forte: la déforestation montre bien que, une fois la forêt primaire détruite, il est
impossible de la régénérer avec son patrimoine de biodiversité.
Synthèse : On a vu que les économistes distinguaient plusieurs types de capitaux (capital physique, naturel,
humain, social et institutionnel) constitutifs du bien-être, et que l’objectif était de préserver, voire d’augmenter
la quantité de tous ces capitaux à disposition de la société. Or deux conceptions différentes du développement
durable s’affrontent.
➡La soutenabilité faible : les capitaux sont substituables
les théoriciens de la soutenabilité faible ont confiance dans les vertus de la croissance économique pour
résoudre les problèmes environnementaux. La soutenabilité faible repose sur l’idée que les cinq capitaux
nécessaires à la croissance et au développement sont substituables, c’est à dire, notamment que la
consommation de capital naturel est compensée par la constitution d’un stock de capital physique, humain,
social et institutionnel plus important. Ainsi, les générations actuelles puisent dans les ressources naturelles
pour léguer un environnement économique plus développé aux générations futures.
Pour les tenants de cette théorie, la croissance économique et le progrès technique sont les seules solutions
aux problèmes environnementaux. A mesure que le progrès technique se développe et que le revenu par
habitant augmente, les solutions techniques apparaissent, les préoccupations environnementales se font plus
fortes et la dépollution s’accélère.
➡La soutenabilité forte: les capitaux ne sont pas substituables
A l’inverse, les théoriciens de la soutenabilité forte considèrent que les capitaux ne sont pas substituables, mais
complémentaires, c’est à dire que l’utilisation d’un type de capital implique nécessairement celle des autres
types de capitaux. Un stock de capital physique important ne peut pas compenser un environnement devenu
invivable. Le capital naturel est irremplaçable, et il faut donc le préserver. Le rythme d’extraction des
ressources naturelles épuisables doit être régulé et la consommation de ressources naturelles renouvelables ne
doit pas excéder le rythme naturel de régénération. Pour les partisans de la soutenabilité forte, il existerait un
stock critique de capital naturel au delà duquel l’existence même de l’humanité est remise en cause. L’exemple
de la déforestation montre bien que, une fois la forêt primaire détruite, il est impossible de la régénérer avec
son patrimoine de biodiversité. Dans cette théorie, le progrès technique n’est pas toujours considéré comme
une solution à tous les problèmes environnementaux, c’est pourquoi le recours au principe de précaution est
préconisé.
★Développement soutenable (ou soutenabilité)= synonyme de développement durable: développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs
propres besoins.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%