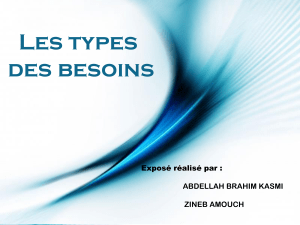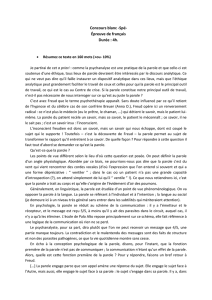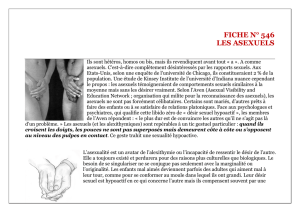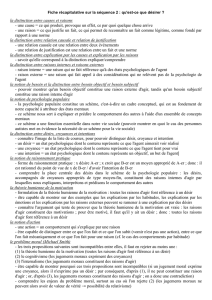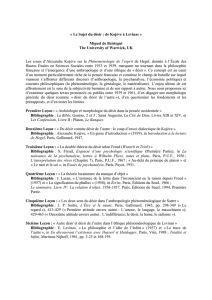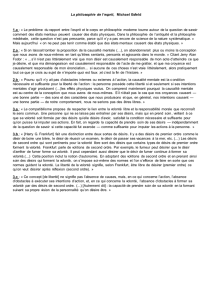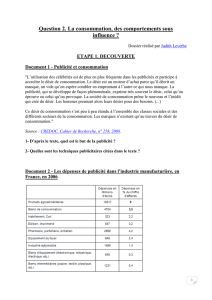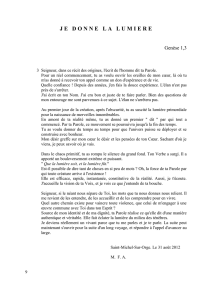sample - Atelje Guttsman


Pédagogique, clair et vivant, ce livre constitue une introduction actuelle aux grands auteurs de
la philosophie. Organisé par thèmes de réflexion, il propose une sélection de 100 citations
expliquées.
Pour chacune, on trouve :
une mise en contexte dans l’œuvre et l’époque du philosophe ;
une explication du problème posé ;
des exemples de la vie quotidienne ;
une citation complémentaire.
Des pistes de lecture viennent éclairer chaque thématique.
Tous les auteurs
Tous les thèmes
Toutes les problématiques
FLORENCE PERRIN et ALEXIS ROSENBAUM sont professeurs agrégés et docteurs en
philosophie. Ils enseignent en classe de Terminale et dans le supérieur.

Florence Perrin
Alexis Rosenbaum
CITATIONS PHILOSOPHIQUES
EXPLIQUÉES
Cinquième tirage 2014

Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com
Cet ouvrage a fait l’objet d’un reconditionnement à l’occasion de son cinquième tirage (nouvelle couverture et nouvelle maquette
intérieure).
Le texte reste inchangé par rapport au tirage précédent.
Mise en pages : Istria
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque
support que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-
Augustins, 75006 Paris.
© Groupe Eyrolles, 2007 pour le texte de la présente édition
© Groupe Eyrolles, 2014 pour la nouvelle présentation
ISBN : 978-2-212-55973-6

Dans la même collection
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%