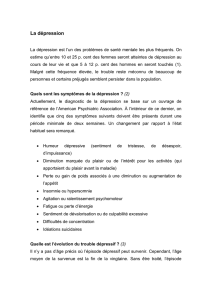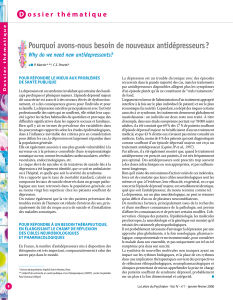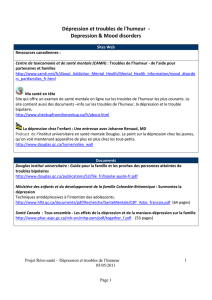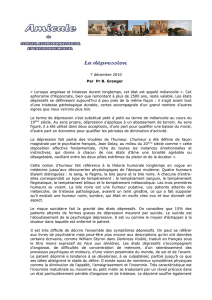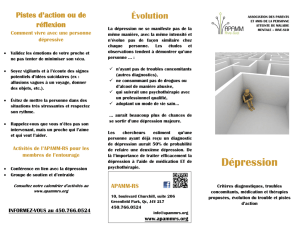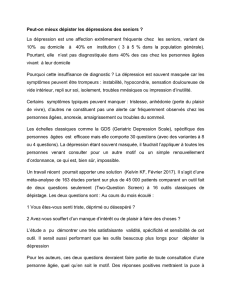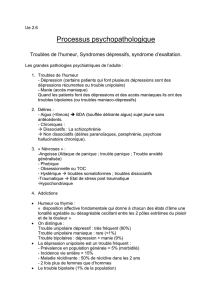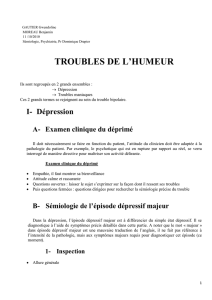les troubles de l`humeur

LES TROUBLES DE L’HUMEUR
I. DÉFINITION
Ainsi nommés à cause de l’implication d’affects persistants positifs ou négatifs
d’intensité suffisamment intenses pour engendrer des comportements mal adaptés. La
dépression se présente donc comme un désordre émotionnel lors duquel les émotions
sont vécues de façon très intense alors que dans les désordres psychotiques, il s’agit de
désordres reliés à la pensée. Il peut cependant arriver que l’intensité des émotions
amène des désordres au niveau de la pensée.
II. LES STATS
Un Nord-Américain sur six souffre de dépression. C’est ce que révèle un sondage Ipsos
Reid qui précise que 14 % des répondants canadiens et 20 % des répondants américains
reconnaissent avoir reçu un diagnostic de dépression.
Mais les proportions augmentent quand on demande aux répondants s'ils pensent
souffrir de cette maladie, sans qu'un diagnostic ait été établi: le taux passe alors à 22 %
chez les Canadiens et à 21 % chez les Américains. Cette maladie affecte 2 fois plus les
femmes que les hommes. Ce sont les femmes entre 18 et 45ans qui sont les plus
atteintes de dépression majeure.
Les troubles de l’humeur font parties des 10 causes les plus handicapantes et ce partout
au monde.
Selon 84 % des répondants, aider les employés souffrant de dépression devrait être une
priorité pour les entreprises.
III. COMPLICATION ET COMORBIDITÉ
Deux complications importantes :
i. Le suicide : 10 à 15% des patients hospitalisés avec une dépression se
suicident. Les troubles dépressifs majeurs comptent pour 25 à 35% de
toutes les morts par suicide.
Au cours des dernières décennies, le phénomène du suicide a pris beaucoup
d’ampleur au Québec. Le taux de suicide des Québécois est passé de 14,8 par
100 000 habitants pour la période de 1976-1978 à 19,1 pour celle de 1999-2001
(figure 1). Chez les hommes, ce taux qui était de 22,0 pour 100 000 habitants a
augmenté à 30,7 pour les mêmes périodes tandis que chez les femmes, il est
passé de 7,9 à 7,8 par 100 000 habitants.

La première caractéristique de la population québécoise à l’égard du suicide est
l’importance de la surmortalité par suicide chez les hommes et que cette
surmortalité s’est accrue dans le temps. En 1999-2001, les hommes affichaient
un excès de mortalité par suicide par rapport aux femmes de près de 300 %
alors qu’en 1976-1978, cet excès était de 200 %. En 2001, parmi les 1 334
Québécois qui se sont suicidés, on retrouvait 1 055 hommes et 279 femmes.
Si l’on regarde de plus près l’évolution de la mortalité par suicide, période après
période, de 1976-1978 à 1999-2001 (figure 1), la période entre 1976-1978 et
1983-1985 est marquée par une
progression rapide chez les hommes, ensuite on observe une relative stabilité
jusqu’au début des
années ‘90. Par la suite, les taux chez les hommes continuent leur croissance
pour se situer autour de 30 par 100 000 habitants pour la période de 1999-2001.
Chez les femmes, pour la période de 1976-1978 à 1983-1985, les taux de
mortalité par suicide demeurent stables pour ensuite connaître une
décroissance qui s’interrompt au début des années ‘90. Depuis, les taux de
mortalité chez les femmes ont eu tendance à s’accroître, mais rien de
comparable avec la croissance des taux de suicide observée chez les hommes
On constate que la progression des taux de suicide dans l’ensemble de la
population est expliquée exclusivement par l’augmentation fulgurante des taux
de mortalité chez les hommes. Cet écart important noté au Québec entre les
hommes et les femmes s’observe également dans les pays industrialisés qui
présentent les taux de suicide les plus élevés, soit l’Autriche et la Finlande.

ii. Les individus atteints de dépression augmentent leur risque de
mourir d’une crise cardiaque (Glassman &Shapiro 1998)
iii. Comorbidité : Les troubles de l’humeur sont souvent accompagnés
d’autres troubles. On parle alors de comorbidité. Plus de la moitié de
ceux qui auront un diagnostic de dépression souffrent également de
troubles anxieux. Les autres types de comorbidité susceptibles d’être
présents sont : les troubles de la personnalité et L’hypertension et
l’arthrite.
IV. LA DÉPRESSION CLINIQUE VERSUS LA DÉPRESSION NORMALE
a. « La dépression normale »
La tristesse, le découragement, le pessimisme et une sensation d’incapacité
d’améliorer sa condition sont des états familiers pour ceux qui sont atteints de troubles
de l’humeur. Il peut cependant arriver que ces états ne soient que passagers et qu’ils
permettent de remettre la personne en question et de découvrir des solutions plus
adaptées pour son avenir. On peut alors parles de « dépression normale ». Tel est le cas
lors d’évènements particulièrement douloureux comme la perte d’un être aimée par
exemple (décès, séparation divorce). Perte qui semble plus difficile à gérer pour les
hommes que pour les femmes (Stroebe & Stroebe, 1983). Un processus de deuil
implique une période dépressive, période lors de laquelle l’individu se désinvesti du
monde extérieur jusqu’au moment il réintègrera l’autre en lui-même et pourra ainsi se
réinvestir dans le monde extérieur.
La dépression post-partum, ainsi que le sentiment de dépression vécus par certains
à la fin d’un processus créatif se retrouve dans ce type de dépression.
On note également des sentiments dépressifs chez les étudiants autant masculins
que féminins. Trois variables semblent être responsables de ces sentiments (D’Affliti
& Quinlan, 1976) :
o La dépendance : besoin de support affectif
o Auto-critique : exagération de sa responsabilité
o Sentiment d’être inefficace
b. Troubles dépressifs majeurs : les troubles de l’humeur sont caractérisés par
des épisodes. Ces épisodes peuvent être dépressif majeur, maniaque, mixte ou
hypomaniaque.
i. Épisode dépressif majeur :

Il faut au moins 5 critères, dont humeur déprimée ou perte de l'intérêt ou
du plaisir. Les symptômes doivent durer depuis plus de 2 semaines.
Humeur dépressive
Diminution de l'intérêt ou du plaisir
Changement de poids ou d'appétit
Troubles du sommeil.
Troubles psycho-moteurs (agitation ou retard)
Fatigue ou perte d'énergie
Sentiment d'inutilité ou de culpabilité
Diminution de la concentration
Pensées de mort
ii. Épisode maniaque
Période de plus d'une semaine, au cours de laquelle l'humeur du patient
est anormalement élevée ou irritable, et où au moins 3 critères sont
présents (4 s'il n'y a que l'irritabilité).
Estime de soi augmentée
Diminution du besoin de sommeil
Plus bavard
Fuite des idées
Distraction
Agitation psycho-motrice
Augmentation des activités conduisant à un plaisir
iii. Épisode mixte
Les critères sont réunis à la fois pour un épisode maniaque et
pour un épisode dépressif majeur et cela presque tous les jours
pendant au moins une semaine
La perturbation de l’humeur est suffisamment élevée pour
marquer un changement marqué ans les relations
interpersonneles ou pour nécessiter une hospitalisation afine de
prévenir les risques pour soi et pour autrui.
iv. Épisode hypomanique
L'humeur est élevée, pendant plus de 4 jours, et le patient présente
plus de 3 critères d'un épisode maniaque.
Les symptômes ne provoquent pas de retentissements sur la vie
sociale ou professionnelle, et ne nécessitent pas une hospitalisation.
c. Classification troubles dépressifs

i. Trouble dépressif majeur (dépression majeure) : présenter
au moins cinq symptômes sur neuf qui durent depuis au moins deux
semaines :
1. Humeur dépressive,
2. diminution de l’intérêt et du plaisir,
3. perte d’appétit et de poids d’au moins 5 % par mois,
4. insomnie ou hypersomnie (plus rare),
5. agitation ou retard au niveau psychomoteur,
6. fatigue et perte d’énergie,
7. sentiment de culpabilité ou manque de valorisation de soi,
8. trouble de concentration,
9. pensée de mort et de suicide.
ces symptômes provoquent une détresse chez la personne ou une
diminution du fonctionnement au niveau social ou au travail,
ces symptômes ne sont pas reliés à l’utilisation de médicaments ou d’une
substance ni à un problème médical,
les symptômes ne sont pas le résultat d’un deuil.
ii. Trouble dysthymique : le trouble dysthymique est une forme de
dépression moins sévère mais à plus long terme. Cependant, le nombre
de symptômes requis pour le diagnostiquer n’est que de deux. Il est en
relation avec le sentiment d’identité de la personne. Cette identité
fragile comporte très souvent des traits de caractère tel que
l’évitement et la dépendance ainsi que la passivité. Il est possible de
passer de la dysthymie à une dépression majeure.
Selon les critères du DSM-IV, le diagnostic de dysthymie peut être
porté si une humeur dépressive est présente pratiquement toute la
journée, plus d'un jour sur deux pendant au moins deux ans (sans
répit de plus de deux mois) avec présence d'au moins deux
symptômes parmi ceux-ci :
1. Anorexie ou boulimie
2. Insomnie ou hypersomnie
3. Baisse d'énergie ou asthénie
4. Faible estime de soi
5. Difficultés de concentration ou difficultés à prendre des
décisions
6. Sentiments de perte d'espoir
7. Un sentiment de “ tête vide ”, a l’impression d'avoir du mal à
organiser ses idées (bradypsychie).
Les troubles ne sont pas secondaires à :
 6
6
 7
7
1
/
7
100%