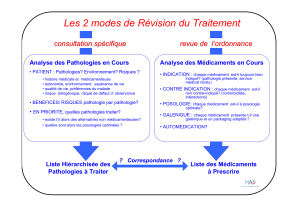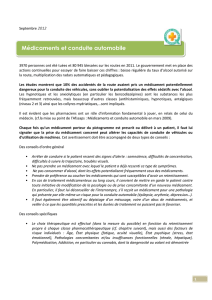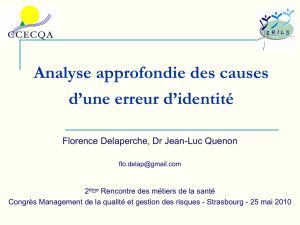La perception du risque iatrogénique chez les

Plein Sens – Actions Traitements – Etude sur la perception du risque iatrogénique 1
5 rue Jules Vallès
75011 Paris
Tel : 01.53.01.84.40
Fax : 01.43.48.20.53
www.pleinsens.fr
Eric MOLIERE
A
AC
CT
TI
IO
ON
NS
S
T
TR
RA
AI
IT
TE
EM
ME
EN
NT
TS
S
La perception du risque iatrogénique chez les
personnes polymédiquées
Rapport d’étude
Septembre 2014
Julie MICHEAU
Anne GOTMAN
Aline DESESQUELLES

Plein Sens – Actions Traitements – Etude sur la perception du risque iatrogénique 2
Cette enquête n’aurait pas pu être réalisée sans le soutien et le concours de
nombreuses personnes. Nous tenons particulièrement à remercier ici :
- Le Professeur Sylvie Legrain et le Docteur Michel Biour pour avoir pris le temps
de nous acculturer à la question du risque iatrogénique.
- Nicolas Bonlieue, Eloise Gaillard pour nous avoir ouvert les portes des dîners de
Basiliade rue Béranger, ainsi que les bénévoles et convives pour nous avoir
accueillis.
- Nesrine Day et Gwenola Quenet pour nous avoir ouvert les portes du
laboratoire du Chemin Vert, et Laurence Gomez, Tarik Ouahabi, Laurence
Grandvoinnet et Kamal Benboujida pour nous avoir permis d’aller à la
rencontre de patients dans leurs laboratoires respectifs.
Enfin, 50 personnes ont eu la patience de nous recevoir et ont accepté de nous
parler de leur expérience de la prise de médicaments. Pour des raisons
déontologiques, ce rapport est entièrement anonyme, et bien sûr, les personnes
enquêtées ne sont pas citées. Certains ou certaines se reconnaîtront peut-être à leur
propos.
Que chacun soit ici remercié pour sa disponibilité et son aimable collaboration. A
tous et à chacun, nous adressons nos plus vifs remerciements.
Les auteurs

Plein Sens – Actions Traitements – Etude sur la perception du risque iatrogénique 3
Sommaire
Introduction ............................................................................................. 4
1. Cadrage méthodologique ............................................................. 6
2. Prendre ses médicaments ............................................................. 23
3. Ce que les médicaments font aux gens .................................... 37
4. Le médicament, objet neutre faiblement subjectivé .............. 47
5. Zoom sur les patients sous traitement ART .................................. 52
6. Conclusion ....................................................................................... 57

Plein Sens – Actions Traitements – Etude sur la perception du risque iatrogénique 4
Introduction
Avec le vieillissement des personnes vivant avec le VIH, les situations de
polypatholgie chronique et de polymédication associées sont de plus en plus
fréquentes. Or la polymédication augmente, par construction faudrait-il dire,
l’exposition au risque iatrogénique médicamenteux. Fidèle à son objet social,
ACTIONS TRAITEMENTS souhaite contribuer à la réduction des risques en ce domaine
en s’attachant à développer les capacités des patients en matière de bon usage
des traitements médicamenteux dans les situations de polymédication. L’association
se place dans un champs de recherche et d’interventions tout à fait
complémentaire des actions généralement organisées en matière de réduction du
risque iatrogénique ; le plus souvent elles visent au premier chef la responsabilité de
prescription du médecin. Ici il s’agit de comprendre et d’agir le cas échéant sur la
pratique des patients.
Avant d’envisager des actions et recommandations dans ce sens, l’association a
souhaité voir réaliser une étude exploratoire sur la perception de ce risque. Elle a
confié à Plein Sens, dans le cadre d’un projet de recherche-action financé par la
Direction Générale de la Santé (DGS), la réalisation d’une étude qualitative sur
l’expérience vécue de la prise de médicaments chez des personnes
polymédiquées, traitées pour le VIH ou d’autres pathologies.
Une enquête non médicale a donc été réalisée à partir de la rencontre d’un panel
de 50 personnes de 50 à 70 ans prenant au moins 3 médicaments par jour pour au
moins deux pathologies différentes. L’objectif de ces entretiens était de saisir les
représentations et les pratiques des patients chroniques. Interrogés par des
enquêteurs profanes de la médecine, c’est le discours des patients qui a été recueilli
sans prisme normatif ou évaluatif sur le caractère approprié ou non de leur pratique,
sans jugement médical. Il ne s’agit pas de savoir si les patients font bien ou mal, mais
simplement de saisir leurs raisons d’agir.
Initialement conçue pour identifier des axes de travail sur la prévention du risque
iatrogénique, cette étude ouvre sans doute plutôt sur la compréhension des
pratiques qui entourent la prise de médicaments et des représentations qui leur sont
associées. La prise quotidienne de médicaments s’inscrit en effet aussi bien dans
l’histoire (parfois longue) de la maladie et du rapport au(x) médecin(s)
prescripteur(s), que dans les diverses dimensions du rapport au corps que le
médicament vient soigner mais également perturber. Sans qu’il y ait à proprement
parler auto-médication, et quoique bien souvent les patients se « contentent » de
suivre leur prescription, la prise de médicaments, aussi routinière soit-elle, engage
une rationalité et une compétence – un travail - qu’il s’est agi de mettre à jour.
Ce rapport restitue les principaux éléments d’analyses issus de ce travail
compréhensif. Dans une première partie, nous expliquons le protocole d’étude :
nous posons une définition organisée du risque iatrogénique et nous expliquons
pourquoi il a été choisi de ne pas interroger des personnes âgées au-delà de 75 ans
pour ne retenir que le critère de la polymédication comme situation d’expérience.

Plein Sens – Actions Traitements – Etude sur la perception du risque iatrogénique 5
Nous précisons également les biais repérés inhérents à la méthode de recrutement
de l’échantillon afin de bien poser le cadre d’analyse.
Les résultats d’étude à proprement parler sont ensuite organisés en 4 parties : la
première décrit l’expérience de la prise de médicament en décrivant les pratiques
et l’attitude face à la prescription qui explique ces pratiques. Dans une seconde
partie, ce sont les effets perçus des médicaments qui sont analysées, la perception
s’entendant ici comme un ensemble complexe alliant effets somatiques et
représentations. La troisième partie propose ensuite une analyse de ce qui se trouve
« en creux » des entretiens étant donné qu’il apparait très clairement que chez les
patients rencontrés, l’expérience de la prise de médicaments est restituée à travers
un discours qui porte peu de marques de subjectivation de cette expérience. Enfin
la dernière partie de résultats (partie 5) s’arrête sur certains points qui peuvent être
approfondis pour les patients soignés pour le VIH qui ont été interrogés
volontairement en plus grand nombre.
A ce stade la conclusion ne porte que sur les résultats de recherche exposés dans le
rapport, première étape d’un travail de recherche action qui devra ensuite
s’attacher à repérer des axes de recommandation opérationnels partant de ces
résultats.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
1
/
57
100%