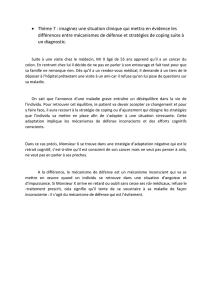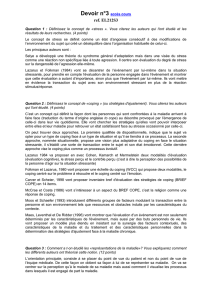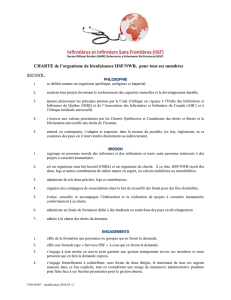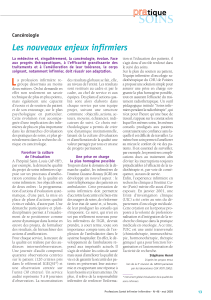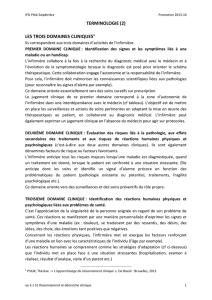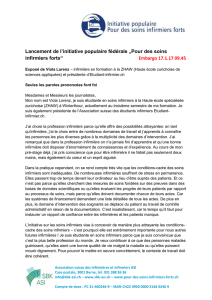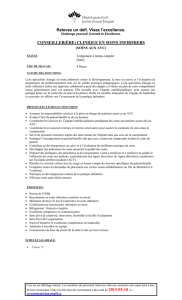CONCEPTS, STRESS, COPING

132
Recherche en soins infirmiers N° 67 - décembre 2001
CONCEPTS, STRESS, COPING
Christine Webb
Professeur de soins infirmiers
Université de Manchester, Angleterre
Traduit par ARSI
PRISE EN CHARGE, GUÉRISON, COPING : VERS UN MODÈLE INTÉGRÉ
SUMMARY
Caring, curing, coping : towards an integrated
model
There is an extensive literature discussing the care :
“cure dilemma”. This usually puts forward the
position that it is doctors who do the curing and
nurses who do the caring. Patients are rarely inclu-
ded in the discussion. This paper considers some
of this literature and examines whether this separa-
tion of functions is a valid one, the part of lay
carers in the process, and the perspective of
patients. It focuses particularly on cancer because
this is an area where the issues seem particularly
pertinent. The paper concludes by proposing an
alternative and integrated conception which
includes patients, nurses and doctors in a cogni-
tive-phenomenological model of coping. It is sug-
gested that this model moves forward from the pre-
vious limitations of the care : cure approach and
enables more fruitful research and education of
practitioners to be undertaken.
Keywords : concept - caring - curing - coping -
nursing model
RÉSUMÉ
Prise en charge, guérison, coping : vers un modèle
intégré
De nombreux documents traitent du «dilemme soi-
gner-guérir» en soulignant en général le point de vue
selon lequel c’est le médecin qui guérit et l’infir-
mière qui soigne. Les patients sont rarement inclus
dans la discussion. Cet article se penche sur une par-
tie de ces documents et étudie la validité de cette
séparation des fonctions, le rôle des soignants non
professionnels dans le processus, et la perspective
des patients. Il se concentre particulièrement sur le
cancer car c’est un domaine où ces questions sem-
blent fort pertinentes. La conclusion de cet article est
une proposition d’une conception alternative et inté-
grée qui prend en compte le patient, les infirmières
et les médecins dans un modèle cognitivo-phénomé-
nologique de coping. On y suggère que ce modèle
dépasse les limites précédentes de l’approche
soins/guérison et permet d’entreprendre une
recherche plus fructueuse et une formation des prati-
ciens.
Mots clés : concepts - soins infirmiers - prise en
charge - guérison - coping -modèle de
soins

INTRODUCTION
Le dilemme soigner/guérir a été souvent abordé dans
les documents sur les soins infirmiers par la question
de savoir en général si c’est le médecin qui guérit et
les infirmières qui dispensent les soins. Cependant,
le patient est rarement mentionné. Le but de cet
article est donc d’étudier les questions liées aux
soins et à la guérison du point de vue des infir-
mières, docteurs, et des patients eux-mêmes sans
oublier de citer les soignants «non professionnels»
ou «informels» puisque la famille et les amis sont
fréquemment mentionnés. Je conclurai en suggérant
que de nombreuses discussions autour du dilemme
soigner/guérir puissent être résolues en resituant le
débat à l’intérieur d’un modèle intégré de coping,
modèle qui nous permet de dépasser les discussions
quelque peu stériles que l’on retrouve dans les docu-
ments soigner/guérir. Ceci nous permet d’étudier les
problèmes associés de manière plus fructueuse et de
former les praticiens de manière plus appropriée au
profit des trois groupes impliqués.
UNE PRISE EN CHARGE FÉMININE ET UNE
GUÉRISON MASCULINE ?
Les documents sur les soins infirmiers remontent à
Florence Nightingale elle-même, et à son livre Les
soins infirmiers. Ce qu’ils sont et ce qu’ils ne sont pas,
qui a été publié pour la première fois en 1860 et repu-
blié plus récemment. Personne n’ignore que
Nightingale a adopté une position essentialiste sur les
infirmières et les médecins, pensant que «être une
bonne infirmière, c’est être une femme bonne» et que
le rôle des infirmières était d’obéir aux médecins de
façon à ne pas empêcher et «diminuer» le travail du
médecin (Nightingale 1980).
Un certain nombre d’écrivains beaucoup plus
récents adoptent une position similaire dans le débat
soigner/guérir (voir par exemple Gilligan, 1982).
Parfois, cet essentialisme est lié à la critique des
médecins et du «modèle médical» pour leur obses-
sion des approches biomédicales ou technologiques
appelées «guérison» aux dépends de ce qui est
considéré comme une approche plus «humaniste»
ou «holistique» adoptée par les infirmières. Le
Thesaurus International des Citations de Penguin
(Tripp 1970) apporte la preuve que cette attitude a
une longue histoire. Par exemple, Héraclitus obser-
vait que :
«Les médecins coupent, brûlent et torturent le malade
et ensuite exigent d’eux des honoraires non mérités
pour de tels services. (Tripp 1970)»
Benjamin Franklin relevait les mêmes motivations
médicales lorsqu’il disait que «Dieu guérit et le méde-
cin prend les honoraires» et Proust a décrit :
«La médecine comme étant un condensé des erreurs
successives et contradictoires de praticiens médicaux
(Tripp 1970)»
Cette approche considère que le comportement inhé-
rent et instinctif des femmes est plus adapté à des
activités particulières que celui des hommes dont on
pense en général qu’ils ont des attributs et des façons
de se conduire opposés. Le moins que l’on puisse dire
est qu’il n’y a pas beaucoup de preuve à l’appui de
ce point de vue (Webb 1985) et cet article se base sur
l’affirmation selon laquelle les femmes et les hommes
sont également capables d’attitudes de soins et de
guérison.
MÉDECINS ET GUÉRISON
Malgré la modernisation du programme des études
médicales et l’adoption d’approches plus intégrées de
résolution de problèmes, Norbert Elias, un sociologue
a écrit en 1985 que :
«Il n’est peut être pas encore complètement superflu
de dire que l’on apporte nettement plus de soin aux
organes des patients qu’aux patients eux mêmes.»
(Elias 1985)
En écrivant plus particulièrement sur le vieillissement
et la mort à une époque où il était lui même grave-
ment malade, Elias observe que : «Se concentrer sur
la prise en charge médicale d’un organe, ou d’une
zone d’organes qui fonctionnent de plus en plus mal
n’est vraiment valable pour le patient que si cette
prise en charge se fait dans le cadre de l’intégration
de processus partiels» (Elias 1985)
Une position similaire est adoptée par le chirurgien
américain Sherwin Nuland qui, dans son autobiogra-
phie de 1993 écrit sur sa vie professionnelle et les
133
Recherche en soins infirmiers N° 67 - décembre 2001
PRISE EN CHARGE, GUÉRISON, COPING : VERS UN MODÈLE INTÉGRÉ

leçons qu’il a essayé d’en tirer, même s’il a parfois
échoué. Il rapporte le cas de «Mlle Welch» une
patiente âgée qui souffrait d’une péritonite et qui
vivait dans une maison de retraite avant d’être trans-
férée à l’hôpital. Mlle Welch ne voulait pas consen-
tir à une intervention chirurgicale, mais Nuland «a
minimisé l’expérience à vivre.» Après l’opération,
Mlle Welch «n’a pas hésité à me faire savoir que je
l’avais trahie» et Nuland sait que :
«Bien que mes intentions étaient seulement de ser-
vir ce que je pensais être son bien être. J’étais cou-
pable de la pire sorte de paternalisme. J’ai fait de la
rétention d’informations car j’avais peur que la
patiente puisse les utiliser pour prendre ce que je
pensais être une mauvaise décision.» (Nuland
1993)
Mlle Welch est morte 2 semaines plus tard, des
suites d’une attaque due probablement au stress de
cette lourde opération. Cette fois ci, elle ne reçut
aucun soin médical, ayant tiré la leçon de son expé-
rience précédente et donné des instructions écrites
pour qu’elle reçoive «uniquement des soins infir-
miers.»
Dans la discussion sur ce cas, Nuland (1993) pense
que la décision à prendre était «d’ordre strictement
clinique et l’éthique n’aurait pas du être prise en
considération.» S’il n’avait pas procédé à l’interven-
tion, ses pairs l’auraient, par la suite, accusé
d’«erreur de jugement, voir même de négligence.»
Néanmoins il n’est pas satisfait de sa décision et
conclut que «c’est la croyance dans la médecine
high tech qui l’emporte, comme c’est presque tou-
jours le cas».
Katz attribue aussi l’autoritarisme médical à un
besoin contrarié de certitude :
«L’incertitude professionnelle est soigneusement
camouflée et remplacée par un air infaillible de cer-
titude professionnelle.» (Katz 1986)
Lorsque le traitement échoue, les médecins ont un
sentiment d’anxiété et de culpabilité qui s’exprime
par l’autoritarisme si bien que, s’ils n’arrivent pas à
maîtriser la maladie, ils contrôlent au moins le pro-
cessus de prise de décision.
Nuland est aussi préoccupé par «l’abandon» des
mourants, et particulièrement leur abandon par les
médecins. Dans une discussion qui établit un paral-
lèle avec le concept de Eliot Freidson d’«esprit cli-
nique» (Freidson 1975), Nuland décrit les médecins
comme des gens dont la réussite se manifeste par le
biais des qualifications médicales et des postes obte-
nus lors d’une difficile compétition. Il en résulte que :
«Ne pas réussir revient à perdre la face, ce qui est
mal toléré par les membres de la plus égocentrique
des professions.» (Nuland 1993)
En revenant au cas de Mlle Welch, Nuland (1993)
admet qu’il est facile pour les médecins de se
convaincre qu’ils en savent plus que leurs patients,
afin de ne leur donner que la quantité d’information
qu’ils estiment appropriée et influencer ainsi la prise
de décision de leur patient. Une fois que cette pos-
sibilité de contrôle est perdue, comme par exemple
avec les patients qui meurent du cancer, les méde-
cins tendent à les abandonner à une «abrogation de
responsabilité.»
La médecine moderne est devenue «un exercice en
sciences appliquées» (Nuland 1993). Afin d’aller à
l’encontre de ces tendances, Nuland souligne l’im-
portance de l’empathie :
«Je ne veux pas condamner les médecins high tech.
J’en ai fait partie, et j’ai partagé l’excitation des
luttes désespérées pour la vie et la satisfaction
suprême qui accompagne la victoire. Mais nombre
de mes victoires ont été des victoires à la
Pyrrhus....Je pense aussi que si j’avais pu me mettre
à la place de la famille et du patient, j’aurai été
moins souvent convaincu de la nécessité d’entre-
prendre une lutte désespérée.» (Nuland 1993)
Les écrivains cités jusqu’à présent semblent induire
que la guérison est inadéquate tant qu’elle n’est pas
accompagnée de soins, bien qu’ils n’utilisent pas
cette terminologie de manière explicite. Si l’on exa-
mine plus en profondeur les documents sur les
soins, on réalise rapidement les difficultés et les
dilemmes également associés à ce concept.
LES SOINS : QUE SONT-ILS ?
Dire qu’il y a un manque de consensus sur la défini-
tion du soin est un euphémisme. Le tableau 1 établit
une liste (sans ordre établi) de la sélection des carac-
téristiques de définition du soin que l’on trouve dans
les documents passés en revue. Ainsi, la confusion et
l’ambigüité s’infiltrent dans les tentatives de défini-
tion du soin et de la prise en charge.
Dunlop (1986) s’interroge : «Une science du soin
est elle possible ?» et cette question n’est pas nou-
velle pour ceux qui ont étudié la «théorie du soin
134
Recherche en soins infirmiers N° 67 - décembre 2001

infirmier.» Dunlop note tout d’abord qu’il y a un
sens distinctif et «émergent» du mot caring (prise en
charge) qui vient à la fois des similitudes et des diffé-
rences des usages historiques du terme. Selon Bevis,
(1981) il est possible de retrouver la trace des deux
origines communes des mots «care» (soins) et «cure»
(guérison) et de trouver des dérivations séparées,
«care» étant un vieux terme anglais et «cure» venant
du latin via le français. Elle conclut que s’il doit y
avoir une science de la prise en charge (elle n’a pas
de problème avec la notion de science pour la prise
en charge), il ne peut pas s’agir d’une science au sens
traditionnel, car ceci implique des concepts de
contrôle, domination et mesure qui sont en contradic-
tion avec la notion de soin mise en avant par les théo-
riciens du soin infirmier.
Une autre source d’ambigüité est la définition des
soins infirmiers eux mêmes. Dunlop en 1986 constate
que :
«Si le soin infirmier implique la prise en charge, alors
le terme «prise en charge infirmière» est une tautolo-
gie. La prise en charge est un processus interactif qui
exige que le soignant s’adapte aux besoins de la per-
sonne dont il a la charge, aux ressources disponibles
et au contexte dans lequel se déroule le soin. Ceci
implique une évaluation compétente, une planifica-
tion, une action et une évaluation des implications et
des nuances de tous ces facteurs. Les infirmières ont
déjà un mot pour ce processus - on l’appelle le «nur-
sing» (Dunlop 1993)
Hill (1991) déclare aussi que le nursing a «quelque
chose de spécial» à offrir et que ce «quelque chose»
est le soin. Elle rend compte des conséquences impor-
tantes constatées dans un groupe de patients traités par
des praticiens infirmiers en rhumatologie en comparai-
son avec un groupe traité par un médecin. Dans l’éva-
luation des issues, on constate certaines améliorations,
comme une augmentation de la fonction articulaire,
une diminution de la douleur, une réduction de
l’anxiété et de la dépression et une meilleure connais-
sance et satisfaction du patient. Hill (1991) attribue les
différences aux «dissimilarités dans des attitudes des
médecins et des infirmiers, c’est à dire «soin contre
guérison», les praticiens infirmiers offrant un soin plus
«holistique.» Des demandes similaires sont formulées
dans les documents nord américains sur les praticiens
infirmiers (voir par exemple Linn en 1984). Holden
(1991) remet en cause la distinction entre caring et
curing en se demandant si cette séparation signifie
que:
«La prise en charge n’est pas curative ou que la gué-
rison n’inclut pas les soins ? Cela signifie-t-il que les
infirmières ne guérissent pas et que les médecins ne
soignent pas ? Lorsqu’on est en face des implications
de cette déclaration, on commence à se rendre
compte à quel point tout ceci est en fait ridicule.»
(Holden 1991)
De même, Engelhardt constate en 1985 qu’il n’y a :
«aucune différence essentielle ou conceptuellement
importante entre les professions d’infirmiers et de
médecins dans leur prise en charge des patients.»
Leininger (1977) suggère aussi que soigner et guérir
sont intimement liés quand elle écrit que :
«Ce sont les actes de prise en charge et les décisions
qui font la différence dans les conséquences effectives
de guérison. Par conséquent, c’est la prise en charge
qui est l’ingrédient le plus essentiel et le plus critique
dans tout processus de guérison.» (Leininger 1977)
Qu’est ce qui distingue alors le lien entre soins infir-
miers et prise en charge de la relation médecine gué-
rison ? Malgré les multiples définitions illustrées pré-
cédemment, tout le monde s’accorde à dire que ce
sont les relations interpersonnelles qui caractérisent
les soins infirmiers et la prise en charge. Ne pas
reconnaître cet élément dans les soins infirmiers
revient à nier la subjectivité du patient et de l’infir-
mière selon Gadow (1985). Sans cette intersubjecti-
vité, le patient et l’infirmière sont tous deux réduits à
l’état d’objets, leur dignité personnelle est perdue et
«l’ensemble cohérent à partir duquel sont constituées
les parties du moi est ainsi exclu.» Plus loin, Fry
(1988) nous indique que les infirmiers et les patients
ont besoin de «beaucoup de temps pour se connec-
ter» de façon à arriver à «la réciprocité et la mutua-
lité» essentiels à l’éthique de la prise en charge.
135
Recherche en soins infirmiers N° 67 - décembre 2001
PRISE EN CHARGE, GUÉRISON, COPING : VERS UN MODÈLE INTÉGRÉ
Tableau 1 Certaines caractéristiques du soin
Honnêteté Sentiment Actualisation Réciprocité
Patience Intérêt Participation Sympathie
Courage Autonomie Relations Respect
Sensibilité Confiance Dignité Spiritualité
Dévouement Assistant Etre avec Soutenir
Engagement Facilitateur Amour Satisfaction
Connaissance Tendresse Compassion Intégrité
Compétences Croissance Empathie Proximité

PRISE EN CHARGE LOGOCENTRIQUE ?
Certains écrivains pensent que les aspects interperson-
nels de la relation infirmière/patient atteignent des
dimensions spirituelles. Cette approche que l’on pour-
rait appeler la version «Woody Allen» ou logocen-
trique (Dunlop 1986) de la relation de prise en charge,
est aussi ardemment attaquée que défendue parmi les
théoriciens des soins infirmiers qu’elle l’est dans la
perspective psychothérapeutique dont elle dérive.
Certains la défendent avec une ferveur quasi religieuse
qui correspond à sa propre terminologie.
L’œuvre de Watson est un exemple du genre. Elle
constate que :
«Les soins infirmiers, dans une perspective de prise en
charge transpersonnelle sont tournés vers le centre
humain à la fois du soignant et du soigné ; ils embras-
sent une dimension spirituelle, voir métaphysique du
processus de prise en charge.» (Watson 1988)
Krysl, une disciple de Watson, écrit de telle façon
qu’on peut se demander si c’est vraiment la relation
infirmière/patient qu’elle décrit :
«Lorsque deux d’entre nous pénètrent l’un dans l’autre
de cette façon, volontairement et réceptivement, la
transformation se fait. Le gestalt de nos êtres séparés
se relâche et vibre....Et nous sommes remplis d’éner-
gie, un matériel vivant, palpable, substantiel.» (Krysl
1988, cité chez Watson 1988)
Dans ses écrits sur son travail comme sage-femme,
Krysl décrit ainsi sous forme poétique le troisième
stade du travail :
«Et quand il arrive, j’examine le placenta
Je trie les particules et les ondes dans le spectre de la
lumière
Et quand mon travail est terminé et que je m’éloigne
du lieu de la naissance
Je traverse les champs de planètes dans les espaces
entre les étoiles les plus lointaines.»
(Krys 1988, citée chez Watson 1988)
D’autres, comme Phillips (1993) et Dunlop (1986) cri-
tiquent cette «sur-psychologisation» des soins infir-
miers. Dunlop est préoccupée par cette «tendance à
la dématérialisation» à «une prise en charge désincar-
née» que les infirmières adoptent de façon à séparer
les soins infirmiers de la «physicalité » de la médecine
et à en faire une profession autonome, et elle milite
contre le tout «holisme » que recherchent les infir-
mières.
Salvage aussi considère avec scepticisme ce qu’elle
appelle les «nouveaux soins infirmiers» qui mettent
l’accent sur une relation «quasi-psychothérapeute»
s’inspirant de la psychologie et psychanalyse huma-
niste. Elle pense que :
«Alors que la psychothérapie vise à aider le client à
résoudre des problèmes émotionnels...les patients des
hôpitaux généralistes cherchent de l’aide pour des
problèmes physiques, avec cependant une compo-
sante affective. Leur souci immédiat est probablement
le soulagement de leur douleur et de leur malaise, plu-
tôt qu’une relation chargée de sens.» (Salvage 1990)
DIFFÉRENTS CADRES DE SOIN
Ceci nous amène à l’idée que ce qui constitue le soin
et la guérison et un équilibre approprié entre les deux
est susceptible de varier dans des cadres différents.
Reed & Bond (1991), par exemple, rendent compte
d’une étude comparant la pratique des soins infirmiers
dans les services de soins de long séjour et de soins
urgents des patients âgés. Ils ont constaté que dans ces
deux cadres, le concept de guérison servait de mesure
aux infirmières pour évaluer leur travail. Pour ceux qui
étaient dans des services de soins d’urgence :
«La guérison et la sortie qui en résultait étaient la rai-
son d’être... et leurs efforts étaient dirigés dans cette
direction....les infirmières reconnaissaient qu’elles
avaient le sentiment d’avoir atteint le but et en tiraient
satisfaction. L’évaluation scientifique dans la ligne de
la politique et des objectifs pour les soins gériatriques
hospitaliers était donc importante comme base de la
planification des soins infirmiers.» (Redd & Bond
1991)
Les auteurs commentent que :
«Ce genre de soin était aussi efficace pour soigner les
patients âgés que ceux pratiqués dans d’autres types
de service de soins généraux d’urgence. (Je le sou-
ligne)» (Reed & Bond 1991).
Dans les services de long séjour, la guérison était aussi
un point de référence, mais son «inappropriation
apparente» a amené les infirmières à rechercher :
«Une satisfaction dérivée en premier lieu «des soins
gériatriques de qualité» qui étaient pratiqués dans
leurs propres termes de référence. Ceci impliquait un
investissement dans une exécution rapide et efficace
des tâches de routine, qui exclue l’évaluation des pro-
blèmes de chaque patient....ce qui épousait le profes-
sionnalisme excluant de se préoccuper des besoins de
chaque patient.» (Reed & Bond 1991)
136
Recherche en soins infirmiers N° 67 - décembre 2001
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%