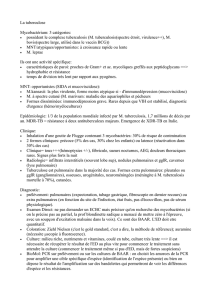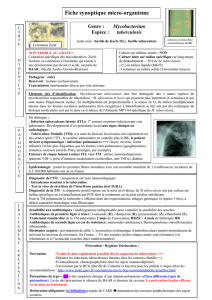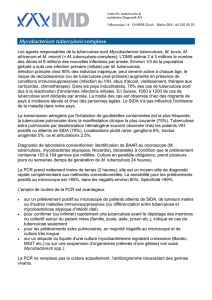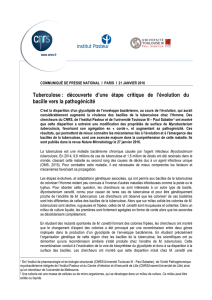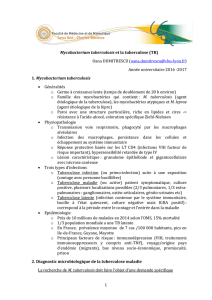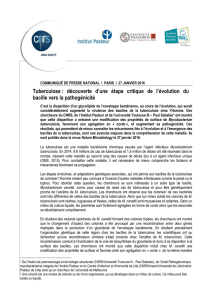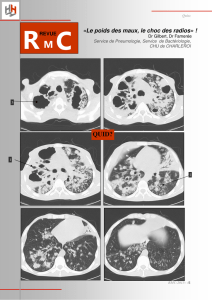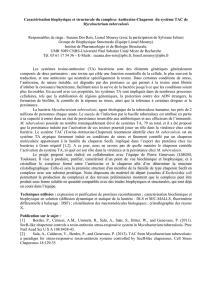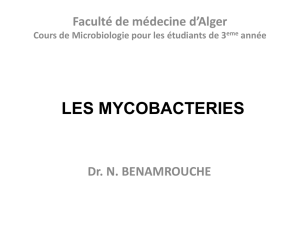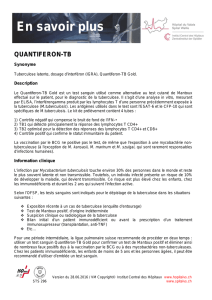La tuberculose pulmonaire chronique inactive et les séquelles du

INT J TUBERC LUNG DIS 18(2):128–133
© 2014 The Union PERSPECTIVE
[Traduction de l’article : « Chronic inactive pulmonary tuberculosis and treatment sequelae: chest radiographic features » Int
J Tuberc Lung Dis 2014; 18(2): 128–133. http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.13.0360]
La tuberculose pulmonaire chronique inactive et les séquelles
du traitement : caractéristiques de la radiographie pulmonaire
A. Hicks,* S. Muthukumarasamy,† D. Maxwell,‡ D. Howlett†
*
Department of Respiratory Medicine and Allergy, Kings College London, London, †
Department of Radiology,
Eastbourne District General Hospital, Eastbourne, ‡
Department of Respiratory Medicine, Eastbourne District General
Hospital, Eastbourne, UK
Auteur pour correspondance : Alexander Hicks, Department of Respiratory Medicine and Allergy, Kings College London,
Guy’s Hospital, Great Maze Pond, London SE1 9RT, UK. Tel: (+44) 207 188 1943. Fax: (+44) 207 403 8640. e-mail:
a lexander[email protected]
La radiographie pulmonaire est un outil clé dans le diagnostic initial des problèmes pulmonaires, notamment la tu-
berculose (TB). Grâce aux antituberculeux, la TB peut être traitée ef cacement et les modi cations radiologiques
sont donc généralement limitées. Cependant, les anti tuberculeux n’ont pas toujours été disponibles et dans certains
cas n’ont pas été mis en œuvre assez tôt dans le cours de la maladie. Dans ce cas, l’infection a pris le dessus et a causé
des dommages radiologiques visibles tels que des calci cations et une brose. Avant l’utilisation des antituberculeux,
différentes techniques chirurgicales ont été utilisées n de contrôler l’infection pulmonaire, comme la collapsothéra-
pie par différentes substances, l’écrasement du nerf phrénique et la thoracoplastie. Chacun de ces traitements avait
une traduction radio logique particulière. Cet article vise à décrire les signes radio logiques de la maladie chronique et
de leur traitement chirurgical parce que leur rareté croissante au l du temps peut compliquer leur interprétation. Ce-
pendant, avec l’augmentation de l’espérance de vie et la survenue de résistances aux antibiotiques qui relance leur uti-
lisation, la reconnaissance des signes radiologiques demeure importante.
MOTS-CLÉS : chirurgie thoracique ; plombage ; oleothorax ; Ghon
LA TUBERCULOSE (TB) est l’un des plus anciens
éaux de l’humanité et le séquençage du génome
suggère qu’un ancêtre précoce de la TB était présent
il y a 3 millions d’années, chez les premiers homini-
dés d’Afrique de l’Est.1 Des preuves historiques ulté-
rieures du éau de la TB au l des siècles incluent
des signes sur les squelettes chez des momies égyp-
tiennes âgées de 5000 ans et des documents écrits
émanant d’Inde et de Chine il y a respectivement
3300 et 2300 ans.2 Au cours du XIXe siècle, la mala-
die avait atteint des proportions épidémiques, avec
environ une personne sur quatre en Europe et en Amé-
rique du Nord mourant de TB.2
A cette époque, le traitement était relativement
basique et inef cace, les patients con nés en sanato-
rium pour un traitement basé sur le repos au lit et le
bon air. La compréhension du processus de la maladie
a fait un progrès signi catif en 1882 quand Robert
Koch a identi é Mycobacterium tuberculosis comme
agent causal.3 Dès le début du XXe siècle, l’incidence
de la TB a commencé à chuter.2 Les raisons de ce dé-
clin sont complexes, mais incluent probablement un
degré de sélection génétique, amenant une immunité
RÉSUMÉ
AH et SM ont contribué de manière équivalente à la rédaction de
cet article.
de groupe, et une amélioration des conditions de vie.4
A cette époque, le traitement continuait à être basé
sur l’admission en sanatorium, qui montrait quel-
ques preuves d’ef cacité.5 Les procédures chirurgica-
les étaient également préconisées comme méthode de
fermeture des cavités et de négativation des crachats.
Ces procédures incluaient une large gamme de tech-
niques, comme le pneumothorax provoqué, l’écrase-
ment du nerf phrénique, la thoracoplastie, le plom-
bage et l’oléothorax. Ces techniques apportaient une
certaine amélioration,2 et certains patients de cette
époque continuent à se présenter à l’hôpital avec
toute une gamme de signes radiologiques.
Les options thérapeutiques ont connu un dévelop-
pement spectaculaire au milieu du XXe siècle avec
la découverte des médicaments antituberculeux, ini-
tialement la streptomycine en 1944, aboutissant à
l’étude randomisée pionnière réalisée par le Profes-
seur Bradford-Hill.6 Ce médicament a été suivi par
l’isoniazide (INH) en 1952,7 et la rifampicine (RMP)
plus tard au cours de cette décennie. Ces agents phar-
macologiques ef caces ont signi cativement réduit le
recours à la chirurgie et les taux de TB ont régulière-
ment diminué. Il a même été suggéré dans les années
1960 que la TB pourrait être éradiquée. Ceci ne s’est
manifestement pas produit et en 2012, le rapport de

2 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le
éau de la TB a fait état d’une incidence mondiale de
8,7 millions de cas en 2011, avec un total de 1,4 mil-
lion de décès associés.8 Ces cas frappent principale-
ment l’Inde, la Chine et l’Afrique sub-saharienne.
Parmi ces cas, 310.000 étaient des TB multirésistantes
(TB-MDR, dé nies comme une résistance au moins à
l’INH et à la RMP).8
La TB pharmaco résistante a été rapportée dans
les années 1940, mais en raison des systèmes de soins
de santé chaotiques et d’une adhésion médiocre au
traitement dans de nombreuses régions du monde, la
TB-MDR augmente, ce qui a amené au moins en par-
tie l’OMS à déclarer une urgence sanitaire mondiale
en 1993.9 La TB-MDR pose des dé s signi catifs en
matière de soins de santé et le traitement antitubercu-
leux standard, qui a été le pilier thérapeutique, n’a
plus qu’un taux d’ef cacité de 48% dans ces cas.8 De-
vant l’expansion de la TB ultra-résistante, un nombre
limité de traitements chirurgicaux a à nouveau été en-
visagé dans des cas individuels a n de lutter contre
l’augmentation et les progrès de la maladie.10,11
BUT
Cet article vise à fournir un guide des signes radiolo-
giques vus soit en cas de TB chronique inactive, soit
en cas de conséquences à long terme du traitement
chirurgical. Bien qu’ils ne soient pas forcément spéci-
ques à la TB, ils constituent une aide utile au dia-
gnostic, surtout dans un contexte de ressources limi-
tées où l’on ne dispose pas toujours d’imagerie plus
élaborée. Grâce à la disponibilité de traitements anti-
tuberculeux ef caces au cours des 60 dernières années,
la majorité des signes radiologiques les plus étendus a
été perdue, ce qui rend leur interprétation plus dif -
cile pour des médecins moins expérimentés. Cepen-
dant, en raison du vieillissement de la population,
d’une immigration accrue émanant de pays à risque
élevé et d’une résistance croissante aux médicaments
antituberculeux, ce type d’images est encore observé
et doit être interprété avec exactitude. Un accent par-
ticulier sera mis sur les conséquences radiologiques
de la chirurgie, étant donné leur relative rareté hors
des centres spécialisés au cours des dernières années.
Radiologie de la tuberculose chronique inactive
Foyer de Ghon calci é
Un foyer de Ghon est une lésion pulmonaire où l’in-
fection et la consolidation sont à l’origine survenues
après une infection tuberculeuse chez un individu im-
munocompétent.12 Cette zone d’in ammation granu-
lomateuse est classiquement décrite soit dans la partie
inférieure du lobe supérieur, soit dans la partie supé-
rieure du lobe inférieur. Cependant, les études sem-
blent suggérer qu’il n’y a pas de prédominance régio-
nale en dehors d’une apparition plus fréquente dans
le poumon droit.13,14 Il peut se développer davantage
avec une zone de nécrose centrale et s’étendre aux
ganglions locaux (complexe de Ghon). Finalement,
sans traitement, la zone devient breuse et calci ée, et
est appelée à ce stade complexe de Ranke (Figure 1,
également visible sur la Figure 2 comme l’indiquent
les èches). Ce sont des foyers de Simon, c’est-à-dire
des nodules apicaux, souvent calci és, qui résultent
également de l’infection initiale suivant une diffusion
hématogène.15
Calci cation parenchymateuse
Les calci cations parenchymateuses (Figure 2) ap-
paraissent quand le granulome original consécutif à
Figure 1 Un foyer de Ghon calcifi é (fl èche) vu dans la périphé-
rie de la zone gauche moyenne et des adénopathies hilaires cal-
cifi ées, également appelées complexe de Ranke.
Figure 2 A) Calcifi cations bilatérales apicales et B) hilaires
droites ; C) foyers apicaux nodulaires de calcifi cations de Simon
résultant d’une infection initiale suivant une propagation hé-
matogène. Il y a également des signes de perte de volume du
lobe supérieur vus chez ce patient de 78 ans.

TB chronique inactive et séquelles du traitement 3
l’infection guérit et, dans 20–30% des cas, se calci-
e.16 Ce processus peut survenir dans n’importe quel
endroit du corps où se forme un granulome et il n’est
pas limité aux poumons.
Calci cation pleurale
Les calci cations pleurales (Figure 3) de la TB attei-
gnent généralement la plèvre viscérale et surviennent
après disparition de l’empyème (la persistance d’une
maladie active est probable chaque fois qu’il reste du
liquide au sein des couches calci ées). La calci cation
peut avoir un aspect de plume ou de dentelle, ou être
linéaire quand elle se trouve autour d’une effusion
enkystée ou empyème. La décalci cation peut surve-
nir si l’infection redevient active. La calci cation du
diaphragme est vue plus souvent en cas d’exposition
à l’amiante ; il faut cependant envisager la possibilité
de coexistence de la TB avec une asbestose.17 La cal-
ci cation peut être bilatérale, mais elle est générale-
ment unilatérale. Le diagnostic différentiel de toute
calci cation pleurale devrait inclure l’exposition à
l’amiante, un hémothorax préalable et d’autres infec-
tions à l’origine d’empyème. Des degrés variés de cal-
ci cation peuvent être observés (Figure 3). Cependant,
ils ne représentent pas forcément l’impact clinique
sur le patient, car ces calci cations resteront souvent
asymptomatiques en dépit de modi cations étendues
à la radiographie.
Calci cation péricardique
Des calci cations péricardiques peuvent également
apparaitre, soit comme le résultat d’une infection
anergique primaire, ou à la suite de la rupture d’adé-
nopathies médiastinales étroitement associées (Fi-
gure 4). Le degré d’impact clinique de cette calci ca-
tion varie, mais comme les deux couches du péricarde
sont atteintes, de multiples adhérences peuvent se
former, aboutissant à une péricardite constrictive im-
portante.17 La tomodensitométrie peut accroitre le
taux de diagnostic. L’échocardiogramme est souvent
utile pour quanti er le degré de brose et d’adhérence
qui sont apparues, re étant ainsi l’impact symptoma-
tique probable.
Fibrose
Le processus naturel de guérison de la TB aboutit à
des modi cations breuses à mesure que les granulo-
mes originaux sont remplacés par du tissu breux
pulmonaire plus mature (Figure 5). Cet effet cica-
trisant peut induire un aspect brotique à la radio-
graphie. La cicatrisation peut être extrême, ce qui fait
de la TB la cause non-in ammatoire la plus fréquente
Figure 3 Calcifi cations pleurales extensives ressemblant à une
plaque dans l’hémithorax gauche avec perte de volume asso-
ciée. Les modifi cations sont secondaires à une pleurite due à un
empyème tuberculeux.
Figure 4 Calcifi cations péricardiques denses chez une femme
de 96 ans avec une tuberculose préalable résultant d’une infec-
tion anergique ou d’une rupture d’adénopathies médiastinales
étroitement associées.
Figure 5 Fibrose apicale bilatérale et épaississement pleural
avec une élévation des deux hiles chez un homme de 60 ans
avec une tuberculose préalable.

4 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
de sténose bronchique.18 Chez des patients qui ont
une brose pulmonaire idiopathique préexistante, le
risque de développer une TB est quatre fois plus élevé.
Ces cas peuvent également constituer un dé diagnos-
tique, car ils sont plus susceptibles d’avoir une appa-
rence nodulaire atypique qui imite les signes radio-
logiques associés à la malignité.19
Modi cations cavitaires dans
la maladie chronique
La TB pulmonaire aigüe induit la formation de cavi-
tés pulmonaires dans environ 40–45% des cas dans
la phase post-primaire.20 L’apparition des cavités est
sans rapport avec le diagnostic, avec à la fois des pa-
rois lisses et nes et des parois nodulaires épaisses.15
Des boules fongiques (ou bactériennes) (Figure 6) dé-
couvertes dans des cavités préexistantes dans le pou-
mon sont souvent appelées mycétomes. Bien que des
boules fongiques puissent se développer dans n’im-
porte quelle cavité, les séries de cas ont montré que la
morbidité et la mortalité étaient plus élevées en cas de
cavités dues à la TB à cause du risque majoré d’hé-
morragie.21 Il faut également envisager la possibilité
de malignité et de réactivation de la maladie.
Modifi cations chirurgicales
Avant le développement de la chimiothérapie ciblant
spéci quement Mycobacterium tuberculosis dans les
années 1940, la chirurgie a été largement utilisée
dans le traitement de la TB pulmonaire. Le but théra-
peutique était d’obtenir un collapsus du poumon a n
de réduire l’environnement aérobie nécessaire à la
croissance des bactéries. Une grande variété de tech-
niques a été utilisée dans la première moitié du XXe
siècle. Quelques techniques, comme la pneumonecto-
mie ou la lobectomie, sont en voie de réintroduction
pour la TB pharmacorésistante, mais d’autres tech-
niques peuvent encore être vues occasionnellement
chez les personnes les plus âgées de la population pré-
sentant des problèmes pulmonaires. Ces signes peu-
vent souvent être initialement reconnus par les clini-
ciens ou les radiologues sur les radiographies ; nous
présentons ci-dessous des cas avec lesquels le clini-
cien devrait être familier.
Pneumothorax arti ciel
En 1880, le médecin français Emile Toussaint a
constaté les effets béné ques du pneumothorax spon-
tané chez des patients tuberculeux. Inspiré par ceci,
Carlo Forlanini a été le premier à décrire une mé-
thode d’introduction du pneumothorax arti ciel dans
un but thérapeutique en 1888.22 Sa technique impli-
quait de faire pénétrer de l’azote dans la cavité tho-
racique grâce à une pleurocentèse et de collaber le
poumon en l’absence d’adhérences pleurales. Cette
méthode est vite devenue populaire, et dans les années
1940, les patients étaient suivis pendant plusieurs an-
nées pour évaluer la progression de la maladie, avec
traitement de recharge au besoin. Les signes radiolo-
giques de cette procédure tombée en désuétude sont
souvent inapparents, et la majorité des pneumothorax
iatrogènes ont disparu dans la cohorte actuelle de pa-
tients se présentant à l’hôpital.
Ecrasement du nerf phrénique
L’avulsion ou l’écrasement du nerf phrénique a été
décrite par Stuertz en 1911, quand il a eu recours à
cette méthode pour traiter une TB du lobe inférieur.
Les résultats ont été variables et cette méthode a sou-
vent été utilisée comme adjuvant d’un pneumothorax
ou d’un pneumopéritoine arti ciel et d’une thoraco-
plastie.23 Les effets résiduels d’une blessure du nerf
phrénique peuvent durer de 6 mois à 2 ans et de fa-
çon permanente dans 20% des cas (Figure 7).24
Thoracoplastie
La thoracoplastie a été utilisée pour réduire le volume
de l’hémithorax et, dans le cas de la TB, pour compri-
mer les cavités pulmonaires (Figure 8). Elle a souvent
été réalisée en deux étapes impliquant de multiples
résections des côtes, qui permettaient un collapsus
pulmonaire, et l’apposition de la plèvre viscérale et
Figure 6 Cavité à parois épaisses dans l’apex droit, avec un
croissant aérique autour d’une boule fongique à aspergillus,
conforme à un mycétome.
Figure 7 Un patient de 75 ans avec des antécédents de para-
lysie du nerf phrénique bilatéral. On voit le faible volume pul-
monaire alors que le cliché est en inspiration forcée. Des calcifi -
cations intrapulmonaires bilatérales étendues sont conformes à
des antécédents de tuberculose.

TB chronique inactive et séquelles du traitement 5
pariétale. En 1925, John Alexander, qui souffrait lui-
même de TB spinale, a développé la technique utilisée
de nos jours pour la thoracoplastie. Une procédure
en deux étapes impliquait souvent la résection d’un
maximum de cinq côtes, tandis qu’une procédure en
trois étapes allait jusqu’à la résection de huit côtes,
en fonction du degré de collapsus requis.25
Plombage
La technique de plombage a émané de techniques
e xtrapleurales et extrafasciales visant à induire un
collapsus pulmonaire (Figure 9). Plombe est un mot
danois signi ant « joint de plomb ». Avant cette tech-
nique, divers matériaux comme l’huile, la graisse, le
sang et la paraf ne ont été utilisés. En 1945, Wilson
et al. ont utilisé des sphères de méthyle méthacrylate
insérées dans l’espace extrapleural. Elles étaient sem-
blables à des balles de ping-pong et étaient insérées
dans des sacs en plastique pour éviter leur migration.
Cette procédure était souvent réalisée en une seule
fois et pouvait être utilisée des deux côtés. Elle béné -
ciait souvent aux patients trop malades pour envisa-
ger une thoracoplastie.26
La première indication d’un plombage est une ca-
vité apicale < 4 cm. Des complications tardives peu-
vent survenir en cas de plombage, qui peuvent être
évidentes en imagerie. Ce sont notamment une infec-
tion (dont la tuberculose), une cancérisation autour
du site de plombage (notamment de nature sarcoma-
teuse), ainsi qu’un effet de masse locale dû à la migra-
tion de la balle et pouvant à son tour entrainer des
complications comme une obstruction de la veine
cave supérieure, une irritation du plexus brachial et
une stule bronchopleurale et cutanée.26
Oléothorax
L’oléothorax était une méthode d’expansion théra-
peutique qui impliquait une injection d’huile intra- ou
extra-pleurale, généralement de la paraf ne ou une
huile minérale. La procédure était censée être ef cace
pendant 18–24 mois, l’huile étant ensuite retirée. Ce-
pendant, la majorité des patients restait asymptoma-
tique et le retrait de l’huile n’était pas fait. Cette pro-
cédure a été largement abandonnée dans les années
1950.27 La Figure 10 montre un oléothorax de l’es-
pace pleural gauche et des calci cations pleurales vi-
sibles à droite, probablement un résultat d’un em-
pyème préalable.
CONCLUSION
Devant une population vieillissante et la survenue
de la TB-MDR, cet article revisite les signes visibles
sur les radiographies pulmonaires montrant à la fois
Figure 8 Une thoracoplastie unilatérale chez une femme de
90 ans. On voit également des calcifi cations parenchymateuses
droites hautes typiques d’antécédents de tuberculose.
Figure 9 Un patient de 76 ans avec un antécédent de procé-
dure de plombage unilatéral pour la tuberculose.
Figure 10 Oléothorax du côté gauche. Le côté droit dé-
montre des antécédents de pleurite secondaire à un empyème
tuberculeux.
 6
6
1
/
6
100%