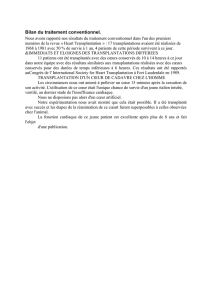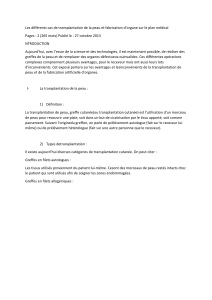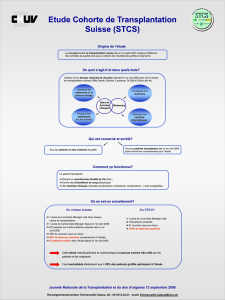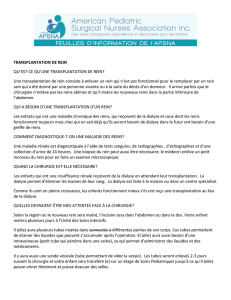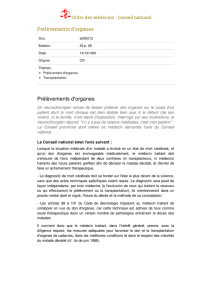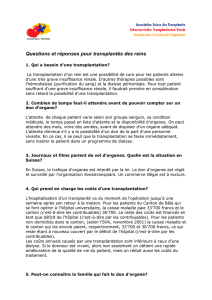Est-il acceptable de transplanter des reins dits "marginaux" ?

●C. Legendre*
Éthique
Le Courrier de la Transplantation - Volume II - n o4 - oct.-nov.-déc. 2002
174
Les résultats de la transplantation rénale se sont considérablement
améliorés au fil du temps. La mortalité observée au cours de la première
année de transplantation est, à l’heure actuelle, inférieure à 5 %,
et le pourcentage de survie du greffon est supérieur à 90 % à un an dans
la plupart des équipes. Une des conséquences de cette amélioration
des résultats est que de plus en plus de patients souhaitent bénéficier
de ce traitement, ce qui crée inévitablement une inadéquation croissante
entre la demande et l’offre, d’où la situation de pénurie actuelle de greffons.
Pour limiter cette situation de pénurie, plusieurs solutions pratiques
sont envisageables : augmenter le nombre de prélèvements effectués
chez des patients en état de mort encéphalique, développer
la transplantation à partir de donneurs vivants apparentés ou non et,
enfin, utiliser des reins dits “marginaux”. L’appellation “rein marginal”
est un euphémisme pudique désignant un rein dont la qualité est considérée
comme inférieure à celle d’un rein “idéal”, et dont la transplantation
donnera ou risquera de donner des résultats globalement inférieurs à ceux
de reins “idéaux”. Nous tenterons, dans cet article d’esquisser tout d’abord
une définition du rein “marginal”, puis d’en établir les conséquences
prévisibles chez le futur receveur. Nous envisagerons ensuite
quelle information peut et doit être donnée au futur receveur
et à quel moment elle doit être délivrée, ainsi que les conséquences
pratiques de cette information. Nous verrons que cette information pose
indirectement le problème plus général et plus complexe de l’équité
de l’accès à la transplantation.
DÉFINITION DU REIN “MARGINAL”
Il n’existe pas dans la littérature de transplantation de définition claire
et unanimement reconnue du rein “marginal”. Est donc considéré comme
“marginal” un rein dont une ou plusieurs des caractéristiques s’éloignent
soit de la moyenne des reins prélevés, soit du rein considéré comme “idéal”.
Les critères le plus souvent retenus, isolément ou en association,
sont donc l’âge du donneur (plus de 50, 55 ou 60 ans, en fonction des études
et des pays), la cause du décès d’origine cardiovasculaire, les antécédents
cardiovasculaires (hypertension artérielle, diabète), ainsi que la fonction
rénale (créatininémie supérieure à 150 mmol/l, par exemple).
On peut également classer dans cette catégorie les reins prélevés
chez des donneurs très jeunes, les reins comprenant des artères multiples,
les reins transplantés avec une ischémie froide exagérément longue
(supérieure à 36 heures) et les reins prélevés sur des donneurs à cœur non
battant. Malgré cette imprécision dans la définition, les conséquences
délétères de la transplantation d’un rein marginal ne font aucun doute.
Si l’on considère les résultats des transplantations effectuées avec ce type
de greffon, on note une augmentation de la fréquence de reprise retardée
de fonction, une diminution de la fonction de filtration du greffon,
une diminution du pourcentage de survie du greffon à court et moyen terme.
À titre d’exemple, si l’on analyse les données du registre nord-américain
UNOS, la survie du greffon à 5 ans est de 57 % si le donneur est âgé de plus
de 60 ans et de 66 % s’il est âgé de moins de 60 ans, différence
statistiquement significative (1). Il faut toutefois relativiser ces chiffres.
Dans notre expérience, les transplantations avec un rein de plus de 60 ans
ont une durée de survie de 81 % à 5 ans contre 88 % dans le cas contraire.
Certes, la différence se fait aux dépens du groupe des reins marginaux, mais
ce résultat ne peut néanmoins pas considéré comme inacceptable.
* Service de néphrologie, hôpital Saint-Louis, Paris.
Est-il acceptable
de transplanter
des reins
dits “marginaux” ?
Nous remercions
pour son soutien

Il est donc admis schématiquement que les transplantations
effectuées avec des reins marginaux ont des résultats
inférieurs à ceux des transplantations effectuées avec des
reins sinon idéaux, du moins dans la norme, ce qui n’est,
bien évidemment, guère surprenant. Mais la véritable question
est avant tout de savoir si ces résultats, même inférieurs,
sont acceptables, et pour qui : les patients eux-mêmes,
la société, les néphrologues ? Tenter de répondre
à cette question constitue déjà un premier pas
dans la détermination du contenu de l’information
délivrée au patient.
CONSÉQUENCES CHEZ LE FUTUR RECEVEUR
Ces résultats sont-ils acceptables par les patients ?
Autrement dit, les patients en attente de transplantation
peuvent-ils accepter l’idée qu’ils seront éventuellement
transplantés avec un risque d’échec accru en raison, non pas
de leurs propres caractéristiques (type de néphropathie
initiale, hyperimmunisation anti-HLA, etc.), mais du rein
qui leur sera transplanté ? En pratique, les patients
concernés sont ceux qui ont une faible chance soit d’être
transplantés vite (groupe ABO ou HLA rare), soit, même,
d’être un jour transplanté, en raison en particulier de l’âge
avancé, soit une combinaison des deux. La pratique
quotidienne démontre que cette information sur les reins
marginaux est bien reçue par les patients des catégories
sus-citées. Plusieurs pays européens qui utilisent des reins
marginaux ont entrepris de poser la question à leurs patients
en liste d’attente, soit à titre purement indicatif,
soit dans le but de leur attribuer ce type de greffon le cas
échéant. Par exemple, à Malmö (Suède), une information
écrite a été adressée à 61 patients, dont 53 ont répondu (2).
Cette information sur les reins marginaux était assortie
d’une question concernant une prise de position personnelle
sur le fait d’être ou non transplanté avec ce type de rein.
Enfin, il était demandé aux patients s’ils considéraient
que ce type de décision était ou non difficile à prendre.
L’anonymat des patients a été respecté. Sur les 53 réponses,
l’information a été considérée comme compréhensible
par 48 patients et suffisante par 43. Aucun n’a considéré
que l’information était trop complète.
Quarante et un patients ont estimé qu’il était parfaitement
légitime d’être interrogé de la sorte, tandis que deux ont émis
l’avis inverse. Enfin, 33 patients ont considéré
qu’il s’agissait d’une décision facile à prendre !
Les résultats de cette étude de taille modeste sont cependant
tout à fait évidents : les patients souhaitent être informés
et donner leur avis sur cette question des reins marginaux.
Il convient de souligner que les patients les plus concernés
dans cette étude étaient les patients âgés de plus de 60 ans,
c’est-à-dire ceux pour qui ce choix n’est pas une hypothèse
d’école, mais bel et bien une réalité s’ils veulent un jour
avoir accès à la transplantation.
En effet, que ce soit affiché clairement ou non,
les reins marginaux sont attribués en priorité aux plus âgés
des futurs receveurs. Dans notre expérience, à l’hôpital
Saint-Louis, les receveurs d’un rein âgé de plus de 60 ans
ont en moyenne 9 ans de plus que ceux à qui est attribué
un rein de moins de 60 ans. Dans l’organisation
Eurotransplant (3), un programme intitulé “Old for Old”
formalise parfaitement cette volonté d’attribution prioritaire,
tandis qu’aux États-Unis, une réunion de consensus a eu lieu
au printemps 2001 sur ce sujet. Il a été proposé d’attribuer
les reins âgés de plus de 60 ans à des patients volontaires
pour accepter ce type de rein sans, bien entendu,
qu’ils aient accès uniquement à ce type de rein.
L’utilisation de reins marginaux est-elle acceptable
pour la société ? Cette question revient à comparer le coût
d’une transplantation dont la durée est moins longue
que la moyenne de celle des transplantations effectuées
avec des reins non marginaux par rapport à la poursuite
d’une hémodialyse ou d’une dialyse péritonéale.
Là encore, on dispose de peu de données économiques.
Si l’on considère schématiquement que chaque année
de transplantation après la première année coûte environ
le sixième du coût d’une année d’hémodialyse en centre,
il n’est pas absurde de penser qu’une durée
de transplantation même plus courte est d’un coût
économique pour la société. Il serait bien entendu préférable
de l’étudier et de le démontrer !
L’utilisation des reins marginaux est-elle acceptable
pour les médecins néphrologues ? Il ne fait certes aucun
doute que la transplantation améliore la qualité de vie
des patients par rapport à la dialyse de suppléance ;
cela est bien documenté dans la littérature (4).
Aux États-Unis, il est également bien démontré
que la transplantation apporte aux patients un gain
en termes de quantité de vie lorsqu’ils sont transplantés (5).
En effet, lorsqu’une transplantation dure plus de 244 jours,
la survie au-delà est un gain de vie par rapport
à l’hémodialyse ! On ne dispose pas de données
comparatives européennes ni françaises, et il n’est donc
pas certain que l’on puisse extrapoler ces résultats,
dans la mesure où la qualité de la dialyse en Europe
et au Japon est supérieure à celle qui prévaut aux États-
Unis. Là encore, nous manquons cruellement de données.
Aux États-Unis encore, il a été récemment démontré
par Ojo et al. (6) que le gain de vie apporté
par la transplantation avec un rein marginal était,
certes moindre que celui apporté par une transplantation
avec un rein “idéal”, mais significativement supérieur
à celui apporté par le maintien en hémodialyse
de suppléance. Il ne faut toutefois pas oublier qu’un échec
de transplantation fait courir au patient,
outre les complications inhérentes à la transplantation
et au traitement immunosuppresseur,
Éthique
Le Courrier de la Transplantation - Volume II - n o4 - oct.-nov.-déc. 2002
175

le risque d’immunisation, voire d’hyperimmunisation
anti-HLA, qui rend plus difficile l’accessibilité
à une autre transplantation. On peut aussi tout à fait
comprendre une attitude de principe qui consiste
à ne transplanter un patient qu’avec un rein “idéal”,
au risque cependant de ne pas pouvoir le transplanter.
QUELLE INFORMATION DÉLIVRER AU RECEVEUR ?
Dans ce contexte, quelle information au sujet des reins
marginaux est-il possible et souhaitable de délivrer
au patient en attente de transplantation ?
Cette information spécifique s’intègre dans une information
plus générale sur les bénéfices, les risques et les contraintes
de la transplantation, les règles de répartition des organes,
les résultats escomptés ainsi que les modalités pratiques
du déroulement de la transplantation et de son suivi
immédiat et à moyen terme. Cette information doit être
délivrée par le médecin transplanteur au cours de la
ou des consultation(s) pré-transplantation. Elle est ensuite
relayée par le médecin néphrologue et alimentée
par des discussions en famille et avec les autres patients
en dialyse. Il me paraît donc fondamental de tenir
un langage de vérité et d’expliquer le plus clairement
possible les risques inhérents à l’utilisation des reins
marginaux, mais de mettre également en regard les bénéfices
d’une transplantation, ainsi que la possibilité même
d’être transplanté un jour. Cet enjeu est particulièrement
crucial pour les patients les plus âgés qui, d’une part,
sont souvent (à tort) persuadés qu’ils ne sont pas prioritaires
pour l’obtention d’un greffon et, d’autre part,
sont effectivement dans l’incapacité d’attendre un greffon
aussi longtemps qu’un patient plus jeune.
C’est d’ailleurs chez les patients les plus âgés
que le problème des reins marginaux est abordé avec le plus
de facilité, voire une sérénité teintée de fatalisme !
Il est important que cette information et la discussion
qui s’ensuit aient lieu au moment de la consultation
pré-transplantation car, lorsque le patient est inscrit
sur une liste d’attente, il pourra être amené à être confronté
à ce choix, qui sera d’autant moins difficile qu’il aura
réfléchi à ce sujet. En effet, au moment de la proposition
d’un rein marginal, il me paraît indispensable que le patient
puisse discuter avec son néphrologue traitant, le plus proche
du patient et donc le plus à même de l’écouter, de le conseiller
et de l’aider à prendre la décision finale avec davantage
de sérénité. C’est dire que, là aussi, le médecin transplanteur
doit avoir un rôle pédagogique vis-à-vis du néphrologue
traitant. Il serait également utile de pouvoir disposer
d’un document d’information (si possible consensuel
entre toutes les équipes !) qui reprenne les différents points
abordés au cours de la consultation pré-transplantation,
afin que le patient puisse, le cas échéant, s’y reporter
et approfondir certains aspects avec son néphrologue traitant
ou le médecin transplanteur.
Pour établir le bien-fondé de cette attitude pragmatique,
il conviendrait de disposer d’une étude rétrospective menée
auprès des patients qui ont été transplantés avec un rein
marginal pour connaître finalement leur sentiment vis-à-vis
de cette transplantation. En première approximation,
je répondrais à la faveur d’une expérience personnelle que,
dans la très grande majorité des cas, une transplantation
qui ne se traduit pas par un échec en moins de trois mois
est considérée par les patients comme un bénéfice,
sinon sur le plan strictement médical, mais assurément
sur le plan personnel, en termes de qualité de vie.
ÉQUITÉ DE L’ACCÈS À LA TRANSPLANTATION
L’utilisation des reins marginaux en transplantation pose,
enfin, le difficile problème de l’équité d’accès
à la transplantation. En France, l’organisation
de la transplantation rénale est essentiellement régionale.
Si l’on considère le délai d’attente des patients inscrits
dans différentes régions, on observe des disparités
considérables dues à de multiples facteurs
(activité de prélèvement, épidémiologie de l’insuffisance
rénale, critères d’inclusion sur les listes d’attente, etc.).
De plus, au sein d’une même région, certains patients
au phénotype ABO et HLA rare auront un délai d’attente
supérieur à la moyenne. Aucun système de distribution
des organes n’est, bien sûr, parfait ni parfaitement équitable.
On doit certes s’interroger sur les causes profondes
de cet état de fait, mais il faut avant tout en prendre conscience.
Il est bien évident, par conséquent, que les reins marginaux
sont davantage utilisés dans les régions de longue attente,
l’Ile-de-France en particulier. Il faut également noter que
l’utilisation de ces reins marginaux devrait s’accompagner,
pour tenter d’améliorer au maximum les résultats, de conditions
de transplantation différentes : règles d’attribution différentes,
durée d’ischémie froide raccourcie, immunosuppression
moins néphrotoxique, chirurgiens “seniors”.
Dans une situation de pénurie relative, à condition
de se donner les moyens de les transplanter différemment
et après avoir informé les futurs receveurs,
l’utilisation des reins marginaux en transplantation
me paraît sinon idéale, du moins acceptable. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Cecka JM. The UNOS scientific renal transplant registry, 2000. In : J.M. Cecka,
P.I. Terasaki Ed, Clinical Transplants 2000, UCLA, Los Angeles, 2000 : 1-18.
2. Persson MO, Persson NH, Källen R et al. Kidneys from marginal donors : views of
patients on informed consent. Nephrol Dial Transplant 2002 ; 17 : 1497-502.
3. Smits JM, Persijn GG, van Houwelingen HC et al. Evaluation of the Eurotransplant
Senior Program. The results of the first year. Am J Transplant 2002 ; 2 : 664-70.
4.Dew MA, Switzer GE, Goycoolea JM et al. Does transplantation produce quality of life
benefits ? A quantitative analysis of the literature. Transplantation 1997 ; 64 : 1261-73.
5. Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL et al. Comparison of mortality in all patients on
dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first cadave-
ric transplant. N Engl J Med 1999 ; 341 : 1725-30.
6. Ojo AO, Hanson JA, Meier-Kriesche H et al. Survival in recipients of marginal
cadaveric donor kidneys compared with other recipients and wait-listed transplant
candidates. J Am Soc Nephrol 2000 ; 12 : 589-97.
Éthique
Le Courrier de la Transplantation - Volume II - n o4 - oct.-nov.-déc. 2002
176
1
/
3
100%