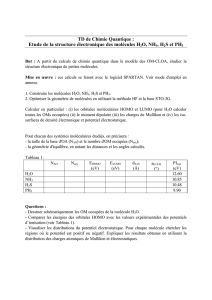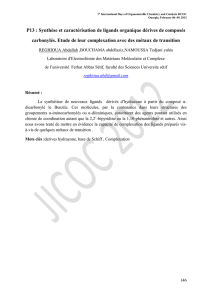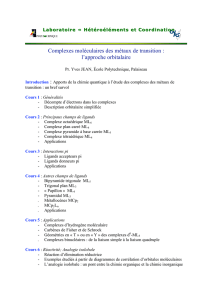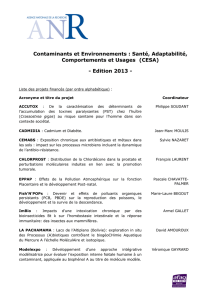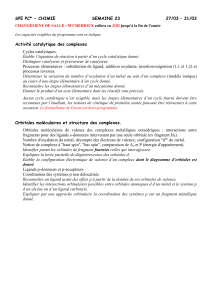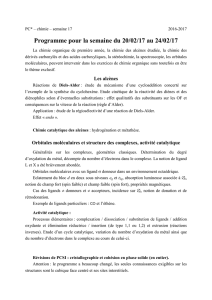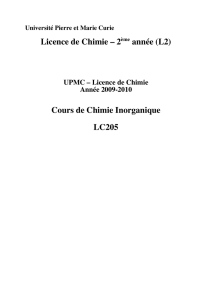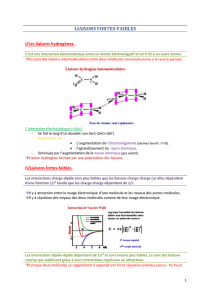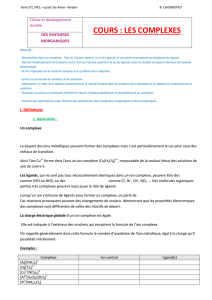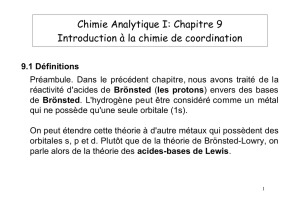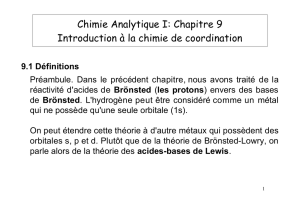courant

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III
95
Chapitre III. Chimie des éléments du bloc d
III.A. Généralités sur les éléments de transition
III.A.1. Définitions
Définition restrictive : un élément de transition est un élément qui possède une sous-couche d ou f
incomplète ;
Définition élargie : un élément de transition est un élément qui possède une sous-couche d ou f
incomplète, dans l’un de ses états d'oxydation usuels.
III.A.2. Configuration électronique des éléments d
[Ar] Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
3d 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10
4s 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
[Kr] Y Zr Nb Mo Tc* Ru Rh Pd Ag Cd
4d 1 2 4 5 5 7 8 10 10 10
5s 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2
[Xe] La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg
4f 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14
5d 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10
6s 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
III.A.3. Caractères généraux des éléments d
• Ce sont des métaux ;
• Ils peuvent présenter de nombreux états d'oxydation dont certains négatifs ;
• Ils forment de nombreux complexes ;
• Ces complexes sont souvent colorés et paramagnétiques ;
• La configuration électronique d’un complexe d’un élément d est de la forme dn, avec n = G - x, où
G est le numéro du groupe et x le nombre d'oxydation (algébrique) du métal.
III.B. Classification des ligands
III.B.1. Bases de Lewis
Dans le cas des complexes des cations métalliques de degré d’oxydation moyen ou élevé
(complexes de Werner, cf. III.C.), la liaison métal–ligand (ou liaison de coordination) est assurée
par un (ou plusieurs) doublet(s) d'électrons apporté(s) par le ligand (liaison dative) : le ligand est
base de Lewis ; le cation métallique est acide de Lewis.
III.B.1.a. Ligands monodentes
Classification selon l'élément donneur :
• halogène : F-, Cl-, Br-, I-.
Exemples : [FeF6]3–, [FeCl4]–, [HgI4]2–…
• oxygène : H2O, OH-, RO-, O2–, O2, O2
–, O2
2–, NO2
–...
Exemples : [FeII(H2O)6]2+, [CrVIO4]2–, [CoIII(ONO)(NH3)5]2+
• soufre : S2-, R2S, RS-, SCN-....

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III
96
Exemples : [MoVIS4]2–, [CoIII(CN)5(SCN)]3–
• azote : NH3, NH2-, NH2-, N3-, pyridine, NCS-, N2, NO, NO2-...
Exemples : [CoIII(NH3)6]3+, [OsVINCl5]2–, [RuII(N2)(NH3)5]2+, [CoIII(NCS)(NH3)5]2+,
[FeI(NO)(H2O)5]2+, [IrIII(NO)Cl2(PPh3)2]
• carbone : CN–, CH3
–...
Exemples : [FeIII(CN)6]3-, [W(CH3)6]
Remarque : les ligands SCN- qui peut se lier par le soufre ou par l’azote, et NO2-, qui peut se lier
par l’oxygène ou par l’azote sont ambidentes. Ils peuvent de plus adopter des modes de
coordination en pont entre deux centres métalliques (cf. III.B.1.d.).
NB : l’atome donneur est souligné.
III.B.1.b. Ligands bidentes
• CH3COCHCOCH3- (acétylacétonate : acac). Exemples : [CrIII(acac)3],
• C2O42- (oxalate : ox). Exemples : [CrIII(ox)2(H2O)2]+, [CrIII(ox)3]3–
• H2NCH2CH2NH2 (éthylènediamine : en). Exemples : [CoIIICl2(en)2]+, [CoIII(en)3]3+...
• bipyridine (bpy). Exemple : [Ru(bpy)3]2+
• H2NCH2CO2- (glycinate : gly). Exemple : [Co(gly)3]
NB : l’ion glycinate se lie par l’atome d’azote et par un atome d’oxygène de la fonction
carboxylate.
III.B.1.c. Ligands multidentes
• NH(CH2CH2NH2)2 (dien). Exemple : [Co(dien)2]3+
• H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2 (trien)
• Porphyrines (Por).
• (O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)24- (éthylèdiaminetétra-acétate : edta).
Exemples : [CrIII(edta)(H2O)]–, [CoIII(edta)]–, [FeIII(edta)(H2O)]–. Le ligand edta est pentadente
dans le complexe [CrIII(edta)(H2O)]– (un groupe carboxylate est pendant) et hexadente dans les
complexes [CoIII(edta)]– (coordinence 6) [FeIII(edta)(H2O)]– (coordinence 7).
III.B.1.d. Ligands pontants
• CN- : [(CN)5Co-NC-Fe(CN)5]6-
• N2 : [(NH3)5RuIINNRuII(NH3)5]4+
• O2
2– : [(NH3)5CoIII(O2)CoIII(NH3)5]4+
• O2
– : [(NH3)5CoIII(O2)CoIII(NH3)5]5+
• NO2- : [(NH3)4CoIII(µ-NH2)(µ-ONO)CoIII(NH3)4]4+
III.B.2. Acides de Lewis
La stabilisation des complexes des bas degrés d’oxydation des métaux de transition exige des
ligands qui soient non seulement des bases de Lewis mais de plus des acides de Lewis afin de
limiter la densité électronique sur le métal. Ces ligands disposent d’orbitales vacantes accessibles
(énergie suffisamment basse) et de symétrie adaptée. Le ligand carbonyle, CO en est le prototype.
Exemples : [Cr0(CO)6], [Fe-II(CO)4]2-...
Remarque : NO+, CO, N2 et CN– sont isoélectroniques. La basicité de Lewis augmente dans l’ordre :
NO+ < CO < N2 < CN– tandis que l’acidité de Lewis diminue dans l’ordre : NO+ > CO > N2 > CN–.

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III
97
III.C. Théorie de Werner – Stéréochimie des complexes
III.C.1. Théorie de Werner
III.C.1.a. Concept de coordinence
• Données expérimentales concernant les complexes de cobalt(III) :
composition couleur série nombre d’ions Cl– formulation actuelle
immédiatement
précipités par Ag+
CoCl3.6NH3 orange lutéo 3 [Co(NH3)6]3+, 3Cl-
CoCl3.5NH3 pourpre purpuréo 2 [CoCl(NH3)5]2+, 2Cl-
CoCl3.4NH3 vert praséo 1 trans-[CoCl2(NH3)4]+, Cl-
CoCl3.4NH3 violet violéo 1 cis-[CoCl2(NH3)4]+, Cl-
CoCl3.3NH3 bleu-vert 0 [CoCl3(NH3)3]
III.C.1.b. Concept de stéréochimie
• [CoCl2(NH3)4]2+ ne présente que deux isomères géométriques ;
• [Co(en)3]3+ et [Co(NO2)2(en)2]+ peuvent être dédoublés en inverses optiques.
Ces complexes ont une géométrie octaédrique.
• [PtCl2(NH3)2] présente deux isomères géométriques.
Ce complexe est plan-carré.
III.C.2. Stéréochimie des complexes de coordination
III.C.2.a. Coordinences et géométries courantes
Coordinence Polyèdre de coordination Exemples
2 linéaire [CuCl2]-, [Ag(NH3)2]+
4 tétraèdre [CrO4]2-, [MnO4]-, [FeCl4]- ]-, [Ni(CO)4]
4 plan-carré [Ni(CN)4]2-, [PtCl4]2-
5 bipyramide trigonale [CuCl5]3-, [Ni(CN)5]3-
5 pyramide à base carrée [Ni(CN)5]3-, [Co(CN)5]3-
6 octaèdre [Cr(H2O)6]3+, [Cr(NH3)6]3+, [Cr(ox)3]3-
III.C.2.b. Stéréoisoméries
III.C.2.b.α. Définitions
• Stéréoisomères : molécules possédant les mêmes atomes, les mêmes séquences de liaisons mais
différant par leur arrangement dans l'espace.
• Enantiomères : un énantiomère est un stéréoisomère qui n'est pas superposable à son image dans
un miroir. Les énantiomères sont encore parfois appelés antipodes optiques, en raison de leur action
sur le plan de polarisation d'une onde plane polarisée rectilignement : l'un des isomères fait tourner
le plan dans un sens (+α) le second, dans l'autre (-α).
• Diastéréoisomères : ce sont des stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères.
• Asymétrique : qualifie une molécule dépourvue de tout élément de symétrie.
• Dissymétrique : qualifie une molécule dépourvue d'axe impropre Sn.
• Chiralité : un composé asymétrique ou dissymétrique est chiral (il ne peut pas être superposé à son
image dans un miroir). Une molécule est chirale lorsqu’elle ne possède ni plan de symétrie ni centre
d’inversion. Plus précisément une molécule est chirale à condition qu’elle ne possède pas d’axe

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III
98
impropre d’ordre n (un axe impropre d'ordre n correspond à une ou plusieurs répétitions de la
séquence suivante : rotation de 2π/n suivie d'une réflexion par rapport à un plan perpendiculaire à
l'axe de rotation). Les complexes [Co(en)3]3+, cis-cis-cis-[Co(CN)2(NH3)2(H2O)2]+ et
[PtClBrI(py)(NO2)(NH3)] sont chiraux.
III.C.2.b.β. Complexes de coordinence 4 ou 6
• Complexes octaédriques
Type
Isomères
Exemples
stéréo
diastéréo
énantio
[Mabcdef]
30
15
30
[Pt(Br)(Cl)(I)(NO2)(NH3)(py)]
[Ma2b2c2]
6
5
2
[Co(CN)2(NH3)2(H2O)2]+
[PtCl2(NH3)2(py)2]2+
[Ma4b2]
3
2
cis, trans
2
[CoCl2(NH3)4]+
[Ma3b3]
3
2
mer, fac
2
[IrCl3(PPh3)3]
• Complexes plans-carrés
Type
Isomères
Exemples
stéréo
diastéréo
énantio
[Mabcd]
3
3
0
[Pt(NH3)(NH2OH)(py)(NO2)]+
[Ma2b2]
2
cis, trans
2
0
[PtCl2(NH3)2]
NB : a, b, c, d, e, f désignent des ligands monodentes.
III.D. Nomenclature des complexes de coordination
III.D.1. Formules
Dans les formules, la règle veut que l'on place d'abord le symbole du métal ; les ligands
ioniques suivent, puis les neutres, et la formule du complexe est enfermée entre crochets.
Ex : [CoCl(NH3)5]2+, [Fe(CN)6]3-
III.D.2. Noms des ligands
III.D.2.a. Les noms des ligands anioniques, qu'ils soient minéraux ou organiques,
finissent en -o : -ure devient uro ; -ate devient -ato.
Ex : nitrure → nitruro, acétate → acétato
L'usage courant comporte toutefois de nombreuses exceptions :
Ex : chlorure → chloro, cyanure → cyano, oxyde → oxo
III.D.2.b. Les noms des ligands neutres sont conservés :
Ex : 1,10-phénanthroline, éthylènediamine, pyridine
Il y a toutefois 4 exceptions importantes :
H2O → aqua, NH3 → ammine, CO → carbonyle, NO → nitrosyle
III.D.2.c. Les noms des ligands cationiques sont conservés.

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III
99
III.D.3. Préfixes
III.D.3.a. Préfixes multiplicateurs
mono, di, tri, tétra, penta, hexa, hepta, octa, nona,...
III.D.3.b. Préfixes structuraux
Ils donnent des informations structurales et sont écrits en italique avant le nom dont on
les sépare par un tiret.
Ex : caténa, cyclo, octaédro, cis, trans, mer, fac
III.D.4. Noms des complexes
Les noms des ligands apparaissent avant ceux du métal, et dans l'ordre alphabétique, sans
tenir compte de la charge et sans tenir compte du préfixe multiplicateur indiquant le nombre de
ligands. L'état d'oxydation du métal est indiqué en chiffre romain entre parenthèses après le nom.
La terminaison -ate est utilisée lorsque le complexe est anionique. Le nom du métal est inchangé
lorsque le complexe est neutre ou cationique.
Ex : [CoCl(NH3)5]Cl2 chlorure de pentamminechlorocobalt(III)
[RuCl3(py)3] fac-trichlorotris(pyridine)ruthénium(III)
K4[Fe(CN)6] hexacyanoferrate(III) de potassium
[(NH3)5Co-O-O-Co(NH3)5]4+ µ-peroxobis[pentamminecobalt(III)]
III.E. Théorie du champ cristallin
III.E.1. Levée de dégénérescence des orbitales d
La théorie du champ cristallin est un modèle purement électrostatique qui prend en compte la
répulsion entre les électrons d du centre métallique et les électrons des ligands. Au départ, les
ligands sont éloignés à l’infini de l’ion métallique ; lorsqu’on les rapproche, l’attraction
électrostatique assure la stabilité du complexe. Toutefois, les orbitales d du métal sont déstabilisées
par la répulsion exercée par les électrons des ligands. Mais elles ne le sont pas toutes de la même
manière : alors que dans l'ion libre (symétrie sphérique) les 5 orbitales d sont dégénérées, il n'en est
donc plus de même dans un complexe.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%
![[ ][][ MLn L M 10.3,6 ]) ([ ] [] [ = × = NH Ag NH Ag Kd](http://s1.studylibfr.com/store/data/002601672_1-57de8b0d2e37b3f5af3073b29cc142bc-300x300.png)