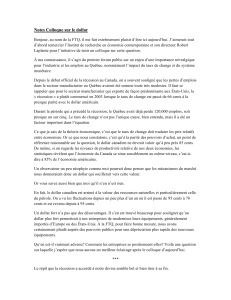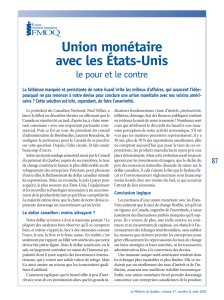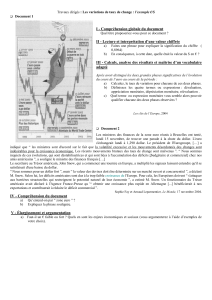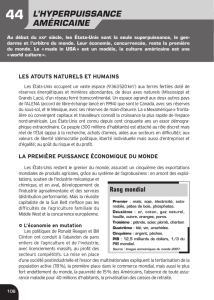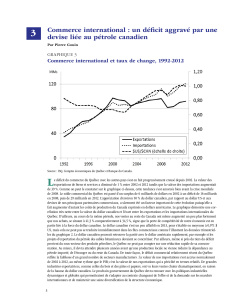Pierre Laliberté

C’est un peu court…
Dans sa chronique du 3 novembre dernier (Tous pour un…), Gérard Bérubé se livre à une
défense un peu rapide et plutôt panglossienne du statu quo monétaire au Canada.
Quand il s’agit du dollar, l’économie du Québec, particulièrement son secteur manufacturier, fait
face à un problème de volatilité de plus en plus difficile à gérer, difficulté aggravée par le niveau
artificiellement gonflé du taux de change par rapport à la devise de notre principal partenaire
commercial, les États-Unis.
Au cours des dernières années, propulsée par l’arrimage du dollar canadien au cours du pétrole en
parallèle avec l’anémie relative du dollar américain sur les marchés internationaux, on a vu le
cours passer de 64 cents en 2002 à 1.10 $ pour le voir redescendre à 78 cents en route et rebondir
ensuite à 94 cents aujourd’hui. Il s’agit ici, convenons-en, de fluctuations majeures entre deux
économies qui sont largement intégrées. Il s’agit là du premier problème.
À la parité des pouvoirs d’achat ou au niveau de productivité relative de nos économies, c’est à
peu près à 85 cents que devrait osciller le taux de change. Or, les dernières années nous ont plutôt
habitués à des taux s’approchant de la parité. À ces taux, certaines entreprises québécoises
trouveront certainement le moyen de s’adapter et de briller, mais la barre est haute et il est à
craindre qu’elle ne soit effectivement trop haute. Les rapports dont nous font écho des groupes
d’employeurs sont à cet égard plutôt pessimistes : une majorité d’entreprises au Québec
n’investissent pas pour se préparer à la reprise.
Si le Canada et les États-Unis ont signé une entente pour minimiser les interférences au
commerce entre les deux pays, il faut convenir que cela n’a pas tout réglé et que l’évaluation
fluctuante et inflationniste du dollar canadien est en voie de devenir un problème important pour
le secteur manufacturier au Québec et la création d’emplois dans ce secteur.
Aux entreprises manufacturières sous pression, M. Bérubé sert un discours plutôt darwiniste. Le
problème n’existerait que dans leur tête ou bien il existe et elles n’ont qu’à endurer : à le lire on
ne sait trop quelle part de l’alternative il privilégie.
Le sort de ce secteur est pourtant d’une importance cruciale pour le Québec. Bon an, mal an, ce
sont les exportations manufacturières qui permettent au Québec de boucler ses échanges avec le
reste du monde. Depuis 2002, le Québec fait des déficits de ses comptes courants à tous les ans.
On peut même affirmer que le taux de change a été un facteur beaucoup plus significatif dans la
croissance de nos échanges avec les États-Unis depuis 1989 que l’abaissement des barrières
tarifaires.
On se demande pourquoi une entreprise étrangère qui voudrait s’installer en Amérique choisirait
de le faire au Canada plutôt qu’aux États-Unis au vue de la volatilité et de l’évolution récente du
taux de change.
Devant la paralysie, voire l’indifférence des autorités monétaires canadiennes face au problème et
à proposer des solutions, il est normal qu’on pose la question des options alternatives.
Ce qu’il faut constater, c’est que le cours du dollar canadien est maintenant indissociable des
fortunes du cours du pétrole. Or, s’il faut en croire une proportion grandissante des analystes, ce

dernier est appelé à augmenter au cours des prochaines années. Que fera la Banque du Canada
face à cet état de fait? Que fera-t-elle lorsqu’elle devra compter, comme il n’y a pas si longtemps,
avec des montées inflationnistes à l’ouest alors que le niveau des prix sera sous contrôle ailleurs
au pays?
Évidemment, comme cela est fréquent en économie, chaque solution à un problème en crée un
autre. Des pistes existent pourtant et elles méritent d’être discutées.
L’option de fixer le taux de change, comme le font par exemple les pays asiatiques, semble vouée
à l’échec face au Léviathan des marchés spéculatifs. On pourrait par contre songer à imposer une
taxe sur les transactions financières quand la durée de possession des titres est inférieure à un an.
Cette taxe pourrait s’appliquer à la sortie des capitaux. Ce type de mesures éprouvé ailleurs dans
le monde pourrait mettre un frein partiel à des transactions à très court-terme et de nature
purement spéculatives. Elles ajouteraient une friction qui pourrait être salutaire, mais seraient
assurément répudiées par nos institutions financières.
Une union monétaire avec les États-Unis priverait effectivement le Canada d’une politique
monétaire autonome. Mais force est de constater que cette dernière ne varie guère de celle de la
Réserve fédérale depuis un bon bout de temps et que l’économie du Québec valse maintenant
dans un cycle économique qui se rapproche beaucoup plus de celui des États-Unis que de
l’Alberta. Par contre, le Canada n’aurait plus de prêteur de dernier recours et devrait fort
probablement coller la règlementation de son secteur financier à celle de son voisin : une
perspective peu invitante à plusieurs égards.
Une union monétaire aurait au moins le mérite de régler une fois pour toutes le problème de
fluctuations indues de la devise et pourrait permettre un arrimage entre les deux devises à un
niveau raisonnable.
Une autre possibilité serait évidemment pour le Québec de voler de ses propres ailes et de créer
une devise qui reflèterait davantage ses caractéristiques propres. On ne règlerait pas le problème
de la volatilité, mais au moins on éviterait les conséquences de la « maladie hollandaise » induite
par les sables bitumineux. Quand on dit qu’il y a matière à discussion.
Pierre Laliberté, Économiste
10795 Avenue Papineau, Montréal
1
/
2
100%