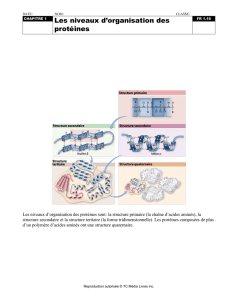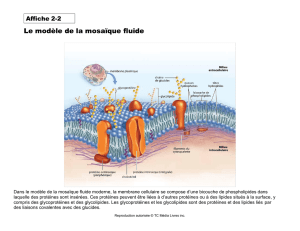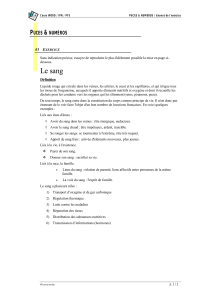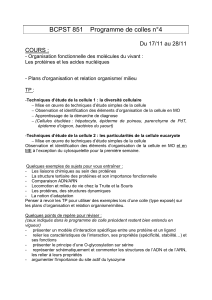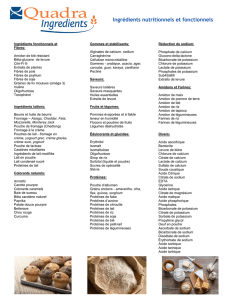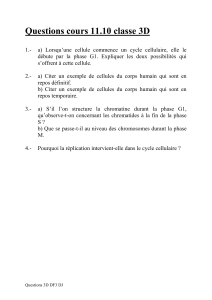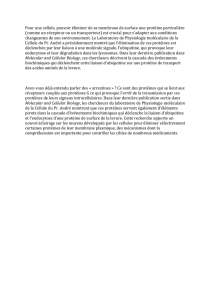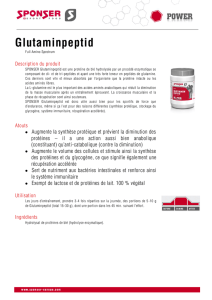milieu intérieur, quelques aspects de l`homéostasie 1 Les

II BIOLOGIE HUMAINE: milieu intérieur, quelques aspects de l'homéostasie
1 Les compartiments liquidiens de l'organisme:
Le document 2 donne la composition des différents compartiments liquidiens de
l'organisme.
1.1 Rédiger une analyse de ce document et en déduire l'identification de chaque
compartiment.
L'unité utilisée montre l'équivalence entre charges négative et positive: tous les compartiments sont
électriquement neutres, mais chacun a une ''concentration de charges'' qui lui est propre.
Deux compartiments ont des compositions semblables : A et B.
A et B ont une composition très différente du compartiment C.
C est caractérisé par une concentration en protéines très supérieure à celles de A et B; il possède
également une forte concentration en potassium . Ces deux critères caractérisent le liquide
intracellulaire (activités cellulaires réalisées par des enzymes protéiques )
A et B sont présentent des concentrations supérieures à C en sodium et chlorure, deux ions
caractéristiques des liquides extracellulaires : plasma et lymphe interstitielle.
La lymphe interstitielle est formée qu niveau des lits capillaires par ''filtration'' du plasma: les sels
minéraux sont filtrés mais pas les protéines. Les compositions sont donc très proches excepté pour
les protéines plus concentrées dans le plasma.
Donc A est le plasma et B la lymphe interstitielle.
1.2 Nommer les compartiments constitutifs du milieu intérieur. Donner la définition
du milieu intérieur.
Le milieu intérieur est le milieu extracellulaire, c'est à dire le plasma et la lymphe interstitielle.
Définition: notion inventée au 19ème siècle par Claude Bernard pour montrer la similitude des rôles
entre l'environnement marin des organismes unicellulaires ou pluricellulaires simples, et le plasma
et la lymphe interstitielle de l'homme.
1.3 Le document 3 présente un profil des protéines plasmatiques;
1.3.1 Rappeler succinctement le principe de la technique qui permet l'obtention de
ce type de profil.
Électrophorèse: les molécules d'une solution soumise à un champ électrique se déplacent en
fonction de leur charge globale. L'électrophorèse des protéines plasmatiques est réalisée sur un gel
d'agarose; ce support transparent permet la coloration spécifique des protéines puis la lecture
densitométrique (absorbance) aboutissant au profil du document 3.
1.3.2 Citer la protéine plasmatique correspondant à la légende alb. Citer la classe
de protéines correspondant aux autres légendes.
Alb= albumine: les autres classes légendées α à γ sont des globulines.
1.3.3 Citer l'intérêt de ce type d'examen des protéines plasmatiques.
Les hauteurs de pic du protéinogramme sont proportionnelles à la concentration massique de
chaque type de protéines. Un déséquilibre dans la répartition des différentes classes est rapidement
mis en évidence.
1.4 Parmi les protéines plasmatiques, on trouve la prothrombine et le fibrinogène.
1.4.1 Citer la fonction homéostatique à laquelle participent ces deux protéines.
L'hémostase; plus précisément l'hémostase secondaire ou coagulation
1.4.2 Donner le nom génériques des constituants intervenants dans ce phénomène.
Les facteurs de coagulation.
1.4.3 Replacer prothrombine et fibrinogène dans le document 4 (à compléter et à
rendre avec la copie)
1.4.4 Une avitominose K (déficit d'apport en vitamine K) peut être à l'origine de
troubles de la fonction homéostatique citée en 1.3.1; expliquer pourquoi.
La plupart des facteurs de coagulation sont synthétisés par le foie. Certaines de ces synthèses sont

vitamine K dépendante. Un déficit en vitamine K empêche donc la synthèse de ces facteurs. La
coagulation étant une suite de réaction ( cascade d'activation) l'absence d'un facteur suffit à bloquer
l'ensemble. La coagulation est donc pas ou peu efficace dans le cas d'une avitaminose K.
1.5 Beaucoup d'examens sanguins sont réalisés sur du sang veineux prélevé sur
EDTA. Donner le rôle de l'EDTA et son mode d'action.
L'EDTA est un anticoagulant. Il intervient en emprisonnant le calcium indispensable à la
coagulation.
2 Communication intercellulaire.
Les cellules communiquent entre elles afin de coordonner leurs activités.
2.1 Citer les modes de communications intercellulaires en rappelant leurs principales
caractéristiques.
La communication intercellulaire fait intervenir des messagers chimiques. La principale
caractéristique de chaque mode est l'espace de répartition de ce messager entre la cellule émettrice
et la cellule réceptrice.
Transmission directe : cytoplasmes en communication par jonctions lacunaires.
Transmission synaptique: très grande proximité des cellules émettrice et réceptrice
Transmission paracrine : espace de répartition réduit; communication de proximité
Transmission endocrine : espace de répartition = le plasma ( la circulation sanguine)
2.2 Les différences dans les compositions des milieux intracellulaire et
extracellulaire permettent d'expliquer l'existence d'un potentiel transmembranaire.
2.2.1 Faire un schéma légendé du montage expérimental permettant de mettre en
évidence l'existence de ce potentiel et de le mesurer.
Une électrode de référence externe. Une électrode interne.
2.2.2 Donner approximativement la valeur mesurée; expliquer son origine en
utilisant les données du document 1 et en appuyant la démonstration sur les
caractéristiques physiologiques de la membrane plasmique.
Mesure # - 70 mV
Origine : Cf doc 1 . Milieu intra et extracellulaire ont des potentiels différents, le premier étant
négatif par rapport au second ( inférieur sur le Doc 1).
Cette différence est due essentiellement aux ions Na+ et K q qui montrent des gradients de
concentration très forts. La membrane est peu perméable à ces deux ions mais cela se traduit par
une fiable diffusion tout de même : sortie de potassium et entrée de sodium dans la cellule.
Cet état est maintenu stable par des mouvement inverses dus à un transport actif assuré par l'ATPase
Na K dépendante.
Fibre nerveuse Oscilloscope
Na+
Na+
K+K+
diffusion
transport actif

2.2.3 Donner le nom donné à ce potentiel dans le cas des cellules excitables.
Potentiel de repos
2.2.4 Citer deux types cellulaires qualifiés de ''cellules excitables''.
Neurone. Cellule musculaire.
2.2.5 Citer deux protéines (ou complexes protéiques) membranaires
caractéristiques des membranes des cellules excitables.
Canaux sodium à ouverture commandée.
Canaux potassium à ouverture commandée.
2.3 Le potentiel d'action.
Le document 5 montre un enregistrement à l'oscilloscope de la variation du potentiel
transmembranaire d'une fibre nerveuse suite à une stimulation électrique.
2.3.1 Citer l'autre nom donné à une fibre nerveuse.
Axone
2.3.2 Faire un schéma légendé d'un neurone multipolaire et y indiquer par une
flèche une zone où la mesure de potentiel d'action pourrait être réalisée.
Cf cours
2.3.3 Donner le nom du phénomène enregistré sur le document 5.
Potentiel d'action monophasique
2.3.4 Donner les noms des différentes phases de l'enregistrement (marquées 1 à 4).
1 : potentiel de repos
2: dépolarisation
3: repolarisation
4 hyperpolarisation
2.3.5 Citer pour chacune des phases les évènements modifiant la perméabilité
membranaire et expliquer leurs conséquences sur l'évolution du potentiel
transmembranaire.
2: dépolarisation: ouverture des canaux sodium = diffusion d'ions sodium chargé + dans le
cytoplasme; le potentiel diminue,s'annule puis devient positif
3 repolarisation: fermeture des canaux sodium et ouverture des canaux potassium= diffusion de K+
vers le milieu extracelllaire: le potentiel redevient négatif
4 hyperpolarisation :les canaux potassium reste ouvert plus longtemps que nécessaire pour retrouver
le potentiel de repos; le potentiel devient plus négatif; à la fermeture des canaux potassium, il
redevient progressivement à la valeur d'équilibre (potentiel de repos) en particulier par action de
l'ATPase Na K dépendante.

Hémostase secondaire
prothrombine thrombine
fibrinogène fibrine Fibrine stabilisée
Voie exogène
Voie endogène
1
/
4
100%