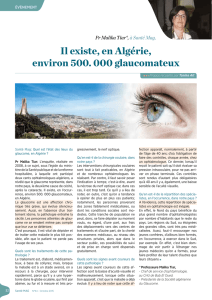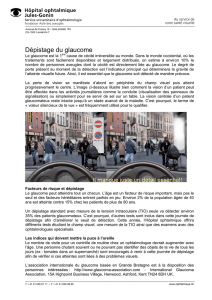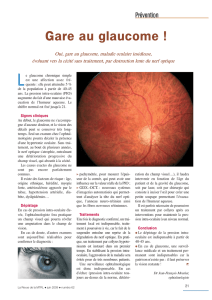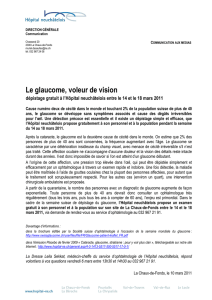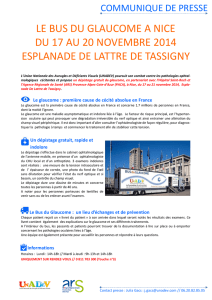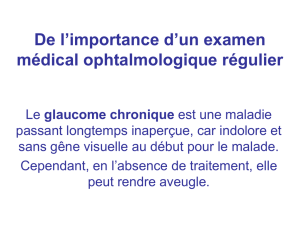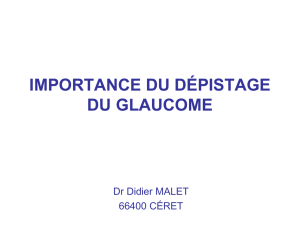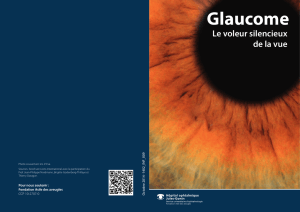φ Glaucome à la SFO - Pratiques en Ophtalmologie

SPÉCIAL CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’OPHTALMOLOGIE
DOSSIER
Pratiques en Ophtalmologie • Juin 2011 • vol. 5 • numéro 45 155
HYPERTONIES
Le bilan des facteurs de risque
est primordial. Si on divise les
hypertones en trois groupes se-
lon les facteurs de risque (un
tiers avec le risque le plus faible,
un tiers avec un risque moyen, et
un tiers avec le risque le plus éle-
vé), il faut traiter 98 patients du
premier groupe pendant 13 ans
pour éviter une seule conversion
glaucomateuse, alors qu’il suf-
fit d’en traiter 19 du deuxième
groupe. L’évaluation des fac-
teurs de risque a été précisée par
le poolage de deux études multi-
centriques (USA et Europe). Un
calculateur utilisant ces résul-
tats est disponible sur internet.
Il permet une estimation rapide
du risque glaucomateux chez les
patients hypertones.
1
Ophtalmologiste. Paris
FLUCTUATIONS DE
LA PRESSION INTRA-
OCULAIRE (PIO)
Les glaucomateux ont une mo-
dification du rythme nycthé-
méral de la PIO. Une mesure à
différentes heures de la journée
avant de commencer un traite-
ment permet de relever l’impor-
tance du pic et l’amplitude des
fluctuations.
L’importance des fluctuations
est retrouvée dans certaines
études comme un facteur de
risque indépendant.
EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES
Le champ visuel garde toute sa
place dans le suivi du glaucome.
L’apparition de logiciels de suivi
constitue un progrès majeur. Ces
logiciels, incapables d’indiquer
un aggravation du glaucome
avant 5 examens, soulignent
l’importance d’une fréquence
suffisante pour un suivi correct.
Les analyseurs d’événement si-
gnalent les points dont le déficit
dépasse la variabilité attendue
par rapport à deux examens de
référence. Les analyseurs de ten-
dance calculent pour chaque
point une courbe de régression
linéaire dont la pente indique
l’aggravation. Ce calcul peut
aussi être affecté à un groupe
de points correspondant à un
même faisceux de fibres vi-
suelles.
Enfin, un indice permet d’esti-
mer et de prévoir la réserve de
champ visuel du patient, indé-
pendamment de l’opacification
des milieux.
L’OCT des fibres visuelles prend
une place de plus en plus impor-
tante dans les examens de struc-
ture. Les paramètres de la papille
semblent moins utiles que ceux
des fibres visuelles. Dans la ré-
gion maculaire, la cartographie
d’épaisseur du complexe cellu-
laire ganglionnaire, ou de la ré-
tine entière, semble particuliè-
rement utile pour les diagnostics
précoces.
L’objet des examens complé-
mentaires de suivi devient une
quantification de l’aggravation
et non plus son simple dia-
gnostic. Ils permettent aussi,
par l’amélioration de la repro-
ductibilité (Gdx et HRT) le dia-
gnostic de glaucome, non pas
en affirmant le caractère patho-
logique d’une atteinte, mais en
démontrant une progression de
cette atteinte. D’où l’importance
d’établir une base de référence.
L’OCT du segment antérieur a
deux avantages : il permet un
examen dans l’obscurité, et ap-
précie l’épaisseur de la racine de
l’iris, donc la dynamique semble
jouer un rôle important dans la
pathogénie des fermetures de
l’angle. Il ne visualise pas les
structure situées derrière l’épi-
thélium pigmenté de l’iris, au
contraire de l’UBM.
L’UBM prend son intérêt quand
le mécanisme de la fermeture
n’est pas seulement au bloc pu-
pillaire, en particulier après IP,
en cas de suspicion de syndrome
iris-plateau.
L’examen de référence pour af-
firmer la fermeture de l’angle
La journée de la Société Française
de Glaucome et les autres réunions
réalisées sous son égide ont été
l’occasion de découvrir les nou-
velles voies diagnostiques et thé-
rapeutiques, et de préciser, grâce
à l’apport des dernières études pu-
bliées, les lignes de force de cette
affection.
Introduction
7 Glaucome à la SFO
Apport des dernières études
Dr Jacques Laloum1

SPÉCIAL CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’OPHTALMOLOGIE
DOSSIER
156Pratiques en Ophtalmologie • Juin 2011 • vol. 5 • numéro 45
reste cependant, malgré les pro-
grès des appareils, la goniosco-
pie dynamique.
Un travail (primé) sur l’Ocular
Responder Analysis confirme
que les cornées de patients glau-
comateux et non glaucomateux
présentent des caractéristiques
biomécaniques différentes, à
épaisseur de cornée compa-
rable.
TRAITEMENT
Le seul traitement éprouvé reste
la baisse pressionnelle. L’im-
portance du rôle de cette baisse
pressionnelle sur la progression
du glaucome a encore été souli-
gnée par une étude canadienne
récente : une baisse de 20 % de
la PIO divise par 3 la progression
du déficit périmétrique (évaluée
par le MD).
L’observance reste un problème
central dans cette affection
chronique : seulement 56 % des
patients prennent 75 % de leur
traitement. Elle doit être appré-
ciée par des questions ouvertes,
non culpabilisantes et ne met-
tant pas le patient en difficulté.
Elle est améliorée par les ex-
plications, et la fréquence des
consultations.
L’utilisation des génériques en
France est encore très inférieure
à ce qu’elle est en Allemagne.
Leur tolérance et même leur ef-
ficacité n’est pas toujours iden-
tique (galéniques différentes).
Un doute sur l’efficacité, ou une
mauvaise tolérance doit faire re-
passer au produit princeps. Les
différences de dénominations
sont une cause de confusion :
demander au patient d’apporter
les flacons est souvent utile.
La chirurgie du glaucome a été
abordée sous son aspect le plus
spécifique : l’importance cen-
trale du suivi postopératoire. Ce
suivi intensif recherche les com-
plications postopératoires im-
médiates.
Un Seïdel peut ainsi nécessiter
une reprise :
- en urgence si l’effacement de
la chambre antérieure au centre
est menaçant ;
- mais de toute façon très rapide-
ment s’il persiste, car il menace
en quelques jours la viabilité de
la filtration.
De façon générale, la plupart des
gestes postopératoires visent
à combattre la fibrose précoce
ou le risque de fibrose à moyen
terme.
GLAUCOME À PRESSION
NORMALE (GPN)
Dans trois études sur le GPN
(1981, 1992, et 2002) une ima-
gerie cérébrale pratiquée à titre
systématique a découvert une
lésion intra-crânienne dans une
proportion significative de cas.
L’inclusion de l’IRM au bilan
initial de tout GPN semble donc
logique.
L’association GPN-syndrome
d’apnée du sommeil (SAS) n’est
pas rare. La recherche d’un GPN
doit être systématique en cas de
SAS, car le traitement par pres-
sion positive augmente la PIO
nocturne et diminue le débit
sanguin oculaire.
Les Dips nocturnes a longtemps
été mis en avant comme facteur
aggravant, à corriger. Une limite
est que ces Dips s’avèrent utiles
sur le plan général et doivent
donc être respectés.
Le traitement médical du GPN
vise une PIO cible très basse,
mais une étude récente montre
dans des cas d’atteinte bilatérale
que les asymmétries périmé-
trique et pressionnelle ne pas
corrélées. Ce résultat conforte
l’idée que la pathogénie du GPN
n’est pas totalement pression-
dépendante.
Un autre volet de la même étude,
comparant l’aggravation du
champ visuel chez des patients
traités par timolol vs brimoni-
dine, montre un avantage net à
la brimonidine, peut-être lié à
un effet neuroprotecteur.
CONCLUSION
Les progrès technologiques n’en-
lèvent pas à la clinique son rôle
central dans le diagnostic et la
surveillance du glaucome.
Amélioration de l’observance,
attention à la qualité de vie du
patient, réévaluation régulière
du rapport bénéfice-risque du
traitement : la qualité de la rela-
tion avec le patient est aussi pri-
mordiale dans la prise en charge
de cette affection chronique. n
Mots-clés :
Glaucome, Facteurs de risque,
Thérapeutique, Examens
complémentaires, Chirurgie,
Glaucome à pression normale.
1
/
2
100%