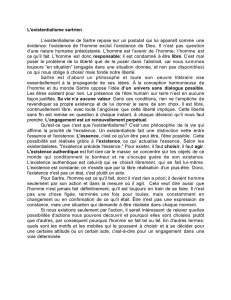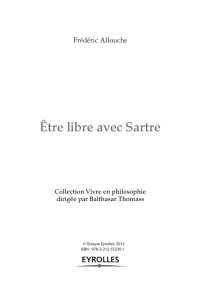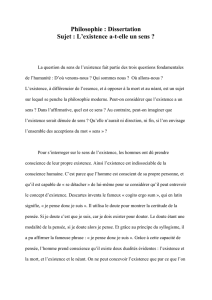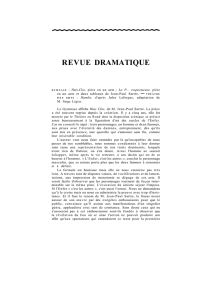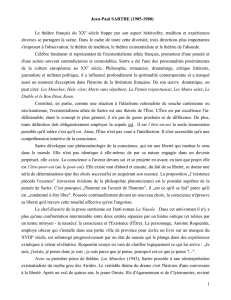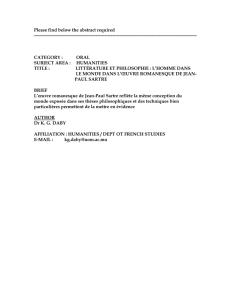SARTRE UN INTELLECTUEL EN LIBERTÉ

SARTRE
UN INTELLECTUEL EN LIBERTÉ
« Ce que j’aime en ma folie, c’est qu’elle m’a protégé, du premier jour, contre
les séductions de « l’élite » : jamais je ne me suis cru l’heureux propriétaire d’un
« talent » : ma seule affaire était de me sauver – rien dans les mains, rien dans les
poches – par le travail et la foi. Du coup ma pure option ne m’élevait au-dessus de
personne : sans équipement, sans outillage je me suis mis tout entier à l’oeuvre pour
me sauver tout entier. Si je range l’impossible Salut au magasin des accessoires, que
reste t–il ?
Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe
qui. » Les Mots.
Jean-Louis CHEVREAU – Conférences de l’ institut municipal
mars avril 2008

PREAMBULE
PREAMBULE
Sartre est sans aucun doute un philosophe, un penseur et un grand
écrivain, mais c’est aussi un intellectuel, au sens originel du mot, qui traversa
son siècle avec force et engagement. Il est de bon ton aujourd’hui de pointer
ses « erreurs » politiques, de mépriser ses œuvres littéraires, de dévaluer sa
pensée philosophique, bref de le déclasser en le rejetant dans les oubliettes de
l’histoire. Mais n’est-ce pas, parce qu’aujourd’hui, les intellectuels sont, non
seulement en voie de disparition, mais semblent fort éloignés de ces combats
pour l’homme, pour sa libération, que Sartre a menés tambour battant, avec
une plume acérée comme une épée ? N’est-il pas temps d’en revenir à ce qu’il
a écrit, de redécouvrir dans cette foisonnante création littéraire et
philosophique, ce qui, confronté à sa vie, restera pour nous, le témoignage
d’une œuvre exemplaire, et d’un homme totalement engagé contre tous les
totalitarismes ? Sartre est aujourd’hui encore, le maître que nous pouvons
suivre pour nous guider sur les chemins de la liberté.
Lectures conseillées :
« La Nausée », « Les mots », « Baudelaire », « Huis Clos », « Les
Mouches » « Les mains sales », « Les Séquestrés d’Altona », « Le diable et le
Bon Dieu », « Réflexions sur la question juive », « L’existentialisme est un
humanisme », « L ‘Etre et le Néant » (Troisième partie), les « Situations »,
« Questions de méthode », et de : Annie Cohen-Solal, une biographie de
Sartre : « Sartre 1905-1980 ». Pour se rendre compte de la créativité de la
pensée de Sartre, nous pouvons lire « L’espoir maintenant », des entretiens
que Sartre a avec Benny Lévy en 1980, un an avant sa mort. Il faut rendre
hommage aussi aux écrits de Simone de Beauvoir. Dans « La force des
choses », elle fait souvent références à sa vie partagée avec Sartre. L’on peut
lire ses entretiens avec Sartre, précédés de cet émouvant texte sur les

derniers jours de Sartre : « La cérémonie des adieux ». Son essai : « Pour
une morale de l’ambiguïté » forme aussi une bonne interprétation de la pensée
de Sartre. Parmi l’immensité des commentaires publiés sur Sartre, je retiendrai
le numéro de Septembre-Octobre 2005 des « Temps modernes » ; un numéro
spécial de la revue « L’histoire », titre : « Sartre portrait sans tabou ». Très
abordable et très éclairant, le « Sartre » de Francis Janson, qui fut un de ses
amis, dans la collection « Ecrivains de toujours » au Seuil. Je cite aussi le livre
de Bernard-Henri Lévy : « Le siècle de Sartre », assez ouvert dans ses
perspectives (soulignant l’aspect toujours créatif de sa pensée, voir même un
deuxième Sartre se profilant dans ses entretiens avec Benny Lévy), et
reconnaissant à l’oeuvre son positif héritage. Le prof de philo de la Fac de
Médecine d’Angers, Jean-Marc Mouillie, a publié au PUF un « Sartre,
conscience, ego et psychè », une courte et très éclairante analyse sur ce qu’il
faut entendre par une philosophie de la liberté. Dans une petite collection
« Pleins feux », deux tout petits textes très clairs, l’un d’Etienne Naveau
« L’enfer c’est les autres », et l’autre de Pierre-Yves Bourdil « L’homme est une
passion inutile » ; deux analyses sur des thèses de Sartre et pour en montrer
la pertinence actuelle. Peut-être aurons-nous le temps de projeter quelques
séquences du film réalisé par Alexandre Astruc et Michel Contat : « Sartre par
lui-même », édité en vidéo 2 DVD chez Editions Montparnasse.

PLAN :
L’engagement de l’intellectuel (parcours biographique 1ière partie).
Une philosophie de la liberté et de l’existence (les grandes œuvres : 2ième
et 3ième partie).
La critique constructive de la psychanalyse (comment puis-je penser et
changer mon destin personnel ?). Histoire et morale (Comment l’homme
est-il responsable de l’action des autres hommes ? 4ième partie).
L’amour de la littérature et des arts : la générosité du créateur. 5ième
partie.
Conclusion. Une vie réfléchie pour les autres : de l’usage contemporain de
Sartre mort. 6ième partie.

Avants propos :
Pourquoi ai-je décidé de vous parler de Sartre ? A une époque de ma
jeunesse, disons l’adolescence, au moment où l’on cherche a affûter son esprit
critique, à lancer des flèches, dans les cibles pesantes de lieux communs et de
valeurs bien pensantes, Sartre est arrivé à point nommé.
Trois évènements ont particulièrement éveillé mon esprit : la lecture de « la
Nausée », les positions anticolonialistes de Sartre et des « Temps Modernes »,
et enfin son théâtre.
A 15 ans, on est très sensible aux conceptions métaphysiques et
psychologiques hors normes, surtout, si comme moi, on n’est pas embarrassé
par le poids du religieux, si l’esprit voltairien a déjà préparé le terrain. « La
Nausée » éveillait en moi quelque chose qu’aucun autre livre n’avait su
m’apporter (j’avais encore peu lu), à l’exception de « L’étranger » de Camus.
Ce livre me dévoilait un ailleurs insoupçonné : L’esprit provincial et bourgeois
totalement retourné par un homme étrange, Roquentin, voyageur de passage,
sans billet, sans posture ni position sociale, pour tout dire un homme libre.
Je pense avoir été séduit par son œuvre, parce que Sartre a représenté
cet intellectuel nourrit d’une tradition philosophique classique, mais qui s’ouvre
à un autre langage, celui de la fiction ou de l’essai. C’est là une grande
tradition française que l’on rencontre chez Montaigne, Rousseau ou Voltaire.
Alain Renaut n’hésite pas à intituler un ouvrage sur Sartre : « Sartre, le
dernier philosophe ». Il fut de fait le dernier à avoir eu l’ambition de
comprendre l’homme (« j’ai la passion de comprendre les hommes »), et de le
saisir dans sa totalité, psychologique et historique.
L’anticolonialisme de Sartre m’a également séduit, puisque pour moi,
rien ne me semblait plus odieux que l’attitude colonialiste et raciste. Les
articles des « Temps modernes », revue dirigée par Sartre et Simone de
Beauvoir, la préface de Sartre pour « les damnés de la terre » de Franz Fanon,
et ses positions publiques contre la guerre et la torture en Algérie, sont venus
nourrir ma conscience politique. Pendant la guerre d’Algérie, les Temps
Modernes ont pris des positions critiques radicales contre cette guerre coloniale
(voir l’article des TM d’avril 56 dans « Situations 5 : « Le colonialisme est un
système », ainsi que : « Vous êtes formidables ») ; il y a eu le « manifeste
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
1
/
88
100%