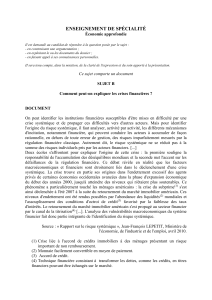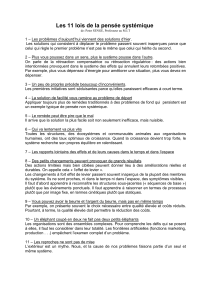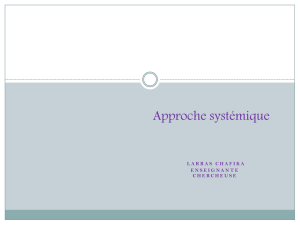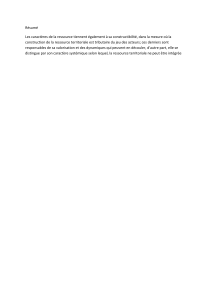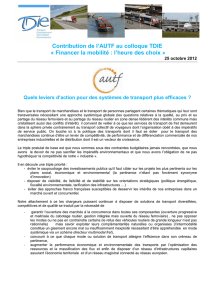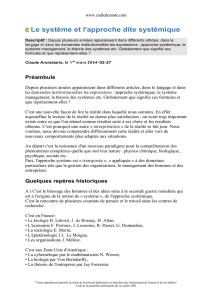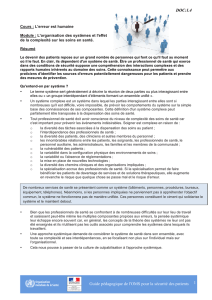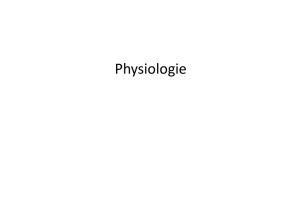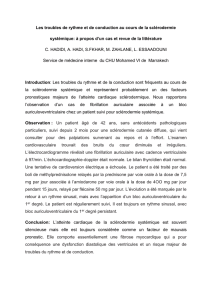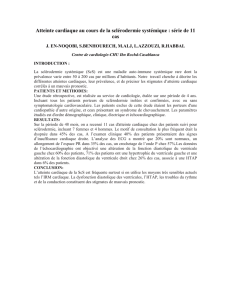Investissements et Développement : Approche Systémique

Investissements et Développement :
Approche Systémique
Dr. Aoumeur AKKI ALOUANI
Maître de conférences catégorie A
Université de Sétif I

evaluation des effets des programmes d’investissements publics … Aoumeur AKKI ALOUANI
2
Résumé :
Les programmes d’investissement publics ont formé en Algérie l’ossature de la
politique du développement du pays depuis son accession à l’indépendance en 1962.
Malgré de gros sacrifices dans l’industrialisation, souvent au dépend des autres secteurs,
l’Algérie, à l’instar de beaucoup d’autres pays du tiers monde, n’arrive pas à sortir du
cercle vicieux du sous-développement.
L’échec de la politique de développement est, à notre avis, due à l'importation de
modèles développés pour des pays historiquement différents et à des politiques
sectorielles de développement dans un contexte national et international qui se
caractérise par une extrême complexité.
L’objet de cette communication est d’attirer l’attention des décideurs sur l’apport de
l’approche systémique pour mettre en œuvre une vision et une stratégie de
développement cohérente qui tient compte des relations d’interdépendance et des
interactions existants entre les différents sous-ensembles de l’entité nationale et avec
son environnement.
Les politiques de développement poursuivies sont rappelées rapidement dans une
première partie soulignant la cause de leur échec. Dans la deuxième partie, l’approche
systémique comme technique de modélisation est expliquée. Enfin, il est fait appel à
l’expérience algérienne pour montrer, à travers les écrits, les limites de l’approche
cartésienne et réductionniste pour gérer des entités de plus en plus complexes.
: صخلا

evaluation des effets des programmes d’investissements publics … Aoumeur AKKI ALOUANI
3
I – Introduction :
«Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas
capables de résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes
actuels de pensée.»
1
C’est avec cette phrase d’Albert Einstein que je
propose de commencer cette communication. En effet, l’efficacité de
toute action ne dépend pas uniquement des moyens matériels et humains
nécessaires pour sa mise en œuvre, mais aussi et surtout de l’approche
dans sa préparation, son exécution et son évaluation.
Cette communication propose une perspective différente de celle
longtemps retenue par les recherches sur les investissements publics.
Plutôt que d’étudier les obstacles selon une approche partielle et
sectorielle, je propose l’analyse de l’approche suivie dans la
planification, exécution et évaluation des politiques de développement, et
sa responsabilité dans le niveau plutôt décevant de la performance de
l’intervention publique et de l’économie en général.
L’investissement public est un domaine très complexe. Il implique la
considération de différentes disciplines (économie, sociologie, politiques,
culture, histoire…) et plusieurs niveaux d’analyse (nation, région,
secteur…) sans perdre de vue leurs interrelations et la présence de
variables externes dépendant de l’environnement, de plus en plus vaste,
dans lequel il se produit. Son succès dépend de l’efficacité de
l’instrument utilisé pour l’approcher. C’est justement l’approche
systémique qui permet de capter et de prendre en compte l’ensemble des
variables de succès d’une telle démarche. La systémique considère tout
objet comme faisant partie d’un tout. Sa compréhension est reliée à la
compréhension de l’ensemble dans son environnement.
Un grand nombre de recherches sur les investissements publics ont
concentré leur attention sur les obstacles selon une approche partielle,
chacun selon ses objectifs et son domaine de formation. Or, agir
uniquement sur une variable, que ce soit dans la phase de planification,
de l’exécution ou de l’évaluation, ne fait qu’exaspérer les déséquilibres,
et cacher les vrais enjeux. En effet, « la crise à travers laquelle s'exprime
le sous-développement n'est pas exclusivement économique, elle est
globale, c'est-à-dire que c'est une crise qui affecte les fondements de la
société ; la crise y est idéologique, culturelle, économique et, par
conséquent, politique.» (Addi) Seule une approche qui tienne compte de
l’ensemble des facteurs d’influence et de leurs interactions et
interdépendances est à même de produire les résultats recherchés. De
plus, les entités sont de plus en plus complexes, ces différentes
dimensions sont en interactions continues et denses. Tout investissement

evaluation des effets des programmes d’investissements publics … Aoumeur AKKI ALOUANI
4
dans l’une d’elle, sans qu’il soit tenu compte de ses effets sur le reste,
non seulement il est contre performant, mais, il approfondi les
déséquilibres, donc le sous-développement, de l’entité dans son
ensemble. Seule une approche cohérente, qui prend en compte
l’ensemble des variables d’influence, est à même d'améliorer la
formulation des politiques, leur suivi et leur évaluation.
Dans une première partie est exposée l’économie du développement et
les outils proposés pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Dans une
seconde partie, l’approche systémique est proposée comme solution aux
problèmes du sous développement que l’approche analytique et
cartésienne n’arrive pas à elle seule à régler, en soulignant la place des
systèmes d’information, dans la société de la connaissance pour le succès
de l’approche systémique. Enfin, il est fait appel à l’expérience
algérienne pour montrer les limites de l’approche cartésienne et
réductionniste pour gérer des entités de plus en plus complexes.
II – théories du développement : cause d’un échec :
L’objectif de cette partie n’est pas de comparer ni de disserter sur les
différentes théories économiques, mais de rappeler les principales
théories qui ont influencé les politiques de développement depuis la
grande crise de 1929 ; pour montrer par la suite qu’elles partaient toutes
d’une vision partielle et en réaction à des phénomènes qui ont marqué
cette période, comme l’incapacité des marchés à réguler les économies
ou l’idée que le rôle principal des gouvernements est celui de réguler les
cycles économiques … En faisant, par la suite, appel à la théorie
systémique et au rôle des systèmes d’information, mon objectif est de
démontrer que ces théories, influencées par la théorie cartésienne et
réductionniste, sont en partie responsables de la persistance du sous
développement de beaucoup de pays, dont l’Algérie.
1 – Développement et développement économique : recherche d’une
définition
Pour François Perroux (1961), le développement est «la combinaison des
changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à
faire croître cumulativement et durablement son produit réel et global ».
2
Pour le dictionnaire français Larousse, c’est une amélioration qualitative
et durable d'une économie et de son fonctionnement. Alors que la
croissance est un phénomène quantitatif d’accumulation de richesses,
qui ne doit pas être confondue avec le développement, phénomène
qualitatif à la recherche d’un "mieux-être". « Il doit dans tous les cas,
reposer sur des méthodes (dimension méthodologique) permettant aux
individus et collectivités de définir eux-mêmes leurs priorités, et d’agir

evaluation des effets des programmes d’investissements publics … Aoumeur AKKI ALOUANI
5
en fonction de celles-ci tout en pesant/en s’adaptant aux changements de
l’environnement».
3
Pour le programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), le développement c’est le fait d’«élargir
l’éventail des possibilités offertes aux hommes ».
4
Une croissance
économique durable est le résultat d’un développement économique. Ce
dernier est associé au progrès ; mais, il n'est qu'une des composantes du
développement. La croissance peut contribuer au développement, mais
tel n’est pas toujours le cas et on parle de croissance sans développement
quand la production de richesse ne s’accompagne pas de l’amélioration
des conditions de vie.
Avec les nouveaux paradigmes liés au développement durable, même le
concept traditionnel du développement est remis en cause pour faire
ressortir une multi dimensionnalité plus large du développement. Une
vision globale et systémique du développement est défendue par
l’abondante littérature produite dans le contexte du développement
durable.
L’économie du développement a ses origines aux alentours de la
deuxième guerre mondiale. Son objectif est de définir les moyens qui
permettront aux économies des pays pauvres de produire de la richesse
pour assurer leur développement. Or, le non développement n’est pas lié
uniquement à l’absence de ressources matérielles. Pour l’économiste R.
Barre (p.114), « dans les pays sous-développés, les problèmes de
développement ne sont pas seulement économiques ; ils sont encore et
surtout humains». Ces pays sont sous-développés économiquement et
socialement. Se sont à la fois des économies et des sociétés sous-
développées (Barre, p.114). Elles «… n’imprime pas à l’ensemble du
pays les impulsions créatrices de développement» (Barre, p.112).
La complexité du monde moderne n’a pas permis aux politiques
sectorielles de réussir le développement des pays du tiers monde. Les
idées introduites dans la première moitié du XXème siècle par les
initiateurs de l’économie du développement n’ont pas donné, pour ces
pays, les résultats attendus. Leur mise en œuvre n’a pas permis aux pays
sous-développés de sortir du piège de la pauvreté (Poverty Trap). « Le
piège de la pauvreté est une condition auto-entretenue où l'économie,
prise dans un cercle vicieux, souffre d’un sous-développement persistant
(Kiminori Matsuyama)
5
». Les fondateurs de l’économie du
développement, comme Rosenstein-Rodan (1943) et Hirschman (1958),
considéraient le ‘développement’ comme l’équivalent de la croissance de
la production par l’industrialisation (Bass), négligeant ainsi les autres
facteurs du développement. Parlant de l’Europe de l’Est et du Sud-est,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%