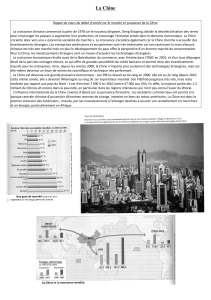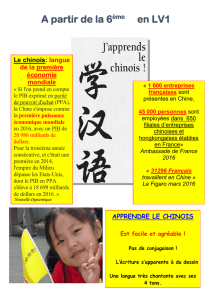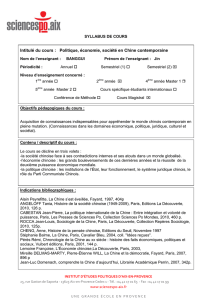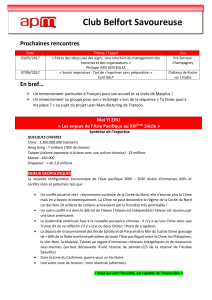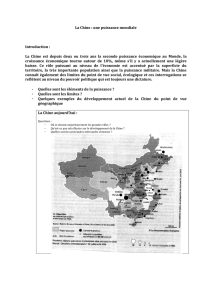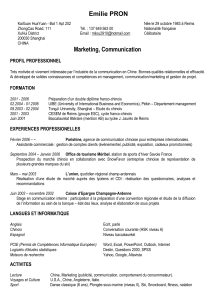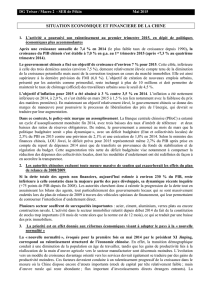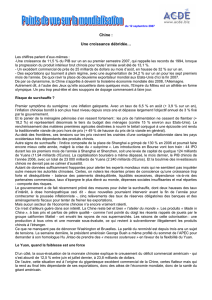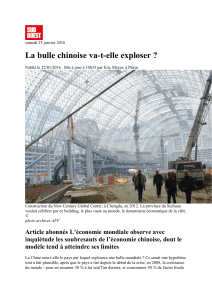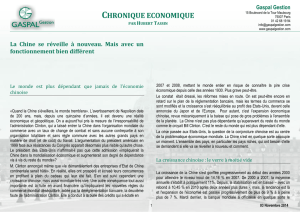Jusqu`où ira la Chine

Jusqu’où ira la Chine ?
Jacques Gravereau
En 2018 le PIB chinois rattrapera celui des Etats-Unis. Il sera passé de 9 trillions de dollars fin
2013 à 20 trillions en 2018*. Cette heure de gloire ne manquera pas d’être célébrée comme il se doit. La
richesse par Chinois restera toutefois cinq fois moindre que celle du grand rival. Douze ans plus tard, le
PIB chinois sera de 64 trillions de dollars et celui des Etats-Unis de 32 et l’Américain moyen ne sera plus
que deux fois plus riche qu’un Chinois. A la même époque, vers 2030, la population chinoise aura atteint
1.450 millions de citoyens et commencera à décroître lentement. Elle sera à ce moment rattrapée par
celle de l’Inde. La Chine sera la première puissance mondiale. C’est du moins ce que la projection
mécanique des courbes laisse accroire.
En réalité la Chine a dépassé les Etats-Unis depuis longtemps, si l’on descend un peu dans les
étages : il y a déjà quatorze ans pour la production d’acier, onze pour la possession de téléphones
portables, six pour les exportations, trois pour la production industrielle globale, trois pour le marché
automobile domestique. En 2012, la Chine a consommé 4.700 milliards de Kilowatts-heure d’électricité
et les Etats-Unis 3.700 ; elle a aussi émis dans l’atmosphère 35% de plus de CO² ! Il faudra attendre
encore quelques années pour que la Chine puisse émuler les Etats-Unis dans tous les registres : sans
doute 8 ans pour la capitalisation boursière (Hong Kong exclue), dix ans pour les dépenses de
consommation… et douze pour les dépenses militaires. Même dans le domaine stratégique, l’Amérique
n’aura plus la main, alors que son budget de défense est aujourd’hui supérieur à la somme des dix
budgets nationaux suivants.
La montée en puissance de la Chine est-elle inexorable ? La marche de la Chine peut-elle être
triomphale sans crises majeures ? Quels défis devra-t-elle relever, et nous avec ? Voici quelques
questions pour l’avenir, sans langue de bois.
1. Le « toujours plus » est-il une option durable ?
Avec plus de vingt ans de croissance annuelle supérieure à 10%**, l’économie chinoise a
doublé de taille tous les six ans et demi. Le PIB par habitant est passé de 400 dollars il y a vingt ans à
6.500 aujourd’hui. On ne peut qu’admirer la pulsion vitale exceptionnelle de ce très vieux pays devenu
un pays neuf. Cette incontestable réussite s’est fondée sur une stratégie assez simple et un contrat
social clair. En matière économique : l’exploitation d’une main d’œuvre illimitée et bon marché pour
construire « l’usine du monde », dans un contexte d’ouverture générale des échanges mondiaux,
permettant d’acquérir rapidement devises fortes et technologies , et appuyée par des
*Les chiffres sont donnés en dollars courants incluant l’inflation et les taux de change. Les projections de la
plupart des grandes institutions internationales (FMI, OCDE, Banque Mondiale…) se recoupent. Elles prennent pour
hypothèse des croissances moyennes annuelles de +7,5% pour la Chine et de +2,5% pour les Etats-Unis, et une
appréciation du Yuan de +3% par an… sans préjuger d’aucun accident.
**Cette croissance est beaucoup plus contrastée que le chiffre moyen ne le laisse à penser, zigzaguant entre
+7,5% en 1999 et +13,8% en 2007 par exemple. Elle s’est également accompagnée à certaines époques d’inflation
préoccupante.
TOPIC N°235
Eté 2013
www.hec.fr/eurasia

investissements étatiques en infrastructures ahurissants. Sur le plan social et politique : un pacte non-
écrit de « croissance contre obéissance », dans une remarquable opacité verrouillée par le Parti-unique-
qui-sait-tout. La religion de la croissance à tout prix a produit le « syndrome de la bicyclette » : tant que
l’on pédale vite, la bicyclette avance, les problèmes sont brassés par la vitesse, les projets publics ou
privés foisonnent, l’optimisme règne, entraîné par le tourbillon du « toujours plus » qui sert de
programme à tous les échelons du pays, sans que l’on se pose trop de questions sur les voies et moyens.
La quantité seule compte. Pour la qualité, on verra plus tard. Gros avantage : tant que l’opium du peuple
est l’argent, on ne parle pas de politique, sinon pour vénérer le leadership éclairé des sages dirigeants :
tels les empereurs d’hier, ces derniers peuvent faire accroire qu’ils détiennent le « mandat du ciel » cher
à la tradition chinoise, puisqu’ils sont capables de fabriquer de la prospérité et de l’espoir en des
lendemains qui chantent. Sans vérification par la voie des urnes, il va sans dire.
On sait aujourd’hui que cette course en avant inouïe – dont la réussite globale, une fois encore,
est brillante et incontestable – est terminée. On s’achemine vers des taux de croissance durablement
amputés, pour l’instant, d’au moins trois points pour les années qui viennent. La bicyclette commence à
tanguer. On peut se poser la fameuse question de la « convergence » avec les taux des pays matures. Et
rien ne dit – mais c’est encore un tabou - que ces taux ne vont pas s’éroder encore plus, ou subir des
chocs spéculatifs d’amplitude similaire au grand voisin japonais, ou des accidents de parcours à la
brésilienne. Cela nous concerne directement : une baisse de deux points de croissance des BRICS
(comme en 2013 par exemple) rabote la croissance des pays occidentaux de 0,5 point. Attention:
l’histoire économique démontre constamment que le seuil des 6.000 dollars de PIB par habitant est un
tournant capital, où des questions qualitatives graves commencent à se poser. C’est le seuil que vient
d’atteindre la Chine, multiplié – doit-on le marteler ? – par la masse inouïe d’1,4 milliards d’habitants.
Les projections mécaniques des grandes institutions doivent donc être prises avec des pincettes.
2. Le développement se mange-t-il lui-même ?
Les dommages collatéraux de la croissance folle s’étalent sous nos yeux. Les atteintes à
l’environnement ont atteint des sommets. La pollution de l’air et de l’eau affecte vertigineusement la
santé publique. Le Nord-est du pays est en situation de sécheresse critique permanente. Les accidents
industriels et miniers sont récurrents. Les embouteillages sont devenus dirimants dans toutes les villes
chinoises (180 villes de plus d’un million d’habitants !). Les problèmes de sécurité alimentaire défrayent
la chronique, avec d’autant plus de charge émotionnelle lorsqu’il s’agit de lait infantile contaminé. Les
scandales majeurs sont quotidiens. On en parle et c’est très nouveau : la littérature en la matière
devient foisonnante. Le quotidien en Chine a toujours été âpre, il est en train de devenir invivable. On
en débat, on tente d’y apporter des correctifs. On punit durement et publiquement les responsables. Le
crime de pollution peut entraîner désormais la peine de mort. Mais ce gâchis est-il rattrapable ?
Sur un autre point, plus technique, on réalise que le développement s’est fait à crédit, avec une
puissante drogue : l’addiction à l’investissement. Bon an mal an, l’investissement fixe bat des records du
monde : 70% du PIB ! S’il s’agit de construire des infrastructures (7.000 Kilomètres d’autoroutes
nouvelles l’an dernier !), pourquoi pas ? Dans ce registre, la Chine dame largement le pion à l’Inde par
exemple. Mais la fièvre du béton emporte tout. La construction de bâtiments nouveaux représente 10%
du PIB. Comme les autorités locales continuent à être jugées sur la quantité, elles doivent produire des
statistiques mirobolantes, sans calcul économique sérieux, et peu leur chaut les surcapacités. Le
rendement des investissements s’effondre : Il fallait 2 Yuans investis pour produire un Yuan de richesse
supplémentaire il y a quinze ans. Il en faut 7 aujourd’hui. Pas moins de 8.000 projets pharaoniques sont
programmés. Les banques locales (d’Etat bien entendu) sont priées d’abonder le tiroir-caisse, sans
souci de rentabilité. L’endettement local est devenu une bombe à retardement qui avoisine sans doute
50% du PIB. Et encore, on ne compte pas le shadow banking privé opaque, dont la masse de manœuvre
est sans doute le double de tous les dépôts bancaires officiels. C’est, bien au-delà d’un problème
financier, un défi structurel majeur. La mue de cette économie du gaspillage n’a pas encore
sérieusement commencé.

3. La consommation va-t-elle sauver l’économie ?
L’économie chinoise, jusqu’alors tributaire des exportations et des investissements massifs, entre
aujourd’hui dans des révisions déchirantes. Les clients occidentaux sont atones depuis la grande crise de
2008, sans même parler d’un protectionnisme mondial croissant. Les industries exportatrices de toute la
façade maritime chinoise souffrent durablement, d’autant plus que les salaires ont augmenté de l’ordre
de +20% par an à peu près au même moment. Il faudrait s’élever rapidement en gamme et en valeur
ajoutée, mais on n’y parvient pas au même rythme. Exit donc l’exportation comme moteur principal
de l’économie chinoise.
Le relai est-il pris par la consommation domestique ? On peut en douter – malgré des
croissances flatteuses de l’ordre de +12% par an – lorsqu’on sait que la consommation ne représente
que 40% du PIB chinois, 30 points de moins que dans tous les pays tant soit peu avancés. Il est vrai que
sur les segments de haut de gamme (téléphonie, voitures, articles de luxe, immobilier), les chiffres font
rêver. Mais c’est l’arbre qui cache la forêt. Pourquoi ? Parce que l’épargne reste paradoxalement
extraordinairement élevée ! Tant que cette épargne ne migrera pas vers la consommation de masse, on
continuera à parler dans le vide. Si des filets de sécurité sociale dignes de ce nom n’arrivent pas à
conjurer les grandes craintes des citoyens sur leur santé, sur leurs retraites, sur l’éducation de leurs
enfants, on a toutes chances de voir perdurer la faiblesse de l’embrayage entre la masse considérable
d’argent liquide disponible et son utilisation dans les circuits économiques. Les réformes sont bien en
cours, et la structure favorable du taux de dépendance démographique ouvre encore une fenêtre de
tir jusqu’en 2015, mais le chantier est trop énorme pour évoluer rapidement.
4. Une nouvelle société qui échappe à ses dirigeants ?
La société chinoise a muté en profondeur, avec une brutalité inouïe. La vieille Chine paysanne
est devenue largement urbaine. Echappant à la lancinante précarité ancienne, des classes moyennes se
sont constituées à grande vitesse, avec 400 millions de consommateurs de masse aujourd’hui.
Certains, plus entreprenants et mieux protégés, ont été beaucoup plus vite que d’autres. La fracture
sociale, autrefois contenue, est devenue béante : le fameux coefficient de Gini – qui mesure l’inégalité
de la répartition des fruits de la croissance – est passée de 0,25 à sans doute 0,55 aujourd’hui*, ce qui
est un score sud-américain peu enviable. On respecte la réussite financière : tout le monde la recherche
frénétiquement et on ne parle que de cela. Mais les riches arrogants sont aussi périodiquement haïs.
On entre aujourd’hui dans une époque toute différente, avec une société plus éduquée, plus
consciente du mouvement du monde, beaucoup mieux informée par les moyens modernes de
communication. Une innovation dévastatrice vient d’émerger. Dans le « bon vieux temps », il y a
seulement vingt ans, il n’y avait même pas de téléphones, seulement des journaux insipides verrouillés
par le Parti. Aujourd’hui on compte 1 milliard de téléphones portables, 500 millions d’internautes, 300
millions d’utilisateurs de Weibo, le twitter chinois ! Tout le monde communique à tout moment, et pas
seulement sur des sujets anodins, malgré les pare-feu formidablement puissants de l’appareil de
contrôle de l’internet. Les jeunes, en particulier, n’ont cure de se conformer aux sujets convenus. Objets
non identifiés pour les apparatchiks politiques, Ils veulent communiquer sur tout, de la fracture sociale à
la corruption, de la pollution aux passe-droits, des exactions sur les terres paysannes aux accidents de
train, des brutalités policières à la superbe des nouveaux-riches et des puissants. La société chinoise
demande plus de transparence et de considération. Elle est bouillonnante et peut être surprenante.
Signe du malaise des autorités : les mots «printemps arabe » ou « jasmin » viennent d’être effacés du
web chinois. Pour « Tibet », « droits de l’homme » et bien d’autres, c’était fait depuis longtemps.
*L’Etat chinois a cessé dès 2000 de fournir ses données du coefficient de Gini à la banque Mondiale

5. Peut-on s’exonérer de vraies réformes politiques ?
On a beaucoup parlé de réformes politiques. Un brûlot de haute tenue rédigé par Deng Yuwen – qui
n’est rien moins que le patron du très officiel journal de l’école des cadres du Parti Communiste – a
analysé les blocages du système politique intérieur et ce qu’il faudrait faire. Même le premier ministre
Wen Jiabao a renchéri. Mais c’était avant le dix-huitième congrès du Parti de novembre 2012. Depuis
lors, le soufflé est largement retombé, le silence est revenu, la répression de toute menace intellectuelle
ou politique est plus virulente que jamais. Et pourtant…
Les 82 millions de membres du Parti se voient investir du pouvoir de diriger le peuple. L’univers
mental des caciques au sommet est façonné par une vision du pouvoir léniniste, confirmée par Mao
Zedong et Deng Xiaoping, où il est hors de question de partager le monopole du parti et de tolérer
l’effilochage du pouvoir absolu du Bureau Politique par des pratiques « démocratiques », dont on
rappelle qu’elles ne sont pas conformes aux « caractéristiques chinoises ». Le timide essai des élections
locales depuis quelques années n’a rien donné. La caste tient sa légitimité d’une lente ascension dans
l’appareil, via les factions diverses du Parti. Elle est aujourd’hui plus diplômée, mieux rôdée à des
compétences concrètes, souvent de standard international au niveau des nouveaux très hauts
fonctionnaires. Mais elle n’est pas partageuse. Pis, elle est gangrénée par deux maux dirimants.
D’abord une bureaucratie tentaculaire – les Chinois en sont les inventeurs ! – qui paralyse la mise en
place de beaucoup de mesures, lesquelles sont toujours pesées au trébuchet des intérêts divers et
contradictoires des potentats locaux. Nous avions publié une étude sur cette « cacophonie chinoise »
dans la prise de décision à l’intérieur de l’appareil politico-bureaucratique. Elle reste hélas actuelle. Et
puis surtout une corruption ravageuse, à tous les étages, fruit du monopole du Parti sans contre-
pouvoirs. On fait certes des exemples périodiques (Bo Xilaï à Chongqing en 2012) selon le vieux
proverbe local « tuer le poulet pour effrayer le singe ». Et on recommence. La population la subit
comme elle subit la brutalité policière, les expulsions immobilières ou les projets industriels démesurés
et polluants. Mais elle subit de moins en moins passivement. Cette situation peut-elle perdurer ?
Le risque de convulsions violentes n’est jamais à exclure. On en admet quelques dizaines de milliers
chaque année, le plus souvent contre des exactions locales sur des terres agricoles. Mais elles sont
confinées géographiquement, et n’ont pas (pas encore ?) cristallisé en révolte nationale. Pour combien
de temps ? Ce ne seront pas les damnés de la terre, mais les désenchantés plus éduqués et bien
informés, auxquels se joindront les marginalisés des injustices diverses qui iront dans la rue, à la
manière brésilienne ou égyptienne. La réforme politique - si les dirigeants les plus lucides
l’entreprennent - doit commencer par la mise en place formelle, transparente, vérifiable, de soupapes
de sécurité telles qu’une justice véritablement indépendante (on y travaille timidement), de canaux
reconnus par le public de checks and balances, de contre-pouvoirs clairs et tolérés par le pouvoir. Mais
voilà : il leur faudrait rogner sur une partie de leur pouvoir absolu… et peut-être à terme perdre leur job.
Cela renvoie à un problème culturel de fond : celui d’un Etat de droit. La tradition chinoise a
toujours été mal à l’aise avec ce concept, comme avec la notion de « transparence ». Des règles du jeu
respectées par l’une et l’autre partie, la plus faible comme surtout la plus forte (les dirigeants politiques,
les riches…) ? Il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Le champ économique, pour prendre un seul
exemple, abonde d’exemples de ces « règles du jeu » distordues en permanence. La Chine a signé toutes
les conventions internationales sur le copyright et la contrefaçon. Et alors ? C’est un sport national où
les recours sont minces et toujours décevants. La Chine est triomphalement entrée dans l’Organisation
Mondiale du Commerce en 2001, mais continue dans la pratique à prendre ses aises avec nombre des
règles qu’elle a elle-même signées par traité. Les étrangers s’en accommodent lorsqu’ils investissent en
Chine. Mais la Chine est désormais sortie de ses frontières et découvre de nouveaux horizons mentaux.
Elle compte sur sa masse humaine, financière, stratégique, pour pousser ses intérêts tous azimuts, selon
ses pratiques à elle. Mais cela ne fonctionne pas. Ce seul argument du poids peut-il tenir lieu de
politique internationale ? C’est un nouveau défi, pour nous cette fois.

6. Le seul poids de la Chine en fera-t-il une grande puissance mondiale ?
Cela commence aux abords immédiats du continent chinois. Depuis trois ans, après un long
statu-quo, la Chine affirme de plus en plus haut et fort ses prétentions sur l’espace maritime « chinois »
d’après elle. Face au Japon, au Vietnam, aux Philippines, à l’ASEAN en général, le discours sur les
revendications s’est durci considérablement et les gesticulations (pour l’instant) aussi, à la mesure de la
montée en puissance de sa marine (premier porte-avion mis en service il y a quelques mois). Au-delà, la
constitution d’un « collier de perles » de bases stratégiques dans l’océan indien vise à protéger la veine
jugulaire du pétrole du Moyen-Orient.
La voracité chinoise en matières premières et en ressources énergétiques la conduit à des prises
de positions tous azimuts en Afrique, en Amérique latine, en Eurasie, au Moyen-Orient. Tous les moyens
sont bons, de la prédation « pas vue, pas prise » sur les bois ou les poissons (voir notre Topic d’avril) aux
investissements somptuaires dans les mines ou les concessions gazières et pétrolières. Jusque là, rien
que de très conforme à la stratégie d’autres grandes puissances. Un acteur de plus dans le concert des
grandes économies, en somme, mais avec une rapidité stupéfiante et dans une planète aux ressources
finies. Pour les autres investissements, en Europe ou en Amérique du Nord, on entre un peu plus dans le
dur, mais l’atonie économique des vieux pays suggère que la poussée chinoise va s’étendre
inexorablement dans les années qui viennent. On déroulera le tapis rouge aux Chinois comme on l’a fait
il y a vingt ans aux Japonais et autres Coréens. Les entreprises chinoises apprendront vite à devenir des
citoyennes du monde. A nous d’y veiller, sans pessimisme excessif.
Depuis la grande crise occidentale de 2008, la Chine s’est découvert une nouvelle arrogance
verbale, à la mesure du déclin relatif (temporaire ?) de l’Occident. Mais son discours politique
international s’est souvent avéré contre-productif. Il deviendra sans doute plus subtil. Dans le même
temps, la Chine construit des capacités militaires, spatiales, de renseignement, soigneusement planifiées
sur le long terme, avec toute la puissance de son argent, de sa discipline, de ses talents et de ses secrets
bien gardés. Le vif débat sur son cyber-espionnage systématique en Amérique préfigure la montée
possible – mais pas certaine - d’une nouvelle guerre froide à moyen terme. Le slogan chinois de
« montée en puissance pacifique » n’a d’égal que le slogan cynique de la « coexistence pacifique » au
pire moment du pillage soviétique des technologies de l’Occident de l’ère Brejnev. La mise au pilori de
la Chine en matière de cyber-espionnage vient d’être provisoirement sauvée par le gong de la
dénonciation virulente des pratiques mondiales de la NSA américaine, qui amusent actuellement la
galerie. Les Européens poussent des cris d’orfraie vertueux, mais le secret de polichinelle était évident
depuis vingt ans…
Plus sérieusement, la stratégie chinoise de grande puissance, dans tous ses aspects, se
développe sous nos yeux, de façon parfaitement planifiée. Mais le seul poids du rouleau compresseur
économique chinois est insuffisant pour se doter des autres attributs d’une hyper-puissance. La montée
en gamme scientifique et technologique autochtone est encore globalement incertaine et il ne faut pas
se laisser abuser par les statistiques triomphales des dépôts chinois de brevets, lesquels sont encore
pour la plupart des brevets d’application technique et non des percées conceptuelles majeures.
88% des innovations techniques et de services liés à l’internet – cette troisième révolution
industrielle - sont actuellement l’apanage des Etats-Unis, comme l’est l’excellence des universités
américaines. Car le terreau pour épanouir la recherche et l’innovation est au moins aussi important que
le talent des individus. La connaissance se nourrit de transparence et de partage. L’image de la Chine est
encore sino-centrée, comme un trou noir, protégée par la formidable barrière d’une langue très
complexe, d’un système encore illisible et peu attrayant pour des non-Chinois. Qui rêve d’émigrer en
Chine ? Quel est le « soft-power » réel de la Chine, par delà la multiplication des Instituts Confucius à
l’étranger ? La Chine sera-t-elle la grande puissance du XXI° siècle ? Pas sûr.
JG
1
/
5
100%