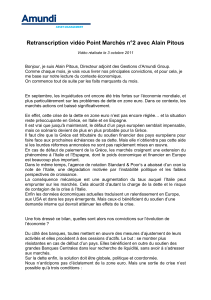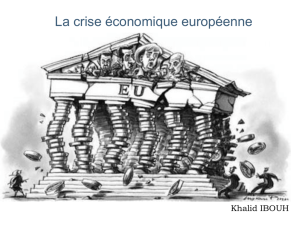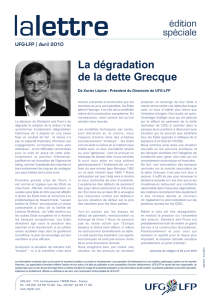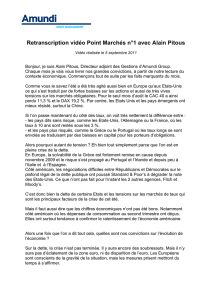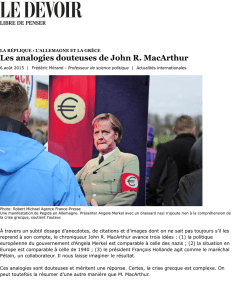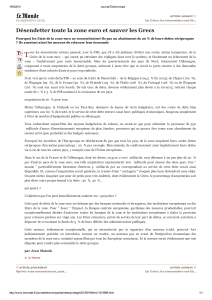La crise de la zone euro n`est pas seulement due à un

INTRODUCTION :
(Hugo)
La crise économique de 2008, quelques fois appelée dans le monde anglophone Grande
Récession (Great Récession, en référence à la Grande Dépression de 1929) , est
une récession dans laquelle sont entrés la plupart des pays industrialisés du monde suite
au krach de l'automne 2008, seconde phase de la crise financière mondiale débutant en
2007. Les États-Unis ont été les premiers à entrer en récession, en décembre 2007, suivis par
plusieurs pays européens au cours de l'année 2008, ainsi que la zone euro dans son
ensemble. La France n’entre en récession qu'en 2009, du moins, sur le plan comptable. Cette
crise économique mondiale est considérée comme la pire depuis la Grande Dépression.
Cette crise est marquée par une forte hausse des prix du pétrole et des produits agricoles. La
montée exorbitante des prix des actifs et celle associée de la demande sont considérées
comme la conséquence d'une période de crédit facile, de régulations et de supervisions
inadéquates ou d'inégalités croissantes. Avec la baisse des actions et des prix des maisons,
de grandes banques américaines et européennes ont perdu beaucoup d'argent. En dépit des
aides massives accordées par les États pour pallier les menaces de faillite et de crise bancaire
systémique, il en a résulté une récession mondiale qui a conduit à un ralentissement du
commerce international, à une hausse du chômage et à une baisse des prix des produits de
base.
En 2009, les pays ont en général opté pour des politiques de relance.
Début 2010, si la plupart semblent sortir de la récession, le FMI reste prudent. Le chômage
persiste, d'importants déséquilibres dans les balances des transactions courantes
demeurent, et des risques d'éclatement de nouvelles bulles financières sont à craindre. La
finance, reprenant le dessus notamment en zone euro, grâce à l'interdiction du financement
des États auprès des Banques Centrale qui implique donc leur financement auprès des
marchés de crédit (obligations), après avoir transmis aux États des dettes publiques
importantes 'via' les opérations de sauvetage des banques, impose aux États des politiques
d'austérité pro-cyclique (accentuant les problèmes économiques) soutenues par
l'Allemagne.
Certaines théories retiennent également que l’origine primordiale de cette crise n’est pas un
cumul de déficits élevés de certains États (origine non financière), mais le mode actuel de
financement des États européens (origine financière tenant à sa dénationalisation dans un
contexte d’une Union Européenne en construction). Toutefois, en matière de « maladie
sociale », un bon diagnostic ne détermine pas une seule thérapie. Ainsi, il y a autant de
solutions d’ordre proprement financier à la crise de l’euro que d’options politiques
concernant la construction de l’Europe.
Nous verrons donc dans une première partie, quelles sont les causes de la crise de la crise.
Ensuite, nous ferons un constat de la situation actuelle dans laquelle se trouve la Zone Euro
suite à cette crise économique.
Enfin, nous exposerons quelles sont les solutions mises en œuvre, voir envisagées par les
Etats, ou les organismes afin de résoudre les problèmes causés par la Crise.
http://www.youtube.com/watch?v=vHKCWM5YhN4 (expliquer). (De 0.00 à 1.18)

I) Les Causes. (Arthur)
La Crise débute réellement avec la crise des « sub-primes », c’est-à-dire : un crédit à risque
que l’on va offrir à un client qui ne présente pas toutes les garanties nécessaires et
suffisantes pour bénéficier des taux d’intérêts préférentiels. Aux USA, il s’agit d’un crédit
hypothécaire (immobilier) dont le logement du client (emprunteur) est pris en garantie en
cas de défaut de paiement. Nous allons donc voir à travers 2 schémas, comment s’est-elle
mise en place.
Tout d’abord, la crise mondiale de 2008 a affecté la zone euro. En effet, une partie des
finances publiques a été injectée dans la recapitalisation des banques en faillite dont
certaines ont provoqué cette crise financière de grande ampleur. De par cette crise, la
récession s’est ressentie dans de nombreux pays les engageant tout d’abord à des plans de
relance en 2009 (notamment la France) avec une augmentation des dépenses publiques
mais sans forcément de nouvelles recettes voire des baisses de recettes amenant par
conséquence une explosion des déficits publics et une augmentation de la dette publique au
cours des deux dernières années.
Cependant, en 2008, la crise mondiale aurait pu être enrayée par la seule volonté des Etats
par différentes mesures. Mais il n’y a eu aucune résolution mise en œuvre entraînant
l’affolement des marchés en Août 2011 à l’annonce d’un possible défaut de paiement des
Etats-Unis. Si ces derniers n’avaient pas sorti la planche à billets, les conséquences
économiques auraient été désastreuses et ce notamment pour l’Europe.
Alors que la crise de la zone euro a véritablement démarré lors de l’annonce au bord de la
faillite de la Grèce, et que celle-ci a bénéficié d’un premier plan de sauvetage de 110
milliards d’euros, au 20 Février 2012, l’Europe en est toujours au même point dont la facture
devrait s’élever pour le seul sauvetage du pays de Platon à 350 milliards d’euros.

La crise de la zone euro a souvent été décriée pour cause de surendettement excessif et
abusif des Etats. Cela démontre surtout l’individualisme des Etats dans une Europe soi-disant
unie. Le cas de la Grèce est un parfait exemple. Cela faisait des années que celle-ci maquillait
ses comptes et les voilait à l’union européenne et dont la proche faillite a été annoncée
comme un coup de tonnerre sans que personne ne s’y attende. Les fraudes fiscales de la
population mais également les fraudes des politiques ont fait de la Grèce vivant à crédit
depuis des années, un pays incapable de rembourser la dette cumulée . L’inconscience de
tels actes a amené à repenser inévitablement les différentes politiques menées au sein de la
zone euro car la conséquence aurait été catastrophique pour la zone euro si le sauvetage
n’avait pas eu lieu.
Mais surtout l’union monétaire créée par le traité de Maastricht a été conçue par la suite
dans le traité de fonctionnement de l’union européenne de manière incohérente mais
également le traité lui-même sur certains points n’a surtout pas été respecté par les Etats
membres.
Le premier défaut de conception concerne le statut de la Banque centrale européenne qui se
veut indépendante des gouvernements ; elle ne peut donc pas acquérir auprès des Trésors
publics des titres de dettes. Cela entraîne un endettement des Etats auprès des banques
privées à des taux beaucoup plus élevés que si la dette avait été achetée par la Banque
centrale. La banque centrale européenne par son indépendance est donc empêchée de
jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Mais surtout le fait que les titres de dette
publique soient détenus en grande partie hors des Etats qui les émet, ce dernier s’il ne peut
rembourser sa dette accroît la possibilité d’une crise bancaire.
L’Europe n’est pas solidaire en cas de faillite d’un Etat (clause de non-renflouement) . Or une
Europe construite correctement se doit d’être unie à tout moment. Par la peur d’une faillite
grecque, cette clause finalement n’a pas été suivie, puisqu’il était évident que si la Grèce
tombait en faillite, la crise aurait été bien plus conséquente. (à quel prix !) .
Enfin et surtout, l’article 126 du traité pose le principe de la discipline budgétaire des Etats
membres. Ces derniers sont sensés ne pas avoir de déficits excessifs. Nous le savons tous à
présent cette disposition n’a jamais été respectée. Si l’union monétaire avait suivi une
politique budgétaire commune, et rigoureuse, il est certain que la crise en provenance des
Etats-Unis aurait eu beaucoup moins de répercussions sur l’Europe. Il est impossible de
mener correctement une politique monétaire commune si la politique budgétaire ne l’est
également. Il y a eu donc un manquement incontestable de la part des gouvernements
successifs depuis plusieurs années mais également des institutions européennes qui auraient
dû sanctionner de tels écarts. L’union monétaire se fonde sur une monnaie unique mais sans
unité politique. De ce fait nous assistons à une incomplétude de l’euro dans sa création
donnant l’impression que l’euro est une monnaie étrangère aux pays membres.
La crise de la zone euro n’est pas seulement due à un endettement public. Il est également
privé. L’endettement privé n’étant pas concerné par le pacte de stabilité, celui-ci n’a pas été
combattu par les gouvernements successifs. Pourtant la politique économique menée par
chaque Etat devait prendre en compte l’intérêt de l’Europe dans son ensemble et l’article
121 le stipule : « Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une
question d’intérêt commun… ». Là aussi un manque de coordination est visible et le Conseil

qui devait coordonner ces politiques économiques n’a pas été en mesure ne serait-ce que de
faire des recommandations à certains pays dont l’endettement privé était des plus excessifs
grâce aux taux d’intérêt réels à court terme faibles, notamment le Portugal, l’Espagne et
l’Irlande.
Le niveau de l’endettement de nombreux États du « Nord » a fortement augmenté au cours
de la première décennie du XXIe siècle, avec pour certains (les USA, la France, l’Espagne, tout
particulièrement) une nette accélération suite à la « crise de 2008 » qui a affecté les rentrées
fiscales. Ce niveau élevé pose à tous des problèmes, mais ce qui se passe dans la zone euro
au cours des derniers mois est tout à fait particulier. On parle à juste tire d’une crise de
l’euro. Le processus d’enclenchement de cette crise spécifique est connu. Le point de départ
est une forte baisse des cours, sur les marchés financiers mondialisés, des titres émis par
l’État grec ; cela oblige cet État à devoir faire de nouveaux emprunts à des taux beaucoup
plus élevés (le double, puis le triple de ceux de l’Allemagne ou de la France), puis à ne plus
pouvoir faire face aux remboursements de sa dette antérieure sans des prêts consentis par
les autres États de la zone euro (la BCE ne pouvant, sans contrevenir à ses statuts actuels,
racheter en masse des titres grecs sur les marchés pour soutenir le cours de ces titres). Et
c’est ensuite l’Italie (son État) qui est touchée de façon similaire. Il va de soi qu’il faut trouver
une solution à cette crise et qu’à ce jour elle n’est pas encore trouvée. On peut s’entendre
pour dire que toute solution qui est fondée sur un mauvais diagnostic de l’origine de cette
crise est vouée à l’échec. Il en va en effet des « maladies sociales » comme des maladies du
corps humain que soigne le médecin. Mais concernant les maladies du « vivre-ensemble »
des humains, la solution est une affaire de choix politique. Il y a donc toujours un débat
entre diverses solutions fondées sur un diagnostic relativement partagé.
La crise s’expliquant notamment par d’énormes dettes, voici un schéma qui illustre cette
accumulation de dettes.
En fait, c'est le secteur privé, c'est-à-dire des entreprises et des particuliers - qui
s'endettaient. Les taux d'intérêts étaient tombés à des niveaux historiquement bas dans les
pays méditerranéens depuis leur adoption de l'euro. Et cela a encouragé un boum
économique fondé sur la dette.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la dette publique n’est pas responsable de la
Crise.
Toute cette dette a aidé à financer de plus en plus d'importations en Espagne, en Italie et en
France.
Dans le même temps, l'Allemagne a renforcé sa position de grande économie exportatrice
après la création de l'euro, vendant de plus en plus de biens au reste du monde, dont les
pays du sud de l'Europe, sans pour autant importer plus. L'Allemagne a donc accumulé
d'énormes quantités de cash grâce ses exportations, cash qui fut ensuite prêté … aux pays
d'Europe du Sud.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%