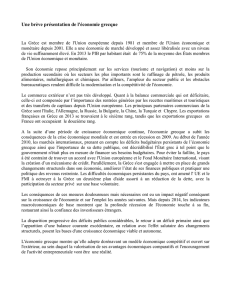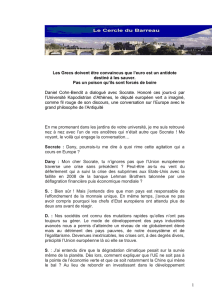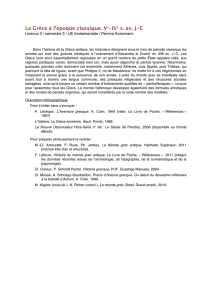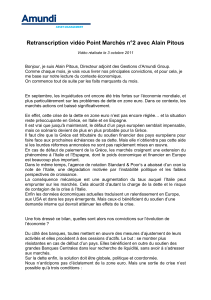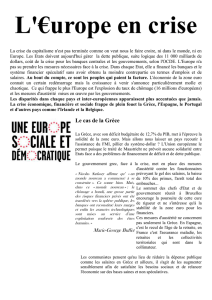Les analogies douteuses de John R. MacArthur

LA RÉPLIQUE › L’ALLEMAGNE ET LA GRÈCE
Les analogies douteuses de John R. MacArthur
6 août 2015 | Frédéric Mérand - Professeur de science politique | Actualités internationales
Photo: Robert Michael Agence France-Presse
Une manifestation de Pegida en Allemagne. Présenter Angela Merkel avec un brassard nazi n'ajoute rien à la compréhension de
la crise grecque, soutient l'auteur.
À travers un subtil dosage d’anecdotes, de citations et d’images dont on ne sait pas toujours s’il les
reprend à son compte, le chroniqueur John R. MacArthur avance trois idées : (1) la politique
européenne du gouvernement d’Angela Merkel est comparable à celle des nazis ; (2) la situation en
Europe est comparable à celle de 1940 ; (3) le président François Hollande agit comme le maréchal
Pétain, un collaborateur. Il nous laisse imaginer le résultat.
Ces analogies sont douteuses et méritent une réponse. Certes, la crise grecque est complexe. On
peut toutefois la résumer d’une autre manière que M. MacArthur.

D’abord, il faut revenir au contexte, caractérisé par les illusions de la première décennie de la
monnaie unique. Au début des années 1990, les Européens créent l’euro sur le modèle du Deutsche
Mark, avec des règles contraignantes pour garantir une monnaie forte. C’est le prix que la France a
payé pour que l’Allemagne embarque dans son projet d’intégration européenne. Au début, tout se
passe mieux que prévu. Sauf que…
En 2001, la Grèce est admise dans l’euro après avoir maquillé ses chiffres pour répondre aux
conditions d’adhésion. Pendant huit ans, l’économie grecque profite de taux d’intérêt avantageux qui
permettent à l’État de vivre largement au-dessus de ses moyens, ce qui, dans un système
clientéliste, profite bien à certaines catégories de la population.
Comment l’austérité est-elle arrivée à Athènes ? En pleine crise économique et financière mondiale,
le mensonge des statistiques publiques grecques éclate au grand jour. Les marchés attaquent une
Grèce beaucoup plus endettée qu’elle ne le disait. Afin d’éviter la contagion et de sauver leurs
propres banques, les États de la zone euro acceptent de reprendre la dette grecque, celle-ci devenant
en grande partie la propriété des citoyens allemands, mais aussi français, néerlandais, etc.
En échange, les créanciers privés effacent une ardoise de 100 milliards d’euros et sortent du jeu.
L’austérité, qui aurait de toute manière été imposée par les marchés, l’est désormais par la
« troïka », représentant les créanciers que sont les États européens, la Banque centrale et le FMI, qui
impose des réformes structurelles et fiscales visant à permettre le remboursement de la dette, mais
aussi à réformer un État jugé corrompu et inefficace.
Le pire est évité
Ceci nous amène aux négociations du printemps dernier. L’économie grecque continuant à s’effondrer
à cause de l’austérité mais aussi de ses faiblesses structurelles, de nouveaux emprunts ont
rapidement été nécessaires. Arrivé au pouvoir en janvier 2015, le parti Syriza d’Alexis Tsipras
demande l’arrêt des réformes et une annulation de la dette. Son mandat est clair, mais sa marge de
manoeuvre l’est moins.
Dans un climat d’euroscepticisme croissant, aucun État européen n’est prêt à expliquer à son
électorat qu’il va effacer la dette d’un pays qui n’aurait jamais dû faire partie de la zone euro. Même
si Paris adopte un ton plus conciliant, l’analyse y est la même qu’à Berlin, Varsovie, Ljubljana ou
Helsinki. Tsipras ne trouve aucun ami en Europe, sauf peut-être, dans un premier temps, le président
de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
Après des semaines de négociations épuisantes sur le plan psychologique, dont un référendum
inutile, l’Allemagne accepte finalement le 13 juillet dernier que les Européens octroient un prêt
supplémentaire permettant à la Grèce d’honorer ses engagements à court terme. Le pire est évité, à
moins de vouloir un retrait brutal de la Grèce de l’économie mondiale. Mais, comme aucun des
créditeurs n’a confiance dans le gouvernement grec, ils exigent de nouvelles conditions qui, selon
toute évidence, continueront à plomber l’économie grecque. Derrière Berlin, on retrouve la Finlande,
les Pays-Bas et tous les pays de l’Est, souvent plus pauvres que la Grèce. Athènes n’a pas réussi à
convaincre que, même sous un nouveau gouvernement, la corruption et le clientélisme étaient une
chose du passé.
Arrogance allemande ?

Cette histoire, absurde sur le plan économique et tragique pour une partie du peuple grec, ne révèle
toutefois aucune volonté de faire « souffrir » les Grecs « sous le joug allemand ». On observe plutôt
des erreurs commises par toutes les parties, un système institutionnel européen défaillant, une
absence de solidarité et un surplus de défiance, mais surtout des conceptions différentes de la
politique économique qui cohabitent mal sous une monnaie commune.
Arrogance allemande, dites-vous ? Rappelons que, depuis 2010, 260 milliards d’euros ont été prêtés
à la Grèce par les États européens (soit 750 euros par habitant de la zone euro, les Allemands ayant
payé davantage parce qu’ils sont plus riches), à des taux d’intérêt presque nuls. Au final, Berlin a
imposé sa vision économique parce que c’est elle qui paye l’addition, alors que les appels à la
solidarité lancés par Paris sonnent creux.
Il est possible que la stratégie germano-française ne soit pas la bonne et certain que les conditions
exigées par le ministre allemand des Finances, M. Schäuble, seront contre-productives. Mais
présenter Mme Merkel avec un brassard nazi comme M. MacArthur s’est plu à le faire n’ajoute rien
d’utile à la compréhension de la crise grecque.
1
/
3
100%